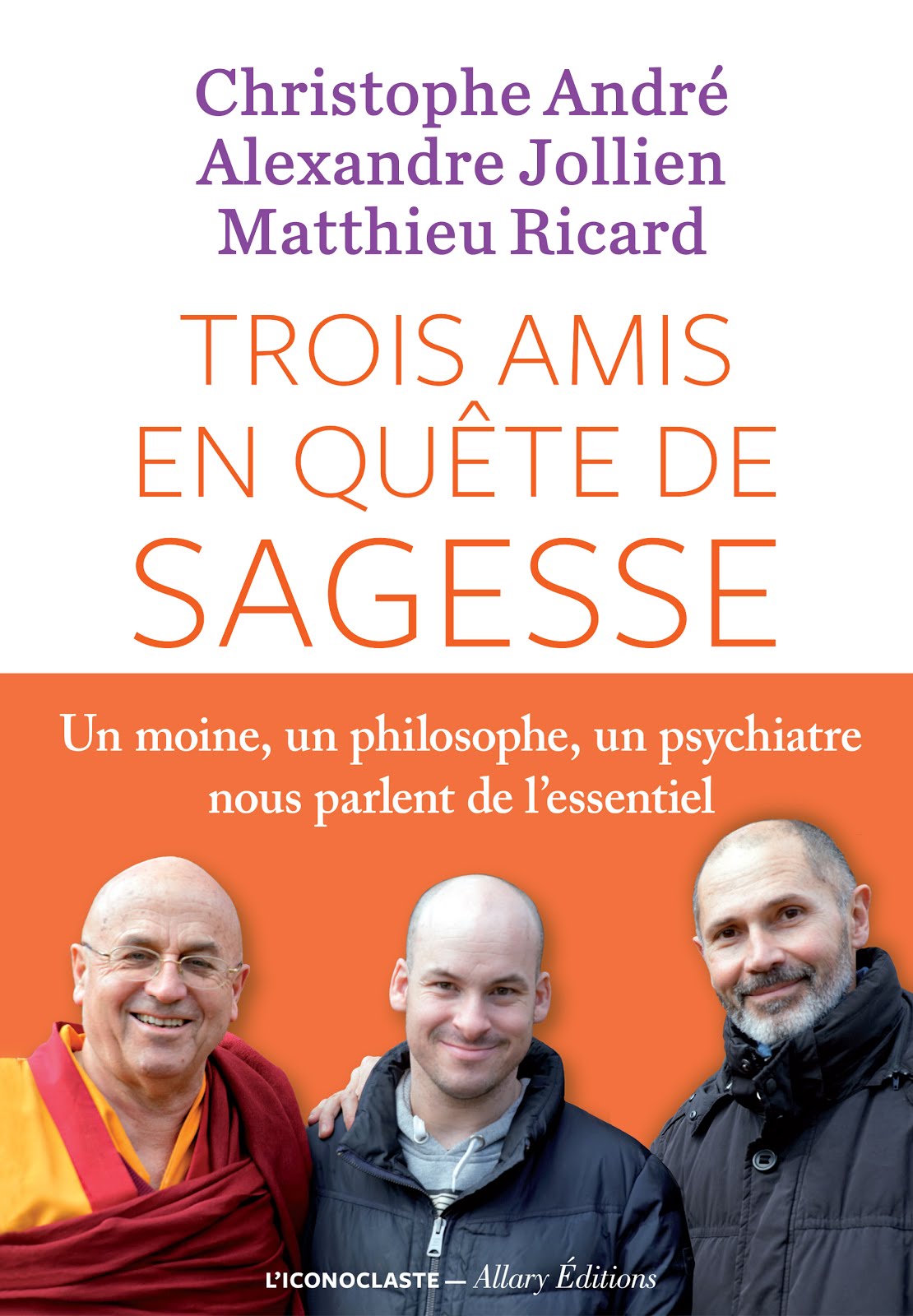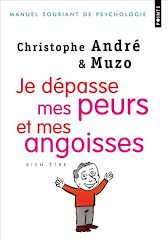Je suis sur mon scooter, sur une voie urbaine autour de Paris. La circulation n’est pas trop dense, alors j’ai le temps de regarder par petits coups d’œil le ciel et les bâtiments qui défilent. Avant de passer sous un pont, je déchiffre un message peint en grosses lettres maladroites sur le parapet de béton : « Repentez-vous ! »
La formule se fiche dans mon crâne. Ce mot de « repentir », à la connotation religieuse, me déstabilise. Repentez-vous ! Qui a pu écrire ça ? En bon psychiatre, je pense à un délire mystique ou un état délirant. Mais tout de même, il a fallu de l’organisation pour arriver à peindre ces grandes lettres, dans un endroit d’accès compliqué. Alors, un prédicateur allumé, ou très motivé ?
Puis je me dis que ce n’est pas la question. Après tout, le meilleur moyen de ne pas écouter les messages qu’on nous adresse, c’est de disqualifier la personne qui les délivre. Or, ce message me touche. Pourquoi ?
Je n’ai pas l’impression d’avoir commis des actes appelant de la repentance. Pas ces temps-ci. Mais dans ma vie, si. J’ai fait du mal à tout un tas de gens. Par inconséquence et par égoïsme dans ma vie amoureuse, quand j’étais jeune. Par manque de disponibilité et par mauvaise humeur, avec des proches, du fait du stress, quand je travaillais trop. Par manque de disponibilité ou de discernement, dans tout un tas de circonstances.
La liste est longue, et sans doute l’est-elle encore plus que je ne l’imagine, du fait de tout ce qui passe sous le radar de ma mémoire, de tout le petit mal que j’ai fait et que j’ai oublié ou méconnu. Dois-je m’en repentir ?
Le repentir, pour Descartes, « c’est une espèce de tristesse qui vient de ce qu’on croit avoir fait quelque mauvaise action ; et elle est très amère, parce que sa cause ne vient que de nous. Ce qui n’empêche pas néanmoins qu’elle soit fort utile » Quelques siècles plus tard, le psychologue Pierre Janet note : « Le remords se distingue du repentir, qui désigne un état d’âme plus volontaire, moins purement passif... »
Mais ça commence à me mettre en danger ces histoires de repentir, il est temps que je me reconcentre sur la route : en scooter, ne pas conduire en pleine conscience, c’est mettre sa vie en danger.
Le soir en m’endormant, je repense à cette histoire. J’espère que si le « Repentez-vous ! » a été écrit par quelqu’un de perturbé, il (ou elle) va mieux aujourd’hui. Je me dis que je ne devrais pas me prendre la tête pour un oui ou pour un non, pour un simple graffiti. Je me demande si ça vaut la peine de prendre le temps chaque soir, de se poser la question du mal qu’on a pu faire à autrui. Ou si s’attacher simplement à faire du bien chaque fois que possible ne suffirait pas. Les deux, sans doute ?
Je n’ai pas la réponse.
Alors je m’endors...
Illustration : un ciel de Paris en hiver 2020, par l'ami Ali.
PS : cet article a été publié dans le magazine Psychologies en octobre 2020.