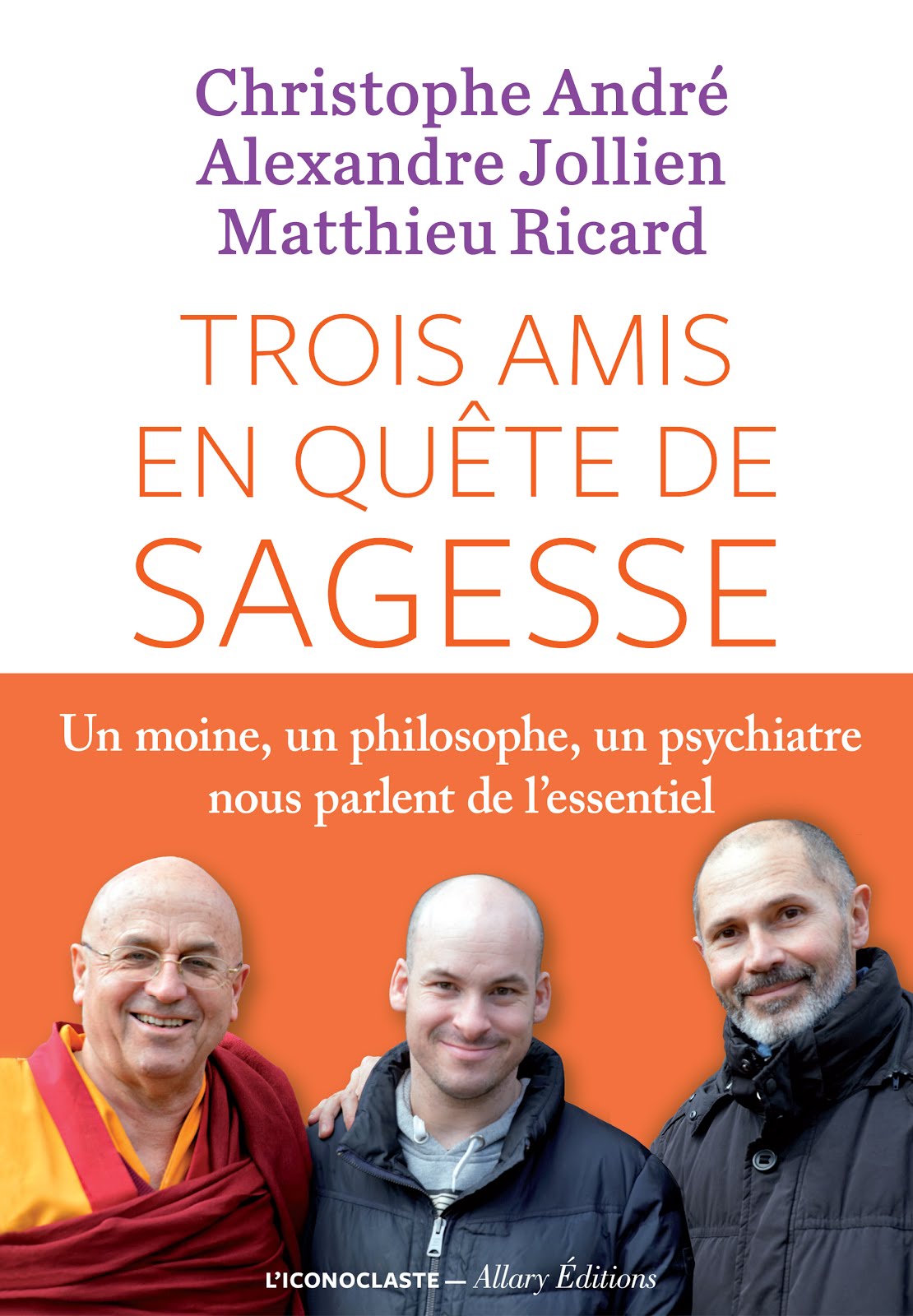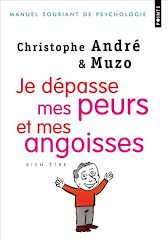Ça se passe au Mont Sainte-Odile, le vendredi 15 février 2013, vers 17h30. Je viens de donner un cours au Diplôme Universitaire de Médecine, méditation et neurosciences, à Strasbourg, le premier du genre en France. Fait très rare, et lié à la matière, l’enseignement est donné en résidentiel : les étudiants ont passé toute la semaine au monastère du Mont Sainte-Odile, où les cours ont été entrecoupés d’exercices de méditation. Maintenant, à l’issue de cette première semaine, les étudiants sont tous partis, et seuls restent les organisateurs et les enseignants.
J’en profite pour aller marcher tout seul sur le petit chemin qui fait le tour du monastère, au milieu des sapins. Les bâtiments sont perchés tout en haut d’un mont, perdu au milieu des forêts. Ce jour-là, comme souvent en hiver, tout est couvert de neige. Le ciel est sombre, obscurci par de gros nuages et la tombée du jour. Je marche lentement, en écoutant avec délices cet incroyable son de la neige qui crisse sous chacun de mes pas. Parfois, une percée dans la forêt ouvre l’horizon au regard : d’autres monts, couverts d'autres sapins enneigés. De temps en temps je relève la tête et j’aperçois la masse sombre et séculaire du monastère. Sentiment étrange. Globalement agréable, mais ce n’est pas du bonheur. Trop de gris dans le ciel, trop de rudesse dans le froid. Je suis juste étonné et content d’être là, un peu intimidé et impressionné par la beauté rugueuse de la nature et des bâtiments, par leur longue histoire.
Il n’y a pas de mot en français pour cet état d’âme. En anglais, il y a le mot awe, qui décrit le respect admiratif mêlé d’un peu de crainte et d’intimidation. C’est en quelque sorte l’émotion de la transcendance : ce que nous voyons et vivons dépasse notre cadre mental habituel, nos mots, notre intelligence sont impuissants à en prendre la mesure et la complexité et la signification.
On admire, on se sent dépassé par quelque chose de bien plus grand que nous, d’un peu effrayant aussi. Mais on est content de le voir, de l’observer, de savourer. On se sent tout petit. Et le goût particulier de ce sentiment, c’est que ce n’est pas une joie ou un bonheur centré sur nous-même, mais sur ce que nous voyons ou devinons ou imaginons, et qui nous impressionne, et que nous admirons en silence, le souffle et la parole coupés.
Puis des fantômes arrivent tout doucement.
Je repense que dans ces sombres forêts a eu lieu un accident d’avion célèbre, en 1992 : 87 victimes d’un coup dans ces monts sombres et glacés. Il me semble entendre les âmes des morts, restées là depuis, voltiger dans les branches des grands sapins, et m’observer de leurs yeux impassibles.
Je suis toujours dans le sentiment de awe, mais je ressens maintenant de la compassion pour toutes ces vies écrabouillées et stoppées net un soir de janvier 1992, presque à l’heure où je marche, et où mon souffle fait de plus en plus de bruit dans le silence. Mon cœur cogne, jusque dans mes oreilles. Suis-je en train de marcher trop vite ?
Je m’arrête alors. Je prends le temps de bien ressentir l’air frais qui nourrit mon souffle, cette sensation incroyable et inimitable de l’air de neige. Il me semble entendre le souffle de la montagne qui respire aussi, étouffé lui par le lourd manteau de neige. Silence habité.
Bien descendu dans mon corps je laisse voltiger mes états d’âme à leur guise : le monastère, le tombeau de Sainte-Odile dans la pénombre d’une crypte, le Diplôme Universitaire, les visages des étudiants et les discussions avec eux, l’avion qui s’écrase et les vies qui s’éteignent .
Comme à chaque fois, je suis touché par ce mystère des états d’âme : comment peut-on à la fois être apaisé et endolori ? heureux d’être en vie et attristé par des faits de vie ? écrabouillé par plus grand que nous et désireux pourtant de continuer à voir ce qui va se passer ?
Dans quelques instants, mon corps va se remettre à marcher, je vais rejoindre mes amis là-haut dans le monastère, nous allons bavarder, partir reprendre nos voitures, nos trains ou nos avions. Aucune des énigmes ressenties pendant ma marche n’aura été résolue.
Mais j’aurais senti le souffle de la vie me traverser, et cela m’a serré un instant le cœur, très fort, avant de le rendre plus léger.
Impression d’avoir été un oiseau, saisi un instant par un géant invisible, tenu dans sa main, puis relâché et rendu au ciel. Rien compris, pas bien vu. Quelque chose d’infiniment grand et infiniment fort existe, nous saisit parfois et nous relâche (en général).
C’est beau et effrayant.
Ça donne envie de continuer à vivre, à aimer, et à sourire tout doucement.
Awe…
Illustration : le Mont Sainte-Odile sous la neige.