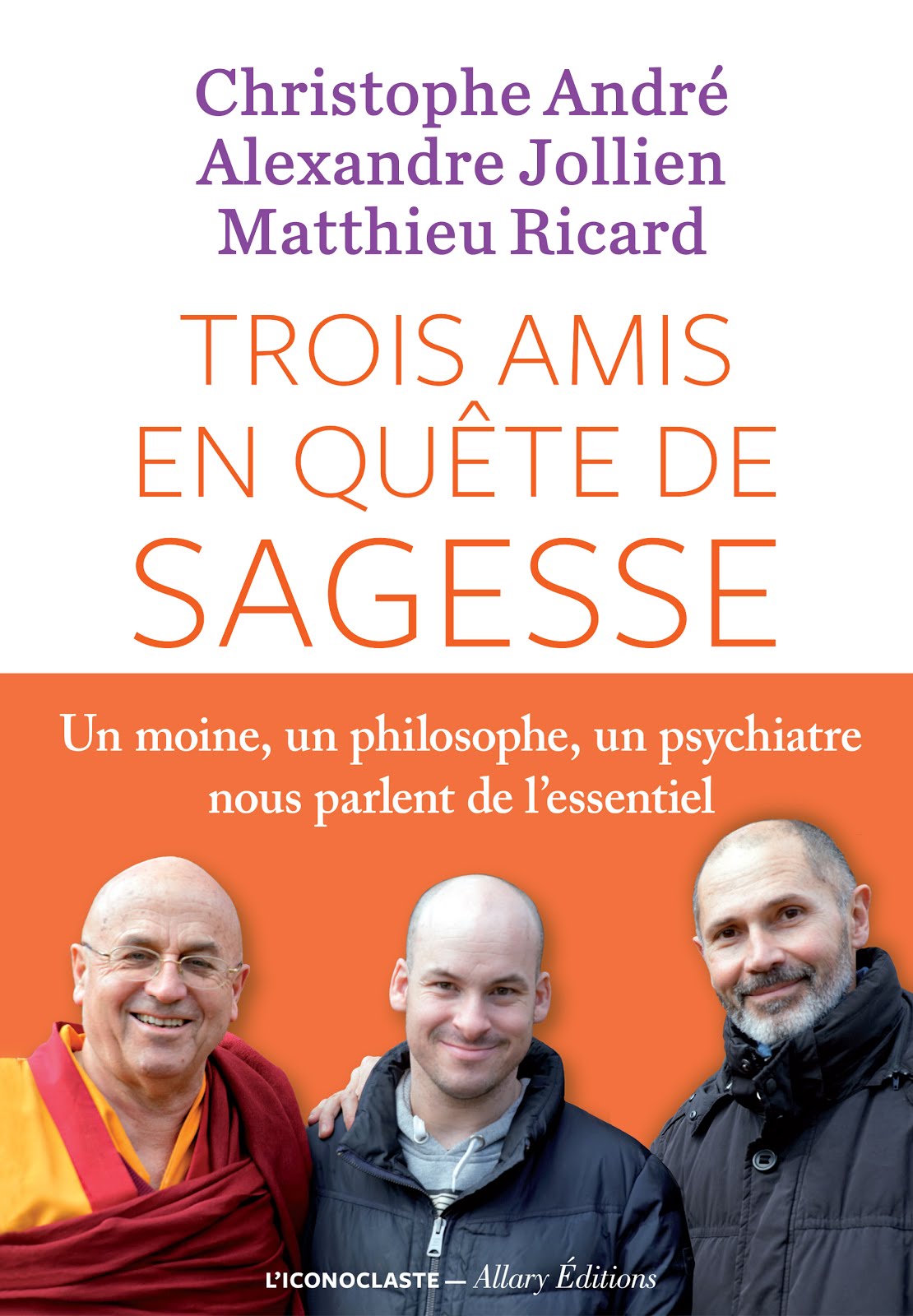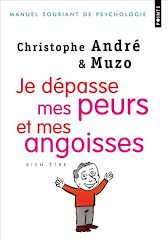Il y a 20 ans, alors que nos 3 filles étaient encore petites, et s’apprêtaient à entrer en maternelle et donc à se trouver en contact avec de nombreux adultes inconnus, nous avions eu de grandes discussions avec mon épouse sur le fait de savoir si nous devions ou non les mettre en garde contre les actes de pédophilie.
De mon côté, et bien que psychiatre parfaitement au courant, je n’étais pas tout à fait sûr qu’il faille le faire, et le faire si tôt. Je redoutais un peu de leur transmettre une vision du monde angoissante, de transformer chaque rencontre avec un nouvel adulte en source d’inquiétude. Je craignais de porter trop tôt une première atteinte à la légèreté de leur enfance.
Peut-être mon attitude s’expliquait-elle par le fait que je n’avais jamais été confronté moi-même à ce type de problèmes : j’étais un petit garçon prudent, voire méfiant envers les adultes, gardant soigneusement mes distances. Mais je crois surtout que j’étais un papa poule, désireux de leur éviter toute souffrance inutile, et de les protéger d’une prise de conscience précoce de toute la violence du monde…
J’avais tort : nous ne pouvons pas laisser nos enfants vivre et grandir sous cloche. De même qu’il ne faut pas à tout prix leur cacher l’existence de la mort ni de la souffrance, il ne faut pas non plus leur masquer l’existence de la violence, physique ou sexuelle. Simplement, nous avons à adapter notre discours à leurs capacités de compréhension et d’affrontement.
Mais même une fois la décision prise, j’aurais pu hésiter longtemps avant de trouver le meilleur moment pour leur en parler. C’est mon épouse qui s’en est chargée sans plus attendre : plusieurs de ses copines d’enfance avaient subi des attouchements ou agressions sexuelles, et elle souhaitait que nos filles soient informées suffisamment tôt.
Elle a fait ça très bien, tranquillement. En leur expliquant que la plupart des adultes qu’elles rencontreraient seraient dignes de confiance, mais pas tous. Que certains étaient malades dans leur tête et pouvaient leur demander ou leur faire des choses que les adultes n’ont pas à faire avec des enfants : vouloir les voir tout nus, les caresser. Que si des adultes faisaient ça, ce n’était pas du tout, du tout normal.
Elle leur rappelait souvent qu’elles avaient le droit de dire non, surtout si elles sentaient au fond d’elles-mêmes quelque chose de bizarre et d’inconfortable. Et surtout, surtout, que c’était très important d’en parler tout de suite : aux parents, à la famille, à la maîtresse. Que si un adulte leur disait : « surtout tu n’en parles pas », c’était déjà un truc bizarre et pas normal.
Sincèrement, je crois que ça leur a un peu fichu la trouille, au début. Du coup, elles en ont fait à un moment un sujet de jeux, quand elles prenaient leur bain ensemble par exemple, en se criant mutuellement : « Tu ne me touches pas, vieux satyre ! ». Mais le message est passé, et ce qui en est resté, c’était sans doute de la prudence et de la vigilance, plus que l’angoisse. Et surtout, la connaissance que ce danger existait.
De mon côté, je continuais de penser que c’était une bonne chose de leur en avoir parlé, mais qu’on aurait tout aussi bien pu s’en passer, car leur environnement était tout de même très protégé. Jusqu’au jour où, quelques années plus tard, un employé de l’école qu’elles fréquentaient a été arrêté pour attouchements sexuels sur des petits garçons. La foudre n’était pas passée loin. Et ma femme avait eu raison, elle s’était montrée plus moderne que moi, vieux crouton d’une époque où la pédophilie existait bel et bien, mais dans le plus grand secret.
Depuis, les choses ont continué de bouger dans le bon sens. On sait aujourd’hui qu’il faut informer, expliquer, éduquer, pour éviter des enfances et des vies fracassées. Ce n’est pas gai, mais c’est ce qu’on peut appeler un progrès…
Et vous, quand vous étiez enfant, on vous en avait parlé de ces histoires de pédophilie ?
Illustration : ce que devraient être toutes les enfances... (Fillette dans un champ de fleurs, par Ludwig Knaus)
PS : ce texte reprend ma chronique du 20 novembre 2018, dans l'émission d'Ali Rebehi, "Grand bien vous fasse", tous les jours de 10h à 11h sur France Inter. Également disponible en vidéo.
PS : ce texte reprend ma chronique du 20 novembre 2018, dans l'émission d'Ali Rebehi, "Grand bien vous fasse", tous les jours de 10h à 11h sur France Inter. Également disponible en vidéo.