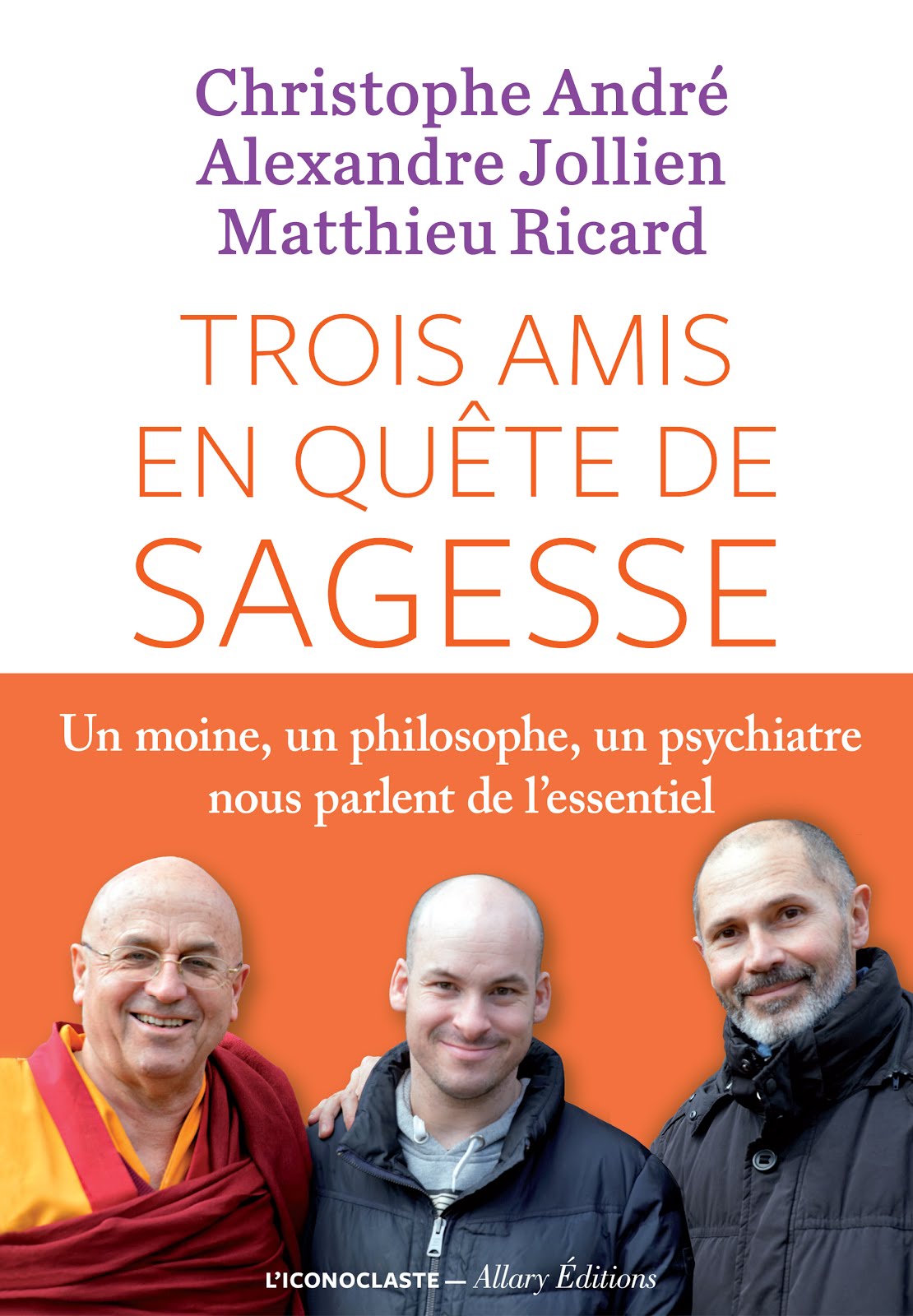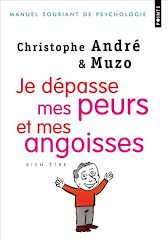Ça se passe dans la maison de mes parents, un peu avant Noël.
Voilà plusieurs années que mon père est mort. Rien n’a changé, comme souvent chez les personnes âgées : mêmes meubles, mêmes objets, mêmes odeurs, tout est toujours là, comme si le temps n’avait pas passé. Lors de mes visites, j’aime farfouiller dans cet endroit qui fut celui d’une partie de mon enfance, explorer le désordre, ranger un peu. Je parcours les rayons des grandes bibliothèques qui encadrent les couloirs.
Mon père n’avait pas pu faire d’études : issu d’une famille pauvre, il était devenu très vite mousse dans la marine. Il respectait au plus haut point les livres, mais il n’en lisait pas ; je n’ai aucun souvenir de lui penché sur un quelconque bouquin. Il était par contre persuadé que c’est par les livres et les études que ses enfants échapperaient à la condition sociale qui avait été la sienne. Alors il remplissait la maison de livres, et nous, ses fils, nous les lisions, inlassablement.
Il n’avait jamais eu non plus de jouets dans sa propre enfance, et il en achetait beaucoup, pour mes trois filles. Il les cachait dans des petits recoins de la maison, pour pouvoir leur offrir lors de leurs visites. Et là, en rangeant le placard bas d’une bibliothèque, je tombe sur un de ces gisements de jouets, dissimulés derrière des bouquins.
Bouffée de passé instantanée. J’imagine la scène, je vois le visage de mon père, le sourire au lèvres, dans ses vieilles fringues improbables, cachant les jouets à cet endroit, heureux par avance du moment où il va les offrir, ou les faire découvrir à ses petites-filles : « plus haut, plus bas ; non, pas ici ; ah, là, là ça brûle… » Il est mort très vite, en quelques semaines, d’un cancer généralisé, et n’a jamais eu le temps de les offrir, ces petits cadeaux. Ils sont restés là, endormis, à attendre qu’on les découvre.
Je suis à la fois triste et heureux de cette irruption à mon esprit de son visage et de sa présence, au moins pour quelques instants. C’est sans doute ainsi que nous devons repenser à nos morts : en les revoyant vivants et heureux.
J’ai les jouets dans les mains, je les observe attentivement, ils me semblent dégager une drôle d’énergie, celle de l’amour dont ils sont encore chargés. Jamais je n’avais pris conscience à ce point que, finalement, tous les cadeaux que l’on reçoit dans une vie sont des messages d’attention, d’affection et d’amour.
C’est Noël dans quelques jours, et je ne sais pas si je vais avoir des cadeaux (aurais-je été assez sage ?). Mais si c’est le cas, je sais qu’ils vont me mettre dans un sacré drôle d’état. C’est étrange qu’il n’y ait pas de mots précis pour décrire cette émotion si forte et si importante qui consiste à se sentir aimé…
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en décembre 2017.