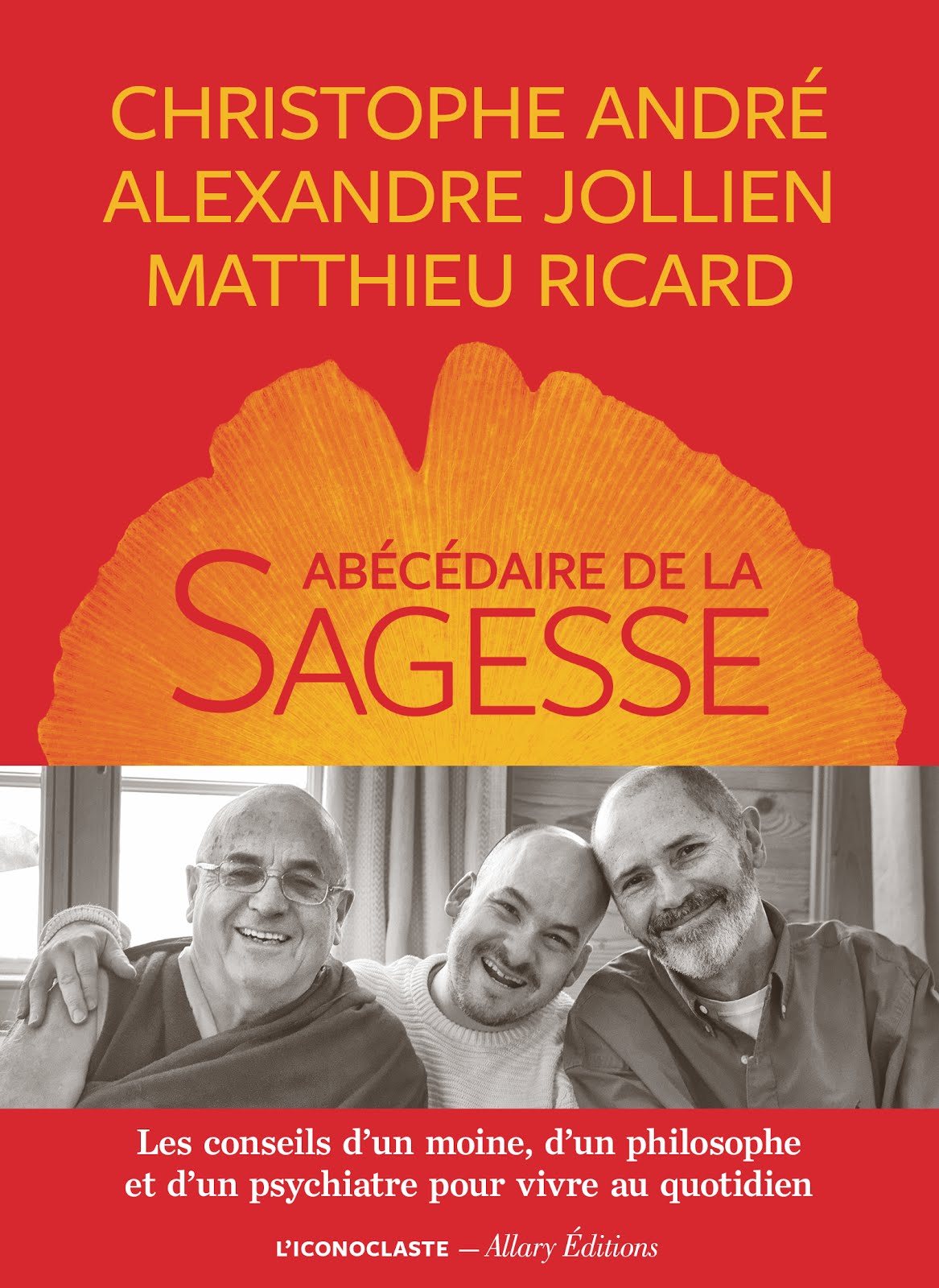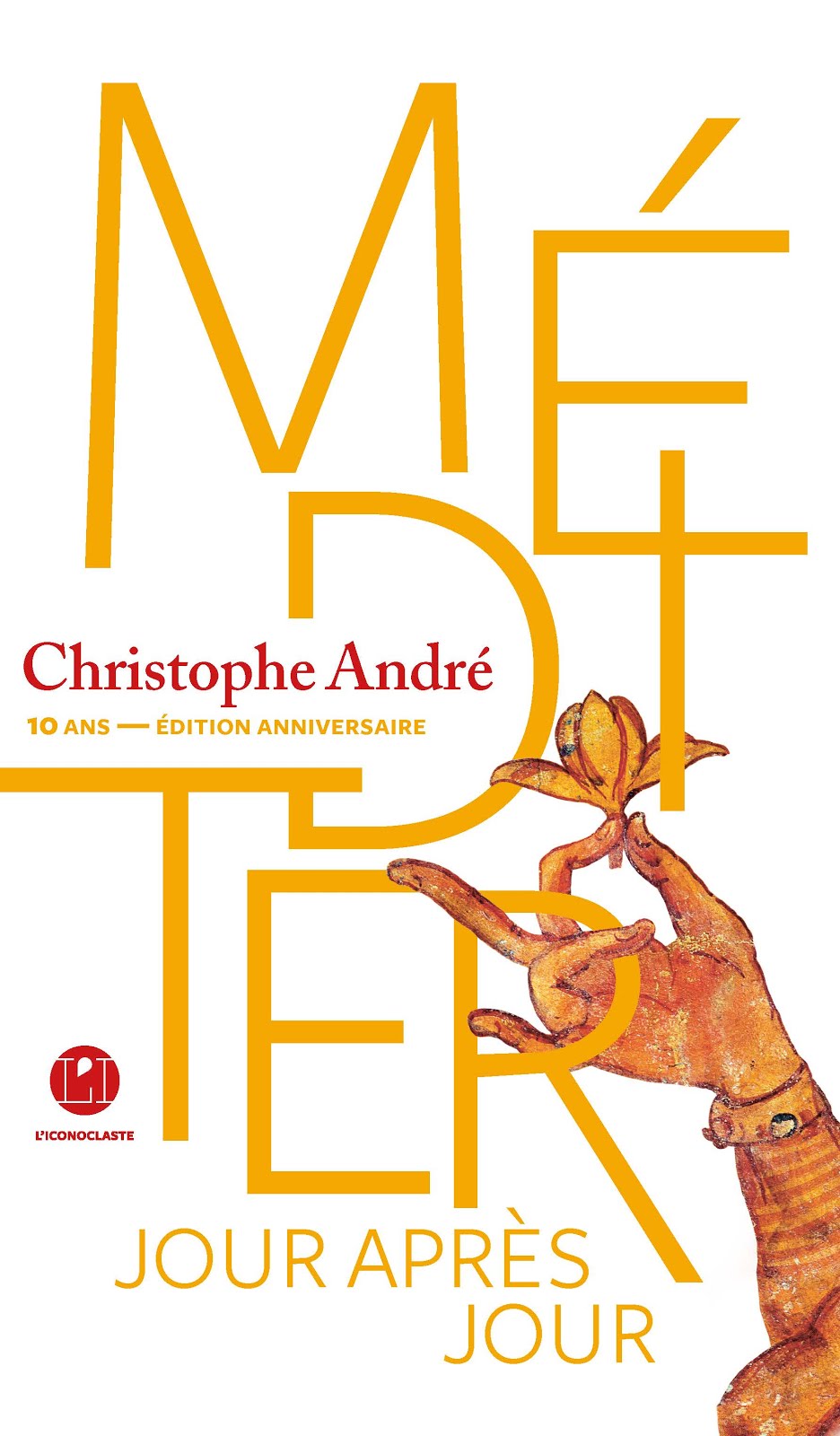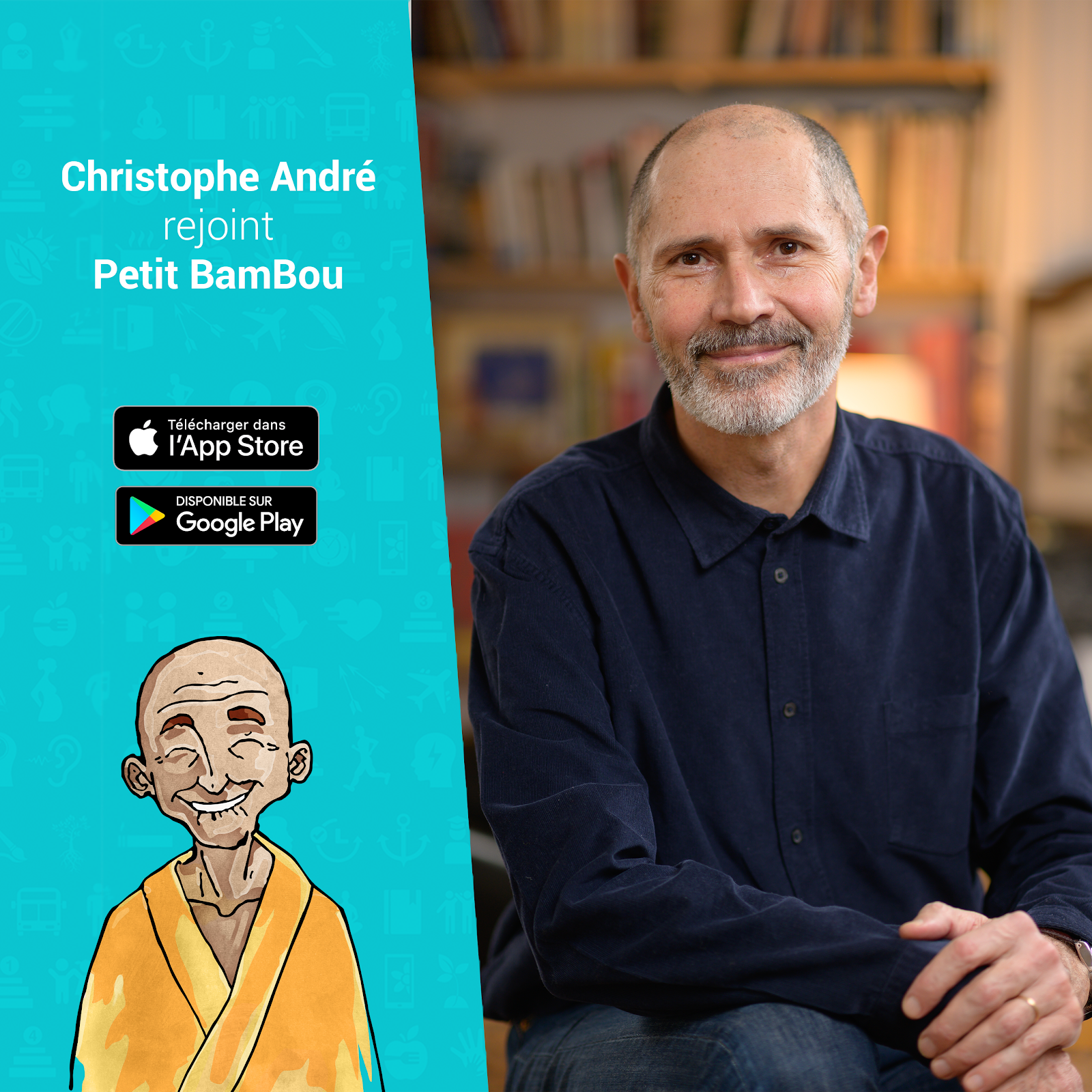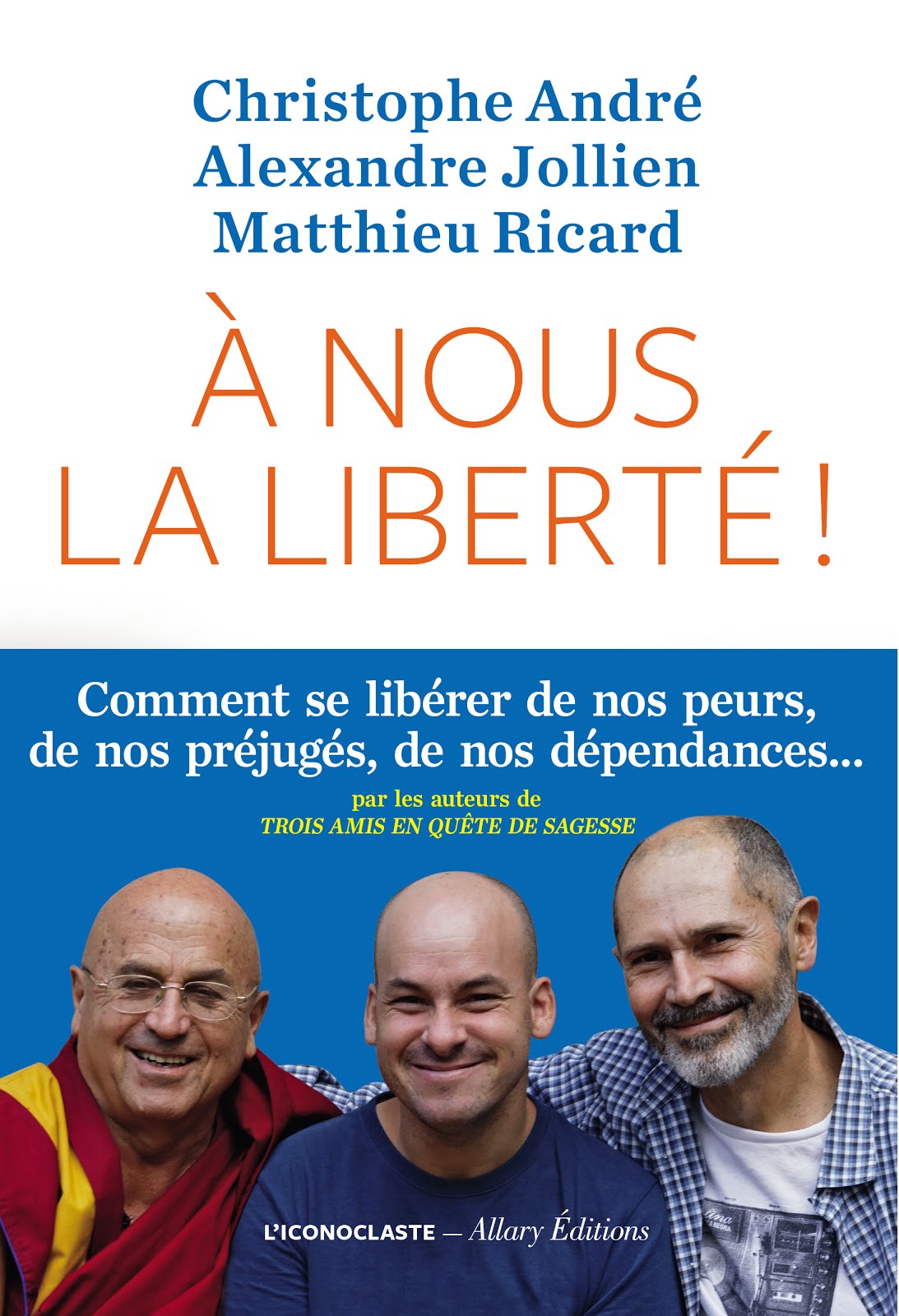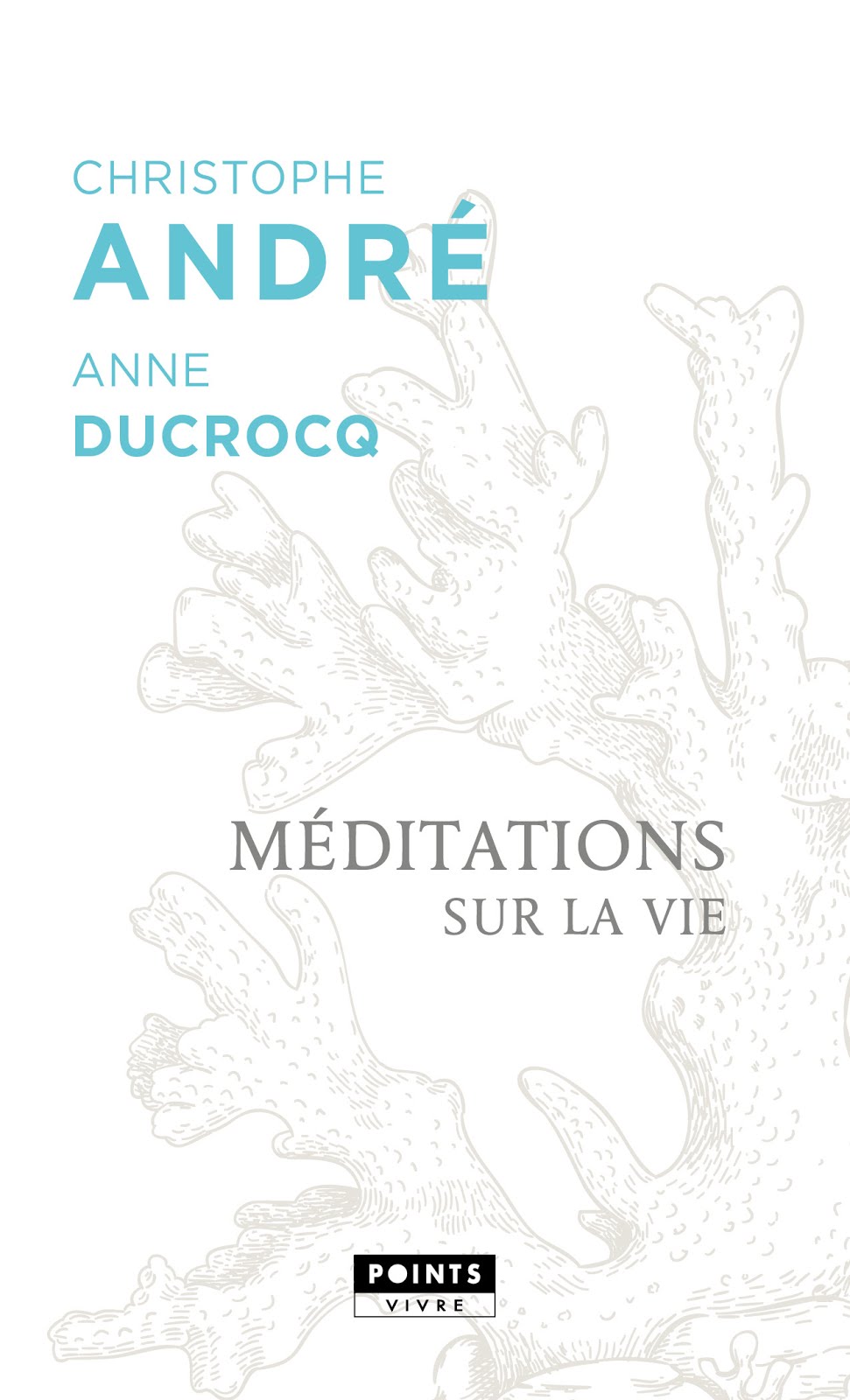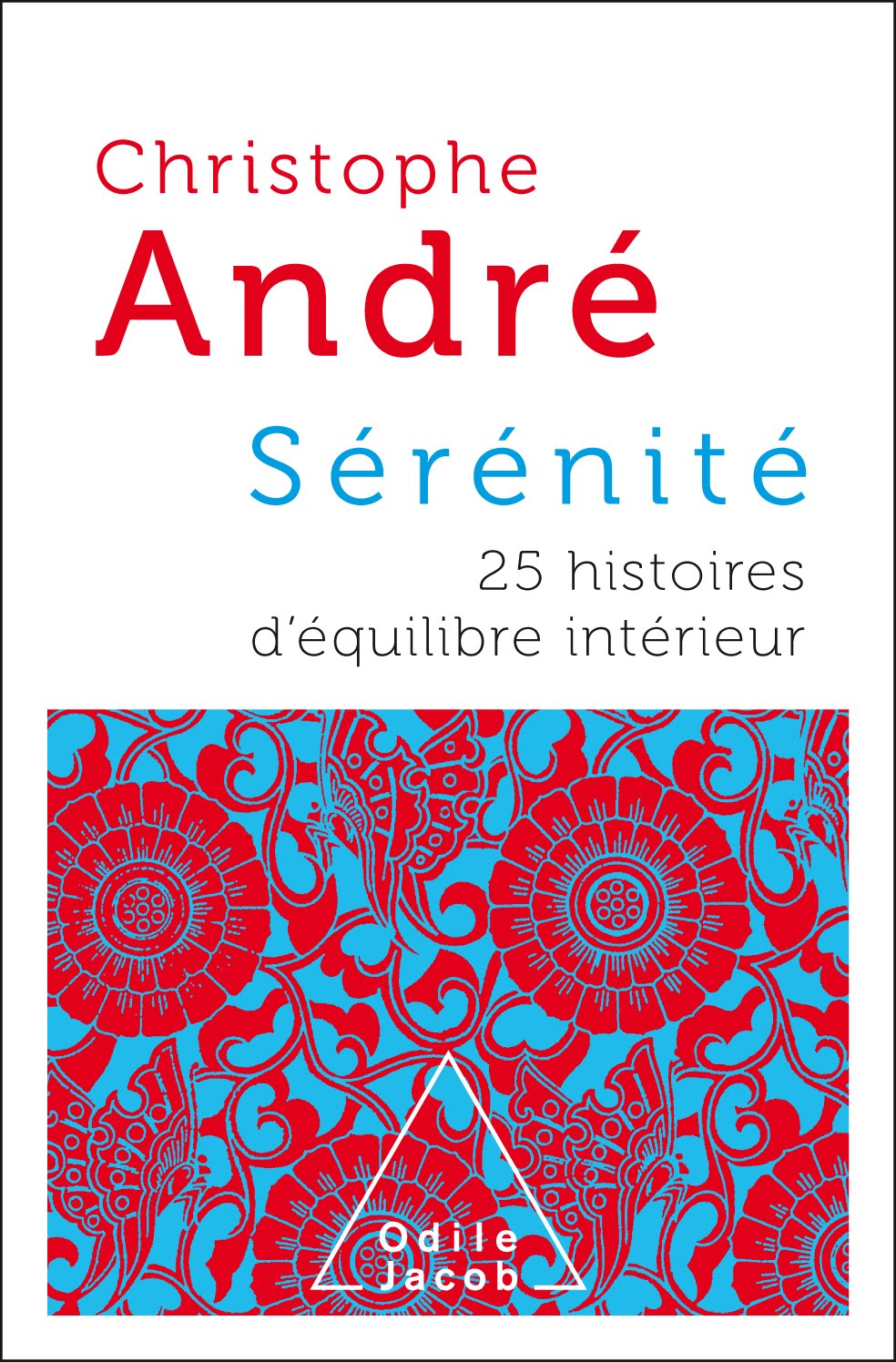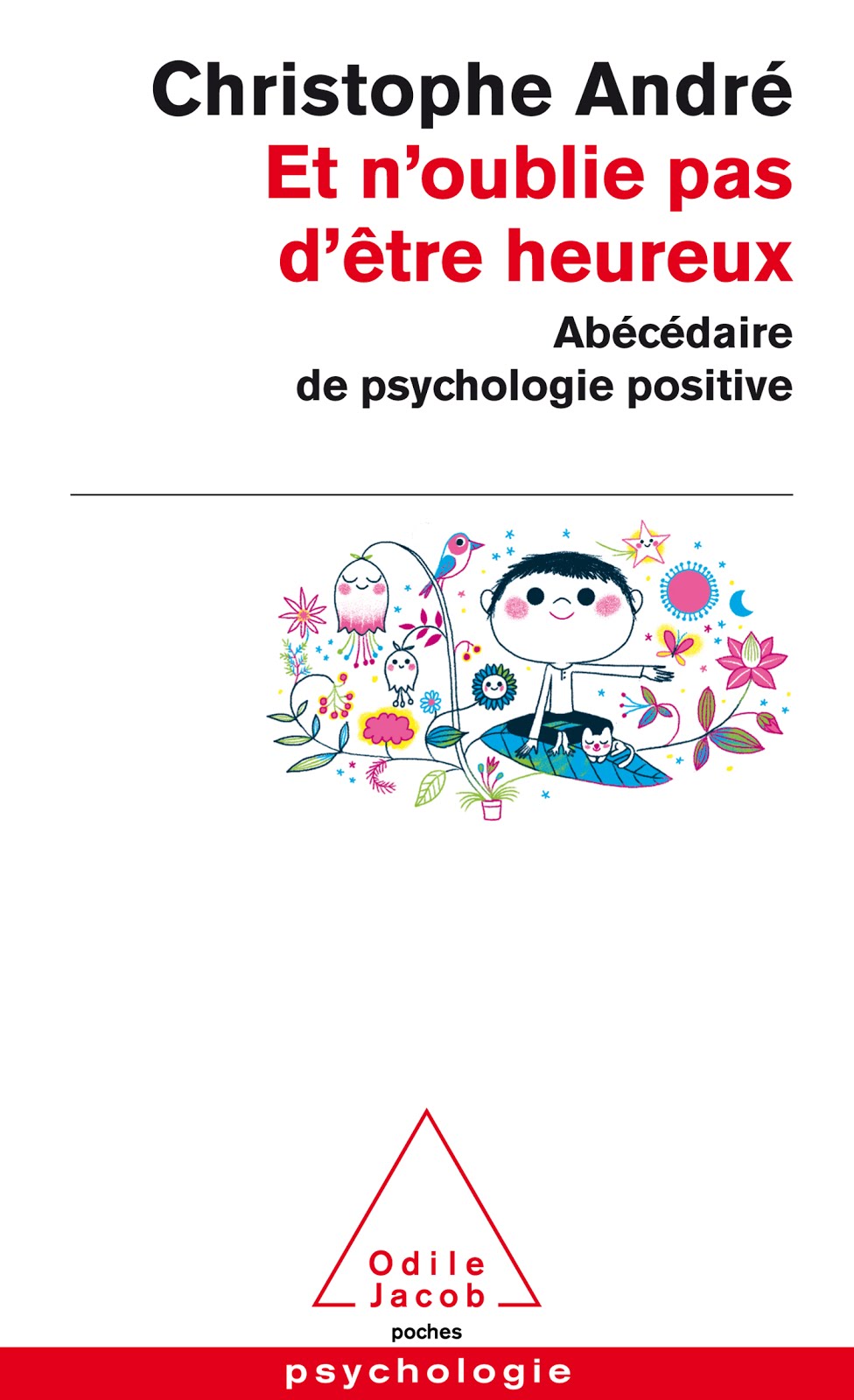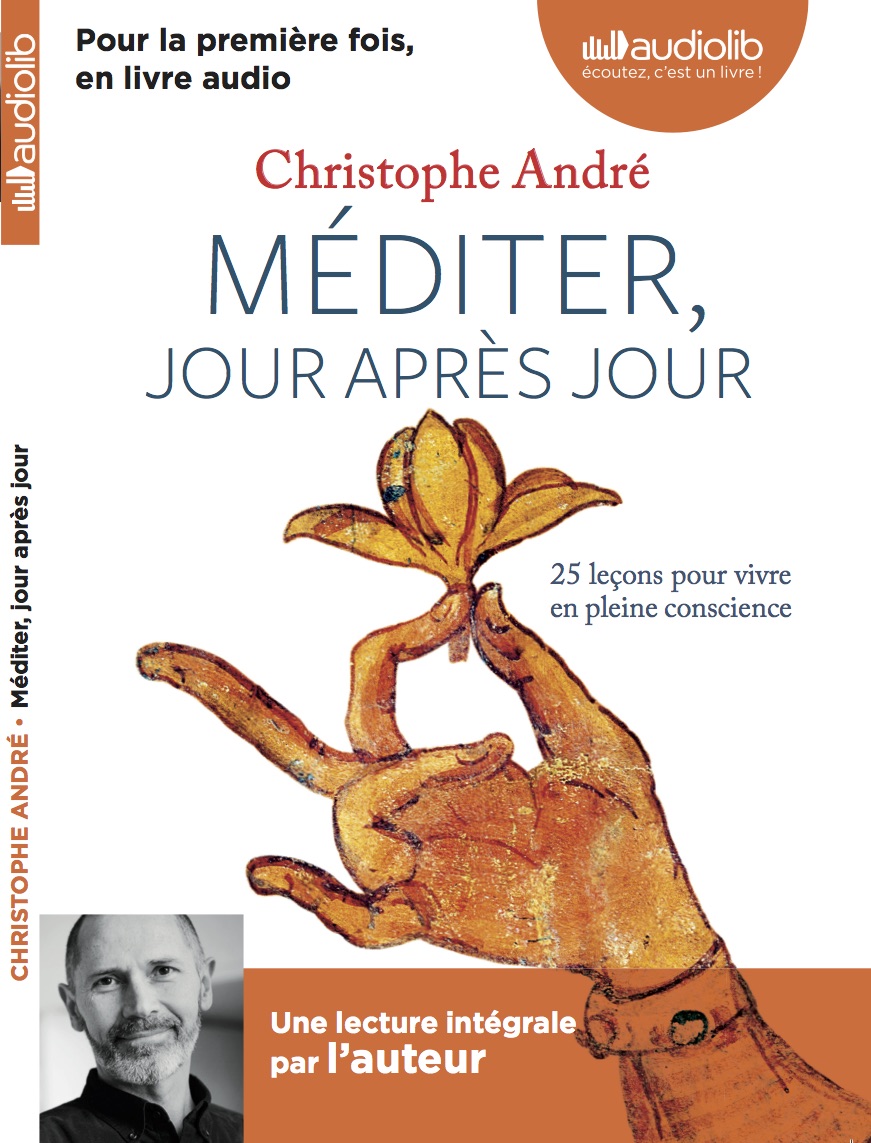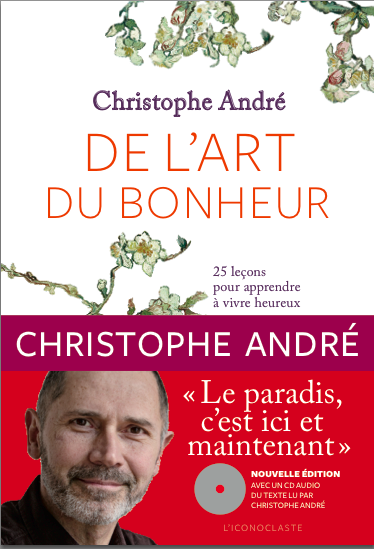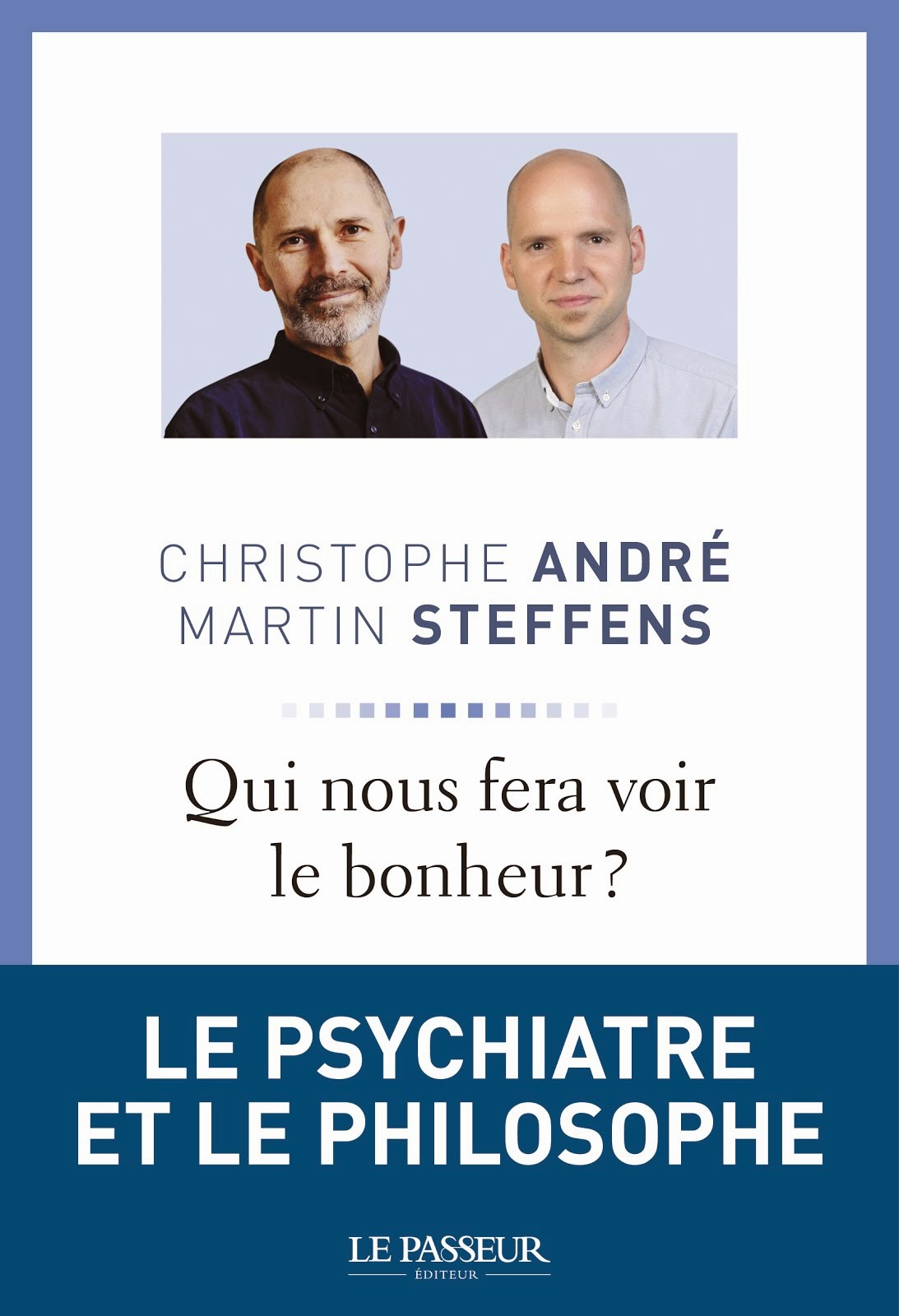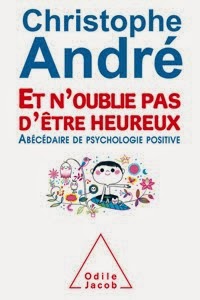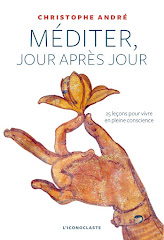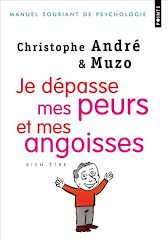Un dimanche matin, en allant faire le marché, je le vois qui attend au bout du trottoir sur lequel je m’avance vers lui, en tirant mon chariot à provisions.
Il ressemble à une sorte de Grand Duduche sans âge qui aurait pris trop de neuroleptiques ; sans doute un patient de l’hôpital psychiatrique voisin. Il me regarde arriver, et trépigne impatiemment. Je comprends qu’il va me demander de l’argent. Mon corps se raidit un peu, hésite à modifier son cap ; puis je me dis : « non, tu ne vas pas changer de trottoir pour éviter de donner 1 ou 2 euros à un mendiant ».
Quand j’arrive à sa hauteur, il m’aborde avec une élocution saccadée, précipitée, malhabile, liée aux médicaments, peut-être à l’anxiété, sûrement à l’impatience. Il veut 2 euros pour s’acheter des cigarettes, il m’annonce le prix et le programme avec sincérité.
Je discute un peu sur son projet : « le tabac, c’est pas terrible pour la santé, vous savez… » Mais il s’en fout complètement, ça ne l’intéresse absolument pas ce que je lui raconte, il répète sa demande encore plus vite. Je comprends que je perds mon temps, il n’a pas envie de discuter mais d’avoir son argent.
Alors je rigole et je sors mon porte-monnaie ; finalement, c’est très bien, je vais lui donner toutes les pièces jaunes qui m’encombrent. Je les verse dans sa main. Il compte alors très vite combien ça fait, et relève la tête vers moi, l’air inquiet : « il manque 40 centimes ! vous pouvez me les donner ? 40 centimes ! parce qu’il me faut 2 euros… »
Je rigole encore plus. Il a raison, après tout, au point où on en est, il peut tenter sa chance. Surtout que c’est encore tôt ce dimanche matin, il risque d’attendre longtemps le prochain passant, sous le sale petit crachin d’hiver.
Voilà, il a exactement ses 2 euros. Très soulagé, il me remercie à peine, et tourne les talons pour foncer vers le petit bistrot juste à côté, acheter et fumer sa dose de poison.
Je ne sais pas bien ce que je ressens. Je suis à la fois touché par sa détresse, sa fragilité ; amusé par son insistance et son culot non calculés, juste dictés par le besoin et le manque ; un peu culpabilisé de lui avoir donné de quoi s’empoisonner ; mais vaguement content quand même de ne pas lui avoir tourné le dos, de ne pas l’avoir laissé attendre dans le froid le prochain passant…
Illustration : il y a comme ça dans notre vie tout plein de petits détails tristes et beaux à la fois (photographie de Florian Kleinefenn).