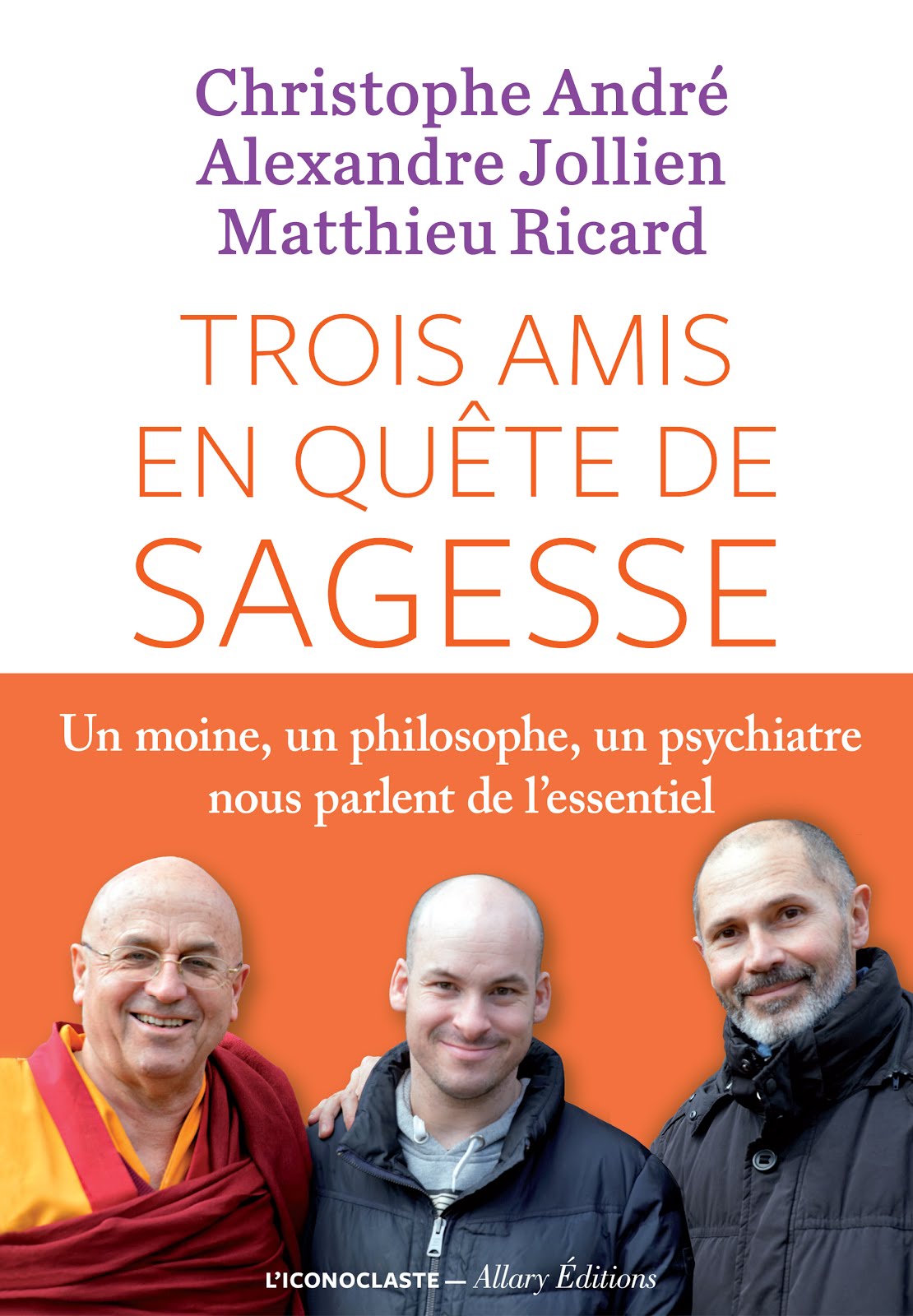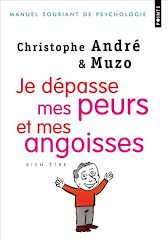Parmi les grands enjeux de toute vie humaine, il y a la traversée de la souffrance. Au fond, vivre n’est pas toujours un truc très gai : vivre, c’est naître, souffrir et puis mourir. « Ici-bas, la douleur à la douleur s’enchaîne / Le jour succède au jour, et la peine à la peine » nous explique joyeusement Lamartine dans ses Méditations.
Bon, heureusement qu’entre les moments de souffrance il y a aussi les moments de bonheur et de bien-être, qui rendent l’ensemble supportable ! Mais savoir affronter et traverser les inévitables souffrances de toute vie humaine reste un enjeu important. Dans ce domaine, notre marge de manœuvre est limitée, mais bien réelle. Pour cela, on fait souvent, par exemple, une distinction pédagogique entre douleur et souffrance.
La douleur, c’est l’ensemble des phénomènes physiques ou matériels à l’origine de nos maux, c’est le réel qui nous fait mal : une blessure ou un dysfonctionnement de notre corps, une maladie, un deuil, un divorce, une adversité concrète ; nous n’inventons alors rien, les sources de la douleur sont bien là, en nous ou autour de nous. Souvent, nous ne pouvons pas grand-chose sur la douleur. En tout cas, nous pouvons rarement la supprimer comme ça, d’un coup.
La souffrance, c’est l’impact sur nous de la douleur, c’est la place qu’elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c’est ce que notre esprit fait de la douleur.
La souffrance, c’est l’impact sur nous de la douleur, c’est la place qu’elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c’est ce que notre esprit fait de la douleur.
Avant de continuer sur mon discours psychologique, je voudrais rappeler une vérité médicale simple : quand la douleur est violente, douleur physique ou douleur morale, les médicaments sont les bienvenus ! Que l’on soit migraineux ou cancéreux, rhumatisant ou agonisant, il est toujours légitime de soulager la douleur ainsi. Mais les médicaments ne sont pas la seule et unique réponse possible.
C’est pourquoi la réflexion sur l’art et la manière d’affronter la douleur en limitant nos souffrances a toujours préoccupé les humains. Choisir la bonne attitude pour traverser les souffrances est ainsi un des fondements du bouddhisme ; savoir leur trouver un sens, est un de ceux du christianisme. Et la psychologie s’attache elle aussi, de son mieux, à aider les patients à ne pas se laisser dominer et asservir par leurs souffrances.
Dans la méditation, par exemple, de nombreux exercices sont destinés à nous entraîner à ne pas laisser toute notre attention se focaliser et se rétrécir sur la seule douleur, et à entraîner notre esprit à ne pas se laisser embarquer par des pensées et des émotions à propos de la douleur.
Toutes les études le confirment : l’apprentissage de la méditation aide à « mieux souffrir » lorsque les douleurs arrivent : « mieux souffrir », c’est-à-dire limiter l’envahissement, l’omniprésence et la dictature de la souffrance. C’est ce que rappelle la philosophe Simone Weil : « Ne pas chercher à ne pas souffrir, mais à ne pas être altéré par la souffrance. »
Je sais, ce n’est pas facile, et rien de plus irritant que les professeurs de douleur qui nous invitent à relativiser, parce que c’est comme ça, parce qu’on n’est pas le seul dans ce cas, etc. Vous connaissez la formule assassine de La Rochefoucauld : « On a toujours assez de force pour supporter les maux d’autrui. » On aimerait bien les voir alors, ces bons conseilleurs, prendre notre place et notre souffrance, et nous faire une petite démonstration de leur savoir-faire !
Face à la douleur, chacune et chacun fait qu’il peut, comme il peut ! Mais chacun fait aussi ce qu’il a appris à faire, d’où l’importance de proposer des approches psychologiques de nature à aider nos patients à moins souffrir. En les laissant libres de se tourner ou non vers ces dernières…
Et vous, quand vous avez très mal à la tête, c’est médicament ou méditation ?
Illustration : " je te dis que j'ai mal, tu es bouché ou quoi ?! "
PS : ce texte reprend ma chronique du 15 octobre 2019 sur France Inter dans l'émission Grand Bien Vous fasse d'Ali Rebeihi.