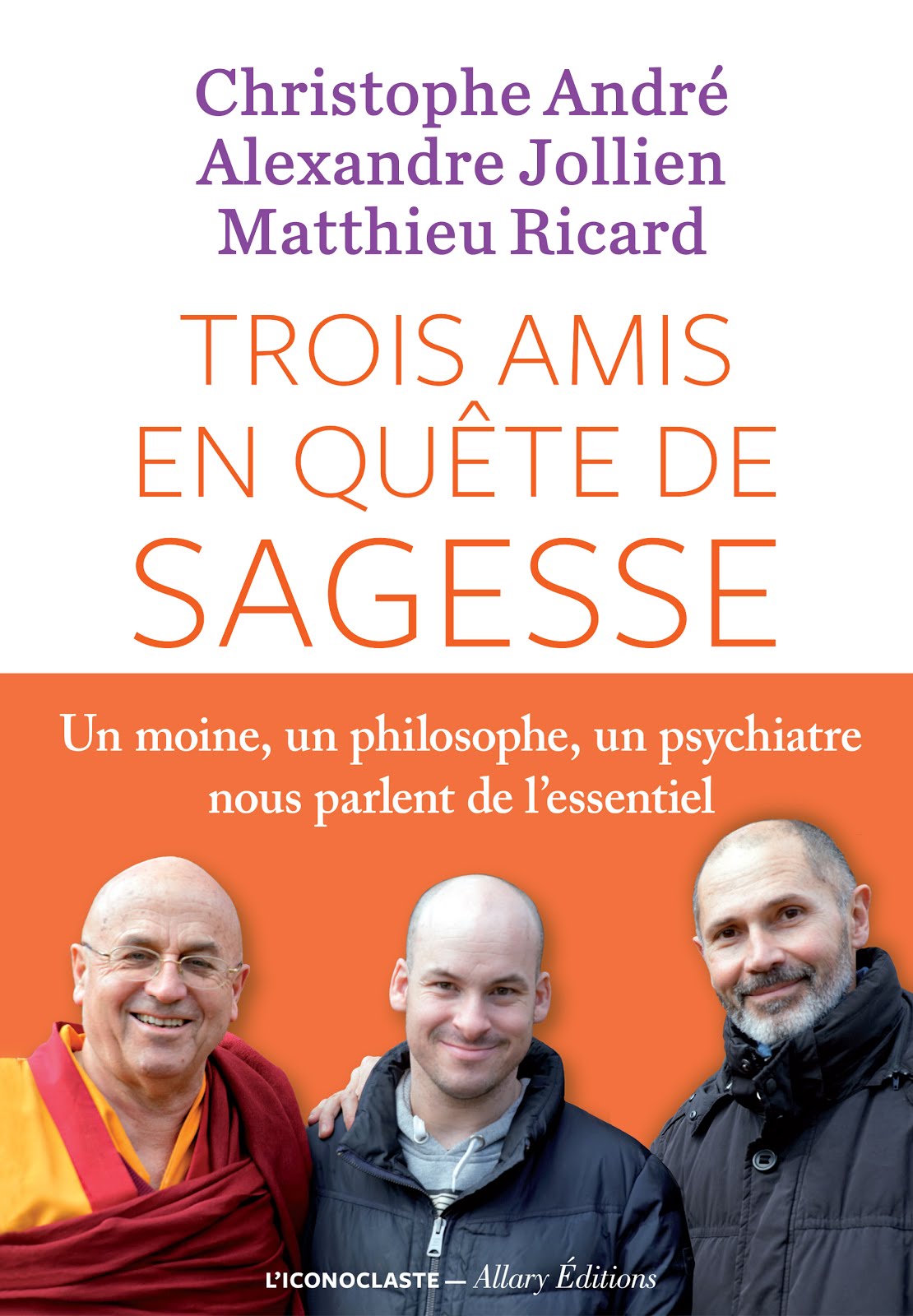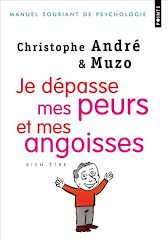C’est un dimanche
après-midi de printemps, ou de début d’été, par grand soleil, sur un lieu de
promenade fréquenté. Je ne sais pas pourquoi je suis là, je trouve qu’il y a
trop de monde et trop de bruits dans ce genre d’endroit, à ce genre de moment.
Mais puisque j’y suis, je regarde mes
frères et sœurs humains, qui déambulent, discutent et interagissent.
Je suis en train de
rattraper un grand groupe, qui marche presque au même rythme que moi. Je
ralentis pour observer et comprendre. Il y a une douzaine de personnes, des parents
et des enfants, sans doute deux familles en vacances ensemble. Tout le monde
est habillé en style prolétaire, sans les codes bon chic bon genre, ni
vestimentaires ni comportementaux.
Un homme d’environ
40 ans, donne régulièrement des coups de pied aux fesses d’une adolescente. Il
s’agit sans doute d’un père, et d’une de ses filles. Rien de dramatique :
malgré les coups de pieds, elle rigole, lui tourne autour, revient ; il
lui botte à nouveau les fesses. Tout le monde s’en amuse, l’ambiance est bon
enfant.
Je me sens mal à
l’aise. Ce qui se passe n’est pas méchant en apparence, ce n’est pas un
conflit, c’est plutôt comme un jeu. Pourtant, j’ai le sentiment d’assister à
quelque chose d’humiliant pour la fillette, même si personne ne semble en
prendre conscience.
Quel
message est en train de se graver dans son esprit ? Que ce n’est pas grave
de se faire botter les fesses, de se faire frapper, du moment qu’on
rigole ensemble ? Est-ce si anodin ? Je me demande si ce genre de
séquence (il doit y en avoir d’autres, à d’autres moments, sur d’autres
registres) ne risque pas de la conduire à développer une tolérance anormale aux
humiliations, aux petites violences. Et à les accepter lorsqu’elles viendront d’autres
personnes que son père : de ses petits copains, de son futur conjoint, de
son futur patron.
J’ai envie de leur
dire d’arrêter. Mais ils rient à un nouveau coup de pied aux fesses, et elle rit
aussi. « Fous-leur la paix, ce sont leurs codes, ils vont te regarder
comme un casse-pied, un intello pisse-vinaigre et donneur de leçons. »
Voilà ce que je me dis, sans doute par lâcheté, ou par paresse. Mais du coup,
je ne veux plus regarder, j’ai l’impression que continuer d’observer, ce serait
cautionner. J’accélère, pour les dépasser et m’éloigner.
Pas fier de moi, avec l’impression de ne pas avoir fait ce que j’aurais du faire. Avec une culpabilité que je ne repousse pas ; je la laisse au contraire me faire un peu de mal. En espérant que sa cicatrice me poussera à intervenir la prochaine fois que je serai témoin d’un truc comme ça : un truc pas révoltant ni scandaleux ; mais source de malaise.
Parce que, maintenant que je suis loin, j’en suis sûr, il y a forcément une blessure et des larmes, tout au fond du cœur de la fillette…
Illustration : des enfants sur un banc, par Gérard Castello-Lopes.
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en octobre 2018.
Pas fier de moi, avec l’impression de ne pas avoir fait ce que j’aurais du faire. Avec une culpabilité que je ne repousse pas ; je la laisse au contraire me faire un peu de mal. En espérant que sa cicatrice me poussera à intervenir la prochaine fois que je serai témoin d’un truc comme ça : un truc pas révoltant ni scandaleux ; mais source de malaise.
Parce que, maintenant que je suis loin, j’en suis sûr, il y a forcément une blessure et des larmes, tout au fond du cœur de la fillette…
Illustration : des enfants sur un banc, par Gérard Castello-Lopes.
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en octobre 2018.