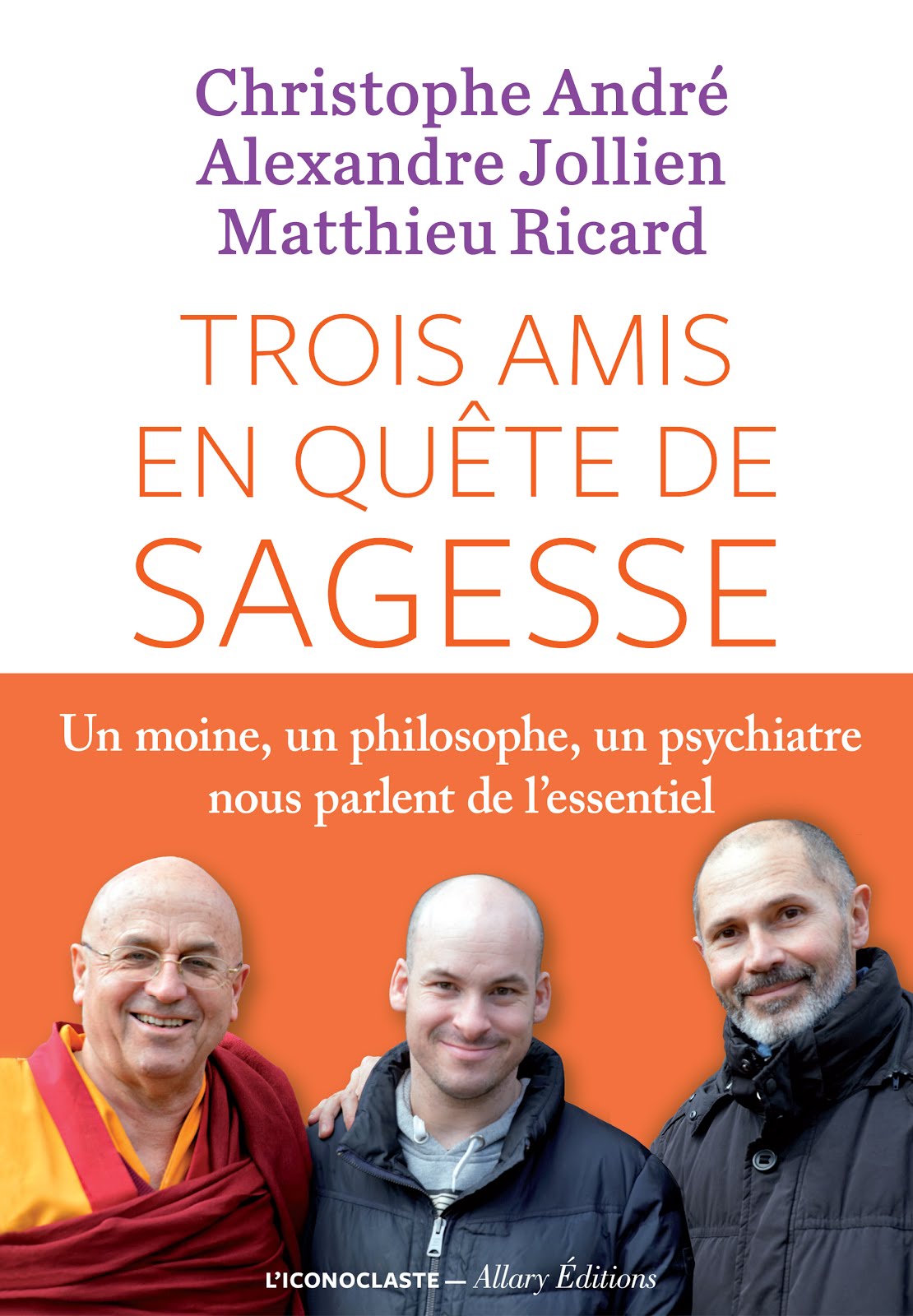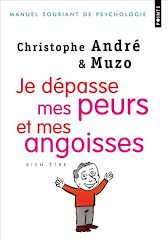vendredi 20 décembre 2019
On se retrouve en 2020 ?
Parmi les paroles poétiques de Christian Bobin, à La Grande Librairie de François Busnel, sur France 2 en décembre 2019, l'une d'elle me revient à cet instant : "La légèreté, c'est parfois une manière élégante d'être grave."
Je vous souhaite de bonnes fêtes, dans la légèreté et la gravité.
Nous nous retrouvons en janvier 2020.
Illustration : un lac au Québec en hiver, par l'ami Rémi Tremblay.
mardi 17 décembre 2019
Manger en pleine conscience
Le tout en observant les pensées apparaissant durant l’exercice (« bizarre ce qu’on nous fait faire… » « à quoi ça sert tout ce cirque ? »), en accueillant les sensations ou impulsions prenant naissance dans le corps (la bouche qui salive, qui a envie d’avaler le grain d’un seul coup). L’exercice dure dix minutes environ ; dix minutes pour déguster un grain de raisin ! Ensuite, quelques questions sont posées à chaque participant : qu’avez-vous ressenti et vécu durant l’exercice ? Procédez-vous habituellement ainsi avec un grain de raisin ? Qu’est-ce qu’une telle attitude (prendre son temps, observer, ressentir) peut éventuellement vous apporter dans la vie ?
La plupart des personnes sont surprises par la richesse de l’exercice : « j’ai ressenti une impression de satiété avec un seul grain de raisin, étonnant ! », « je n’avais jamais réalisé toutes les saveurs contenues dans un grain de raisin sec », « en général, je les avale sans y penser, c’est la première fois que je prends conscience de leur vraie saveur », « je me rends compte que beaucoup de choses dans ma vie fonctionnent sur ce registre : je ne prends jamais le temps de ressentir et de savourer, de ralentir, de m’ouvrir à ce que je fais… »
La méditation de pleine conscience peut apporter beaucoup de changements à notre manière de vivre au quotidien, et c’est d’ailleurs son but : ne pas se limiter à une série d’exercices apaisants, bien séparés de notre vie réelle (un temps pour méditer, puis tout le reste pour stresser !), mais nous transformer, modifier notre manière de vivre et d’être au monde. Et parmi ses mille et une conséquences, figure le changement de notre rapport à la nourriture et l’alimentation.
Trop souvent, nous ne sommes pas présents à ce que nous mangeons, parce que notre attention est tournée ailleurs : vers nos pensées et ruminations, vers des distractions (radio, télé, ou pire, usage d’écrans), vers des discussions (si nous sommes en groupe) ou vers une autre activité.
L’apprentissage de la méditation nous pousse à comprendre qu’il est précieux de régulièrement manger en pleine conscience, et d’être attentif aux aliments et à notre corps. Ce faisant, nous aurons plus de discernement quant à notre envie de manger : véritable faim ? Ou simple réflexe conditionné, envie de manger parce que c’est l’heure, parce que nous sommes stressés, parce que nous nous ennuyons ? Ou encore désir de lien et de partage social ? Se nourrir en pleine conscience nous offre également plus de discernement quant à notre ressenti de satiété : ai-je vraiment besoin de me resservir de ce plat ? Ai-je encore faim ? Est-ce une simple gourmandise ? Ou la pensée qu’il ne faut pas gâcher ou jeter ce qui reste dans mon assiette ? Mais alors pourquoi le jeter dans mon corps plutôt qu’à la poubelle ?
L’apprentissage de la méditation nous pousse à comprendre qu’il est précieux de régulièrement manger en pleine conscience, et d’être attentif aux aliments et à notre corps. Ce faisant, nous aurons plus de discernement quant à notre envie de manger : véritable faim ? Ou simple réflexe conditionné, envie de manger parce que c’est l’heure, parce que nous sommes stressés, parce que nous nous ennuyons ? Ou encore désir de lien et de partage social ? Se nourrir en pleine conscience nous offre également plus de discernement quant à notre ressenti de satiété : ai-je vraiment besoin de me resservir de ce plat ? Ai-je encore faim ? Est-ce une simple gourmandise ? Ou la pensée qu’il ne faut pas gâcher ou jeter ce qui reste dans mon assiette ? Mais alors pourquoi le jeter dans mon corps plutôt qu’à la poubelle ?
C’est simple, n’est-ce-pas ? Simplement manger, en pleine conscience, pleinement présent à ce que nous faisons, ressentons, pensons… Pas forcément à tous les repas, mais régulièrement, une fois ou deux par semaine, prendre son temps, approfondir la rencontre avec notre nourriture, reposer sa fourchette, terminer une bouchée avant de passer à la suivante.
Quel intérêt à cela ?
D’abord, protéger notre santé : aujourd’hui, et sans doute pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une grande partie de la population mondiale (du moins en Occident et dans les pays émergents) n’est plus confrontée à la rareté mais à la pléthore.
La nourriture est omniprésente et relativement bon marché ; il suffit de tendre le bras pour en disposer, sans effort de préparation ou d’accommodation, à toute heure du jour ou de la nuit. Les effets de cette pléthore sont dévastateurs : nous mangeons trop, trop souvent, et mal de surcroît (aliments saturés en sucre, sel et exhausteurs de goût).
De nombreuses études de psychologie expérimentale ont étudié ce qu’on appelle le « régime de cafétéria » : avoir à volonté des aliments attirants car très variés, très salés, très sucrés, etc. Ce type de régime a été proposé à des rats de laboratoire (dont l’alimentation et le métabolisme sont très proches des nôtres) : des souches de rats jumeaux sont confrontées soit à un régime normal soit au « régime de cafétéria » ; dans les deux cas, ils ont accès libre à la nourriture.
Les résultats sont nets : les rats de cafétéria deviennent très rapidement obèses et diabétiques. Et encore, ils ne regardent pas la télé et ne sont pas exposés à des publicités les incitant à grignoter à toute heure pour éviter les coups de pompe… Les humains, si !
D’où une épidémie de diabète et d’obésité inquiétante dans tous les pays soumis à cette martingale infaillible : pléthore de mauvaise nourriture, sur fond d’incitations multiples à trop manger, et trop souvent. Manger en pleine conscience nous immunise peu à peu face à ces incitations et impulsions à tout avaler machinalement. En pleine conscience, on réalise beaucoup mieux que ce que l’on mange est trop gras, trop sucré, trop artificiel, et que l’on mange trop, trop vite.
D’abord, protéger notre santé : aujourd’hui, et sans doute pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une grande partie de la population mondiale (du moins en Occident et dans les pays émergents) n’est plus confrontée à la rareté mais à la pléthore.
La nourriture est omniprésente et relativement bon marché ; il suffit de tendre le bras pour en disposer, sans effort de préparation ou d’accommodation, à toute heure du jour ou de la nuit. Les effets de cette pléthore sont dévastateurs : nous mangeons trop, trop souvent, et mal de surcroît (aliments saturés en sucre, sel et exhausteurs de goût).
De nombreuses études de psychologie expérimentale ont étudié ce qu’on appelle le « régime de cafétéria » : avoir à volonté des aliments attirants car très variés, très salés, très sucrés, etc. Ce type de régime a été proposé à des rats de laboratoire (dont l’alimentation et le métabolisme sont très proches des nôtres) : des souches de rats jumeaux sont confrontées soit à un régime normal soit au « régime de cafétéria » ; dans les deux cas, ils ont accès libre à la nourriture.
Les résultats sont nets : les rats de cafétéria deviennent très rapidement obèses et diabétiques. Et encore, ils ne regardent pas la télé et ne sont pas exposés à des publicités les incitant à grignoter à toute heure pour éviter les coups de pompe… Les humains, si !
D’où une épidémie de diabète et d’obésité inquiétante dans tous les pays soumis à cette martingale infaillible : pléthore de mauvaise nourriture, sur fond d’incitations multiples à trop manger, et trop souvent. Manger en pleine conscience nous immunise peu à peu face à ces incitations et impulsions à tout avaler machinalement. En pleine conscience, on réalise beaucoup mieux que ce que l’on mange est trop gras, trop sucré, trop artificiel, et que l’on mange trop, trop vite.
Ensuite, manger en pleine conscience fait de nous des humains plus avisés et respectueux de leur environnement, en nous aidant à comprendre la valeur de tout ce qu’il y a dans notre assiette. D’où viennent ces fruits et ces légumes ? À qui les ai-je achetés ? Qui les a cultivés, cueillis, acheminés vers moi ? Puis-je prendre conscience de tout ce qu’il a fallu de bienfaits de la Nature, et d’efforts humains, pour que cette nourriture arrive dans mon assiette ? Ce serait une erreur et une faute de ne pas la respecter. Et la respecter, c’est la savourer, ne manger que ce dont mon corps a besoin, ne pas la gaspiller, et la partager…
Notre société a brisé notre rapport à la nourriture, nous a fait oublier son caractère sacré : reprenons-en conscience !
Notre société a brisé notre rapport à la nourriture, nous a fait oublier son caractère sacré : reprenons-en conscience !
Santé et sacré, voilà pourquoi il est précieux de régulièrement revenir à la présence et à la conscience : dans le silence et la lenteur, se recueillir pour savourer chaque bouchée. En observant son corps. En interrogeant son esprit. En se sentant heureux d’être en vie.
Illustration : on peut aussi cuisiner en pleine conscience !
PS cet article a été publié dans la revue Sens & Santé au printemps 2019.
mercredi 11 décembre 2019
Le sommeil des justes
À l’âge de 20 ans, l’écrivain Cioran perd – définitivement, dit-il - le sommeil.
Après inquiétudes et désolations à ce propos, il s’en accommode, bon an mal an, considérant qu’il s’agit d’une situation irrémédiable, et oscillant entre moments d’acceptation : «On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil » ; et moments d’inquiétude : « Bien plus que le temps, c'est le sommeil qui est l'antidote du chagrin. L'insomnie, en revanche, qui grossit la moindre contrariété et la convertit en coup du sort, veille sur nos blessures et les empêche de dépérir ».
Beaucoup d’autres artistes ou créateurs sont connus pour leurs insomnies, comme Marcel Proust, qui devint très tôt toxicomane des divers somnifères administrés par ses médecins. Quelle aura été la part de leurs troubles du sommeil dans leur créativité ? Bien difficile à évaluer…
Le sommeil est bien évidemment une nécessité pour les humains, et cela ne concerne pas seulement leur bien-être, mais aussi leurs capacités intellectuelles et émotionnelles, et également leur santé globale. Bien dormir est non seulement agréable, mais aussi réparateur et protecteur. Or, le sommeil est une fonction très fragile, qui peut se dérègler sous l’influence de nombreux facteurs.
Certains viennent de nous, ou de la manière dont nous accueillons le monde en nous : nos préoccupations, concernant la journée écoulée (tout ce que nous n’avons pas fait ou mal fait) ou à venir (ce qui nous attend le lendemain : ah ! les insomnies du dimanche soir…), nos émotions, qu’elles soient douloureuses (pas facile de s’endormir le cerveau plein de colère ou de tristesse) ou heureuses (l’excitation de la joie et des projets est incompatible avec le relâchement nécessaire au sommeil).
D’autres sont exogènes, liés à des influences extérieures : avoir vécu trop d’événements stimulants peu avant l’heure du coucher, ou s’être exposé aux écrans, à leurs informations, à leurs stimulations…
D’autres sont exogènes, liés à des influences extérieures : avoir vécu trop d’événements stimulants peu avant l’heure du coucher, ou s’être exposé aux écrans, à leurs informations, à leurs stimulations…
On découvre alors toutes les facettes de l’insomnie : difficultés à s’endormir, ou difficultés à se rendormir après un petit éveil nocturne.
C’est que le sommeil, comme beaucoup de nos fonctions vitales, n’obéit pas si facilement à notre volonté. Il ne se déclenche pas sur commande.
Au contraire : c’est ce que savent bien tous les hypocondriaques du sommeil, ces personnes très inquiètes de ne pas bien dormir. Plus elles se couchent en se disant : « pourvu que j’arrive à bien dormir cette nuit, pourvu que le sommeil vienne vite, pourvu que je ne me réveille pas au milieu de la nuit… » et plus elles ont du mal à dormir : leurs attentes excessives et inquiètes perturbent leurs capacités à s’endormir.
Au contraire : c’est ce que savent bien tous les hypocondriaques du sommeil, ces personnes très inquiètes de ne pas bien dormir. Plus elles se couchent en se disant : « pourvu que j’arrive à bien dormir cette nuit, pourvu que le sommeil vienne vite, pourvu que je ne me réveille pas au milieu de la nuit… » et plus elles ont du mal à dormir : leurs attentes excessives et inquiètes perturbent leurs capacités à s’endormir.
C’est parce que le sommeil est un état émergent de notre cerveau, comme la sérénité ou le bonheur ; il ne peut se déclencher sur commande ou sous l’effet de la volonté, mais il ne survient que quand, et seulement quand, un certain nombre de conditions sont réunies : une pièce calme, sombre, un esprit apaisé, une journée passée stimulante mais pas excitante, un certain degré de lâcher-prise et de confiance dans ses capacités à s’endormir, etc.
On ne peut donc déclencher le sommeil, mais on peut en faciliter la venue. Parmi les courants psychothérapiques récents, deux offrent d’intéressantes perspectives en la matière : la psychologie positive et la méditation de pleine conscience.
En psychologie positive, on recommande de pratiquer avant de s’endormir un exercice d’immersion dans les émotions agréables : songer à trois petits événements de la journée (mêmes bénins, et même les jours stressants ou compliqués) qui nous ont réjoui, touché ou fait du bien. Y songer en faisant participer tout son être : en observant comment leur évocation se manifeste dans notre corps, comment notre souffle les accompagne, en se remémorant les détails précis de ces instants…
Cet exercice peut aussi se pratiquer avec la gratitude : penser à un geste venant d’autrui qui nous a aidé ou apaisé ou amusé ; remercier alors la personne ; savourer - dans son esprit et dans son corps - ce souvenir d’avoir reçu de l’attention, de la bienveillance, de l’affection. Ces émotions positives non seulement détendent corps et esprit, mais écartent aussi les inquiétudes, aussi sûrement qu’un anticyclone repousse les nuages.
Cet exercice peut aussi se pratiquer avec la gratitude : penser à un geste venant d’autrui qui nous a aidé ou apaisé ou amusé ; remercier alors la personne ; savourer - dans son esprit et dans son corps - ce souvenir d’avoir reçu de l’attention, de la bienveillance, de l’affection. Ces émotions positives non seulement détendent corps et esprit, mais écartent aussi les inquiétudes, aussi sûrement qu’un anticyclone repousse les nuages.
En méditation de pleine conscience, un exercice classique pour faciliter (mais non garantir !) l’endormissement, et aussi les rendormissements dans la nuit, est le « scanner du corps » : se rendre présent à son corps, en le passant en revue, lentement, en détail, des pieds à la tête, tout en suivant tranquillement ses mouvements respiratoires.
L’idée est de ne pas chercher à s’endormir, mais à poser son attention sur le souffle et le corps, avec patience et bienveillance.
Si des pensées d’impatience (« il faut que je me rendorme le plus vite possible ») ou d’inquiétude (« c’est la catastrophe si je ne suis pas en forme pour demain ») surviennent, prendre garde de ne pas les nourrir de son attention, mais ramener inlassablement celle-ci sur la conscience de la respiration et des sensations corporelles.
Accepter tout au fond de soi la possibilité de ne pas s’endormir tout de suite, ou de moins dormir qu’on ne le voudrait, mais se rappeler ceci : « quitte à ne pas, ou pas assez dormir, mieux vaut alors passer ce temps d’éveil apaisé qu’énervé ».
L’idée est de ne pas chercher à s’endormir, mais à poser son attention sur le souffle et le corps, avec patience et bienveillance.
Si des pensées d’impatience (« il faut que je me rendorme le plus vite possible ») ou d’inquiétude (« c’est la catastrophe si je ne suis pas en forme pour demain ») surviennent, prendre garde de ne pas les nourrir de son attention, mais ramener inlassablement celle-ci sur la conscience de la respiration et des sensations corporelles.
Accepter tout au fond de soi la possibilité de ne pas s’endormir tout de suite, ou de moins dormir qu’on ne le voudrait, mais se rappeler ceci : « quitte à ne pas, ou pas assez dormir, mieux vaut alors passer ce temps d’éveil apaisé qu’énervé ».
Ainsi, mieux vaut prendre soin de son sommeil un peu à l’avance, en se protégeant des stimulations, informations et distractions des écrans quelques heures avant d’aller au lit, et en se livrant aux petits exercices que nous venons d’évoquer.
Et en prenant soin de séparer nos activités du jour de celles de la nuit : nous aborderons ce qui nous préoccupe demain, et pour le moment nous nous accordons le repos et l’énergie nécessaire pour mieux l’affronter, justement.
Dans son roman La Vie devant soi, Romain Gary (sous le pseudonyme d’Émile Ajar), abordait ainsi le problème : " Le sommeil du juste... Je crois que c'est les injustes qui dorment le mieux, parce qu'ils s'en foutent, alors que les justes ne peuvent pas fermer l'oeil et se font du mauvais sang pour tout."
Même les justes, même les gentils peuvent avoir des insomnies, pour peu qu’ils se préoccupent de justice au moment où il faudrait plutôt se préoccuper de sommeil…
Illustration : un rêve (photo tirée du film "L'homme de Londres", du cinéaste hongrois Béla Tarr).
PS : cet article a été publié dans la revue (disparue hélas) Sens & Santé, à l'automne 2019.
jeudi 5 décembre 2019
Notre inépuisable besoin de bienveillance
Attention, attention : ceci est une chronique sur la bienveillance envers soi-même ! Je préviens, parce que sais que la bienveillance, il y a plein de gens que ça énerve. Je m’en fiche, c’est trop important pour ne pas en parler. Alors, si vous en avez marre de la psychologie positive, faites-vous du bien : changez de page, allez lire des choses plus méchantes, ça ne manque pas sur le Web…
Comment définir la bienveillance ? On pourrait dire que c’est essayer à chaque fois que possible d’adopter un regard, un discours ou une manière d’être qui font du bien aux autres : se montrer gentil et compréhensif, faire preuve d’écoute et de douceur, s’attacher à voir les bons côtés des gens plutôt que les mauvais, etc.
Pourquoi se montrer bienveillant ? « Marre de la dictature du bonheur, de la moraline et des bons sentiments ! » crient souvent les grincheuses et les grincheux.
Eh bien moi, je n’en ai pas marre de la bienveillance, jamais : quand je vois combien la vie n’est pas facile, quand je vois toutes les adversités, les souffrances et les maladies que chaque humain doit affronter, je sais que la bienveillance a encore de beaux jours devant elle, car elle est un besoin universel.
Eh bien moi, je n’en ai pas marre de la bienveillance, jamais : quand je vois combien la vie n’est pas facile, quand je vois toutes les adversités, les souffrances et les maladies que chaque humain doit affronter, je sais que la bienveillance a encore de beaux jours devant elle, car elle est un besoin universel.
Qui se réveille le matin en se disant « pourvu qu’on soit malveillant et méchant avec moi aujourd‘hui » ? Nos attentes, c’est plutôt d’espérer rencontrer des gens sympathiques et bienveillants. Nos attentes, c’est recevoir de l’amour plutôt que de la haine, de l’attention plutôt que de l’inattention, de la bienveillance plutôt que de l’indifférence.. Surtout quand on est seul, fragile, amoindri, malade…
Car quiconque a fait l’expérience de la maladie grave sait qu’il est fou de critiquer la bienveillance et la gentillesse : car en recevoir de la part de ses proches, des soignants, des inconnus que l’on croise, devient alors indispensable. La bienveillance ne nous guérit peut-être pas, à elle toute seule, mais elle rend l’expérience de la maladie moins destructrice et moins démoralisante.
Ça, c’est la bienveillance que les autres nous offrent, mais il y a aussi celle que nous nous devons à nous-même, celle que nous devons à notre corps, même malade, même défaillant, même décevant.
Souvent, lorsqu’on est malade, on ressent de l’agacement, de la colère contre soi, contre ce corps qui nous trahit, nous handicape, nous empêche d’agir, nous fait mal. Mais ces émotions négatives aggravent encore la situation, et amplifient la douleur.
D’où des travaux de recherche sur les bienfaits de la bienveillance envers soi et son corps : accepter la souffrance, chercher à se faire du bien plutôt que des reproches, lâcher prise par rapport à tout ce que la maladie nous empêche de faire, et tourner au contraire son énergie vers la douceur et l’espérance du soulagement, ou de la guérison.
Ce qu’on ferait en gros pour un proche ou un enfant, à qui on dirait : « ce n’est pas drôle d’être malade, mais c’est encore moins drôle d’être en colère contre la maladie, ou anxieux, ou désespéré ; ne t’en veux pas, prends soin de toi, accepte la maladie, accepte le repos, accepte les soins, et une part de tes souffrances reculera… »
C’est compliqué d’être malade dans nos modes de vie contemporains, où toutes nos activités sont planifiées, enchaînées, organisées, dans nos sociétés où il n’y a plus de place pour l’imprévu, et où la maladie est considérée comme une anomalie, parfois même comme un échec…
La maladie, comme toute souffrance, est une malchance ; et, sauf pour les très grands veinards, elle est inévitable dans toute vie humaine. Alors autant ne pas s’infliger une double peine : à la peine de la maladie, ajouter la peine de la colère ou du désespoir, et celle du ressentiment contre soi.
Illustration : un petit être humain qui a besoin de bienveillance.
PS : ce texte reprend ma chronique du 19 novembre 2019 sur France Inter, dans l'émission d'Ali Rebeihi, Grand Bien vous Fasse.
Illustration : un petit être humain qui a besoin de bienveillance.
PS : ce texte reprend ma chronique du 19 novembre 2019 sur France Inter, dans l'émission d'Ali Rebeihi, Grand Bien vous Fasse.
jeudi 28 novembre 2019
Science et santé
« Désolé, docteur, mais je ne suis pas très motivé(e) pour prendre des corticoïdes (ou des antidépresseurs, ou des antibiotiques) ni pour me faire vacciner… ». Autrefois, les médecins rédigeaient des ordonnances (eh oui, c’est la même racine étymologique que donner des ordres), et les patients leur obéissaient.
C’est de moins en moins le cas aujourd’hui.
Cela agace certains soignants, qui s’insurgent parfois contre ces nouvelles générations de « consommateurs de soins ».
Cela en réjouit d’autres, dont je suis, qui estiment que, même si ça nous complique un peu la vie (nous avons parfois vraiment besoin de prendre des corticoïdes, des antidépresseurs, des antibiotiques ou de nous faire vacciner) mieux vaut des patients informés et motivés que des patients passifs, non impliqués et simplement obéissants. La santé ne doit plus être seulement l’affaire des soignants, mais aussi celle des patients. Tout comme la démocratie ne doit plus être seulement l’affaire des politiques, mais aussi celle des citoyens.
C’est de moins en moins le cas aujourd’hui.
Cela agace certains soignants, qui s’insurgent parfois contre ces nouvelles générations de « consommateurs de soins ».
Cela en réjouit d’autres, dont je suis, qui estiment que, même si ça nous complique un peu la vie (nous avons parfois vraiment besoin de prendre des corticoïdes, des antidépresseurs, des antibiotiques ou de nous faire vacciner) mieux vaut des patients informés et motivés que des patients passifs, non impliqués et simplement obéissants. La santé ne doit plus être seulement l’affaire des soignants, mais aussi celle des patients. Tout comme la démocratie ne doit plus être seulement l’affaire des politiques, mais aussi celle des citoyens.
Les patients ne sont pas devenus des « consommateurs de soins » seulement à cause de l’influence des médias, et des fake news du Web à propos de la santé. Un certain nombre de causes entremêlées ont transformé peu à peu leurs raisonnements et leurs comportements à propos de leur santé. J’en ai recensé au moins six…
Premièrement : la santé est devenue un sujet de plus en plus important à nos yeux. On s’en remettait autrefois à la fatalité ; ce n’est plus le cas. De plus en plus de personnes sont convaincues qu’elles peuvent faire quelque chose pour améliorer leur santé, et donc leur longévité et leur qualité de vie. Et elles ont raison : ce que nous faisons, mangeons, ressentons, ce que nous disons et nous répétons, tout cela joue un rôle et influence notre santé.
Deuxièmement : même si une forte tendance à déléguer existe dans nos sociétés, du moins quand on en a les moyens (payer une femme de ménage, une baby-sitter, un coach scolaire, un jardinier…), ce n’est pas le cas pour notre santé : nul ne peut s’en occuper à notre place ! La pratique de « comportements de santé » auto-produits (marcher, méditer, cuisiner…) va donc prendre une place croissante dans nos vies (et tant mieux si cela prend la place du temps passé devant les écrans !).
Troisièmement : les conceptions longtemps défendues par la médecine occidentale contemporaine (attendre que la maladie survienne et s’en occuper alors très vigoureusement) sont aujourd’hui considérées comme insuffisantes. Prévenir vaut mieux que guérir. Et en tout cas, il faut savoir prévenir ET guérir. La prévention, c’est plus souvent le rôle des patients, la guérison plus souvent celui des médecins.
Quatrièmement : de nombreuses, et très fréquentes, pathologies chroniques (hypertension artérielle, diabète de type II, maladies auto-immunes, etc.) sont sensibles aux modifications favorables de mode de vie (exercice physique, alimentation équilibrée, diminution du stress), qui dans de nombreux cas permettraient d’éviter le recours aux médicaments.
Cinquièmement : nous disposons aujourd’hui d’une meilleure connaissance des limites des médicaments : les antidépresseurs ne guérissent que deux tiers des patients, et hélas de nombreux effets secondaires existent à peu près pour toutes les molécules ; certains de ces effets indésirables sont parfois supérieurs aux bénéfices attendus. D’où une plus grande prudence dans les prescriptions médicales, et une plus grande attention prêtée aux solutions « naturelles », pour remplacer les médicaments ou pour en prendre moins.
Sixièmement : des études scientifiques en nombre croissant sont justement en train de valider l’intérêt de formes de soins jadis considérées comme folkloriques ou peu efficaces. La méditation, le rôle de l’alimentation, la marche, le contact avec la nature, la phytothérapie, les émotions, le lien social : tous ces domaines sont l’objet de recherches convaincantes, montrant qu’il s’agit de démarches très bénéfiques pour notre santé, notre immunité, etc.
Ce dernier point est décisif, légitimement. Il est celui qui fait peu à peu basculer les médecins et les soignants du côté du recours à ce qu’ils nomment désormais médecines complémentaires. Non pas « alternatives », car il ne s’agit pas de renoncer à la médecine occidentale moderne, qui garde tout son intérêt dans la plupart des pathologies aigues ou menaçantes, mais « complémentaires » : s’ajoutant à ce qui existe en matière de soins officiellement recommandés.
Cette validation scientifique reste importante. Car il y a tout de même, dans le champ des médecines traditionnelles et alternatives, nombre de zones d’ombre, et de démarches inefficaces ou ne reposant sur aucune donnée sérieuse. Ce n’est pas forcément une raison pour les interdire (les preuves viendront peut-être un jour) mais c’en est une pour prévenir les patients, par une mention telle que : « à ce jour, aucune étude scientifique rigoureuse n’a montré l’efficacité de ce produit / cette méthode ». À chacun(e) ensuite de faire son choix !
Dans cette optique, il est important que le monde de la science ne soit pas rejetant, mais accueillant, et plutôt dans la démarche que je nomme « scepticisme bienveillant » : ne rien rejeter a priori, mais ne rien gober sans données… Ne pas forcément exiger des preuves irréfutables, mais demander au moins un faisceau d’indices encourageants. Comme ceux qui existaient au tout début en faveur de la méditation, et qui peu à peu se sont considérablement enrichis, jusqu’à la reconnaissance officielle dont elle bénéficie aujourd’hui.
Dans cette optique, il est important que le monde de la science ne soit pas rejetant, mais accueillant, et plutôt dans la démarche que je nomme « scepticisme bienveillant » : ne rien rejeter a priori, mais ne rien gober sans données… Ne pas forcément exiger des preuves irréfutables, mais demander au moins un faisceau d’indices encourageants. Comme ceux qui existaient au tout début en faveur de la méditation, et qui peu à peu se sont considérablement enrichis, jusqu’à la reconnaissance officielle dont elle bénéficie aujourd’hui.
Les pratiques de santé de demain s’appuieront forcément sur des évaluations scientifiques. Mais elles relèveront, tout aussi forcément, d’une démarche écologique. Elles s’appuieront sur les ressources de l’esprit et du corps : les pouvoirs d’auto-guérison et d’autoréparation. Elles s’appuieront aussi sur les ressources de la nature : mieux utiliser les plantes, notamment pour les soins du quotidien. Elles s’appuieront enfin sur les aptitudes léguées par l’évolution de notre espèce au travers des millénaires : nous sommes équipés pour jeûner, marcher, aimer ; et nous livrer à ces activités fait du bien à toute notre personne, corps et esprit.
Tradition et intuition nous le chuchotaient, la science nous le confirme. Qu’attendons-nous de plus ?
PS : cet article a été publié dans la revue (disparue, hélas) Sens & Santé, en été 2018.
jeudi 21 novembre 2019
Personnalités toxiques
Le monde est divers et varié, comment pourrait-on s’y ennuyer ? Prenez les humains, par exemple, et parmi eux les casse-pieds…
Il y a les les auto-centrés, qui vous racontent tout d’eux mais ne vous posent jamais la moindre question sur vous.
Il y a les narcissiques, qui vous font à chaque rencontre l’étalage de leurs compétences et de leurs succès, et qui commencent toutes leurs phrases par « eh bien moi je… ».
Il y a les négativistes qui commencent les leurs, de phrases, par « oui, mais… non ! »
Les plaintifs qui vous considèrent comme un réceptacle à jérémiades.
Les gros lourds qui insistent, les raconteurs inlassables de blagues et d’histoires, qui embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante…
Il y a les narcissiques, qui vous font à chaque rencontre l’étalage de leurs compétences et de leurs succès, et qui commencent toutes leurs phrases par « eh bien moi je… ».
Il y a les négativistes qui commencent les leurs, de phrases, par « oui, mais… non ! »
Les plaintifs qui vous considèrent comme un réceptacle à jérémiades.
Les gros lourds qui insistent, les raconteurs inlassables de blagues et d’histoires, qui embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante…
Le monde des casse-pieds est comme celui des insectes : d’une diversité infinie ! Et comme les insectes, les observer et les étudier est quelque chose de très intéressant ; et de très utile. Ne serait-ce que pour savoir s’en défendre, lorsque ces casse-pieds deviennent des personnalités toxiques, susceptibles de nous faire souffrir ou parfois même de nous détruire.
Mais ce qui est aussi très intéressant et très utile, c’est de nous observer nous-même, face à eux. Par exemple, observer nos manières de nous comporter avec eux, qui oscillent selon les moments, selon qu’on soit en forme ou non.
Dans nos bons jours, quand on a bien dormi et qu’on est de bonne humeur, nous avons l’envie de les comprendre, et la capacité d’avoir de la compassion pour eux. Nous pouvons nous rappeler cette belle phrase de Christian Bobin : « Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu’elle a déjà plusieurs fois traversé l’enfer. » Nous pouvons nous souvenir du mot de Socrate, disant « nul n’est méchant volontairement », et nous convaindre que cela s’applique aussi, sans doute, aux casse-pieds.
Mais dans nos mauvais jours, quand on a déjà notre lot de soucis et d’ennuis, ce n’est plus l’envie de les comprendre qui nous habite, mais celle de les fuir ou de leur remonter les bretelles. Parfois même, l’envie de les voir disparaître à jamais de notre univers…
Alors, face aux gens toxiques, avant d’être exaspérés ou épuisés, avant d'en arriver au pire et de nous dire « J's'rai content quand il s'ra mort » , songeons à nous poser les bonnes questions.
Certes, le « pourquoi ? » compte. Pourquoi les personnalités toxiques sont-elles toxiques ? Que s’est-il passé dans leur passé ? Le casse-pieds nous fait du mal parce qu’il va mal, c’est clair. C’est toujours bien de le comprendre et d’en tenir compte. Mais c’est aussi risqué si on en reste là : pourquoi supporter un pervers comme conjoint, au prétexte qu’il a eu une enfance malheureuse ?
Alors, après le « pourquoi est-il comme ça ? » vient le temps du « comment ? ». Comment se fait-il que rien ne change ? Comment raisonnent les personnalités toxiques ? Comment les transformer ou comment s’en protéger ? Comment faire, tout simplement…
Il y a de nombreuses options, que l’on peut résumer en 4 grandes directions :
On peut entreprendre de les aider à changer leur personnalité. De l’avis général, mieux vaut laisser ce travail difficile aux thérapeutes.
On peut, ce qui est plus réaliste, s’occuper de changer leurs comportements problèmes avec nous. Leur signaler que ces comportements nous dérangent et ouvrir le dialogue à ce propos. C’est déjà un chantier ambitieux, qui requiert beaucoup de ténacité et d’affirmation de soi.
On peut aussi préférer la protection de soi, et s’attacher à les tenir à distance et à s’en écarter, chaque fois que c’est possible.
Enfin, il y a ce à quoi on pense moins souvent : on peut s’inspirer des casse-pieds !
Oui, s’en inspirer ! Les personnalités toxiques sont de très bons contre-modèles. Si quelqu’un nous agace, une bonne idée est de bien l’observer pour chercher à lui ressembler… le moins possible ! Et donc commencer par chercher en quoi, sans nous en rendre compte, nous lui ressemblons – peut-être - un peu !
Comme l’écrit cruellement La Rochefoucauld : « Si nous n’avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez autrui. » Voilà au moins un service que ceux qui nous dérangent peuvent nous rendre…
On peut entreprendre de les aider à changer leur personnalité. De l’avis général, mieux vaut laisser ce travail difficile aux thérapeutes.
On peut, ce qui est plus réaliste, s’occuper de changer leurs comportements problèmes avec nous. Leur signaler que ces comportements nous dérangent et ouvrir le dialogue à ce propos. C’est déjà un chantier ambitieux, qui requiert beaucoup de ténacité et d’affirmation de soi.
On peut aussi préférer la protection de soi, et s’attacher à les tenir à distance et à s’en écarter, chaque fois que c’est possible.
Enfin, il y a ce à quoi on pense moins souvent : on peut s’inspirer des casse-pieds !
Oui, s’en inspirer ! Les personnalités toxiques sont de très bons contre-modèles. Si quelqu’un nous agace, une bonne idée est de bien l’observer pour chercher à lui ressembler… le moins possible ! Et donc commencer par chercher en quoi, sans nous en rendre compte, nous lui ressemblons – peut-être - un peu !
Comme l’écrit cruellement La Rochefoucauld : « Si nous n’avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez autrui. » Voilà au moins un service que ceux qui nous dérangent peuvent nous rendre…
Et vous, ils vous inspirent et vous aident à progresser, les casse-pieds et autres personnalités toxiques de votre quotidien ?
Illustration : tirée de notre manuel de survie "Je résiste aux personnalités toxiques".
PS : ce texte reprend ma chronique du 5 novembre 2019 sur France Inter dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi.
lundi 28 octobre 2019
Douleur et souffrance
Parmi les grands enjeux de toute vie humaine, il y a la traversée de la souffrance. Au fond, vivre n’est pas toujours un truc très gai : vivre, c’est naître, souffrir et puis mourir. « Ici-bas, la douleur à la douleur s’enchaîne / Le jour succède au jour, et la peine à la peine » nous explique joyeusement Lamartine dans ses Méditations.
Bon, heureusement qu’entre les moments de souffrance il y a aussi les moments de bonheur et de bien-être, qui rendent l’ensemble supportable ! Mais savoir affronter et traverser les inévitables souffrances de toute vie humaine reste un enjeu important. Dans ce domaine, notre marge de manœuvre est limitée, mais bien réelle. Pour cela, on fait souvent, par exemple, une distinction pédagogique entre douleur et souffrance.
La douleur, c’est l’ensemble des phénomènes physiques ou matériels à l’origine de nos maux, c’est le réel qui nous fait mal : une blessure ou un dysfonctionnement de notre corps, une maladie, un deuil, un divorce, une adversité concrète ; nous n’inventons alors rien, les sources de la douleur sont bien là, en nous ou autour de nous. Souvent, nous ne pouvons pas grand-chose sur la douleur. En tout cas, nous pouvons rarement la supprimer comme ça, d’un coup.
La souffrance, c’est l’impact sur nous de la douleur, c’est la place qu’elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c’est ce que notre esprit fait de la douleur.
La souffrance, c’est l’impact sur nous de la douleur, c’est la place qu’elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c’est ce que notre esprit fait de la douleur.
Avant de continuer sur mon discours psychologique, je voudrais rappeler une vérité médicale simple : quand la douleur est violente, douleur physique ou douleur morale, les médicaments sont les bienvenus ! Que l’on soit migraineux ou cancéreux, rhumatisant ou agonisant, il est toujours légitime de soulager la douleur ainsi. Mais les médicaments ne sont pas la seule et unique réponse possible.
C’est pourquoi la réflexion sur l’art et la manière d’affronter la douleur en limitant nos souffrances a toujours préoccupé les humains. Choisir la bonne attitude pour traverser les souffrances est ainsi un des fondements du bouddhisme ; savoir leur trouver un sens, est un de ceux du christianisme. Et la psychologie s’attache elle aussi, de son mieux, à aider les patients à ne pas se laisser dominer et asservir par leurs souffrances.
Dans la méditation, par exemple, de nombreux exercices sont destinés à nous entraîner à ne pas laisser toute notre attention se focaliser et se rétrécir sur la seule douleur, et à entraîner notre esprit à ne pas se laisser embarquer par des pensées et des émotions à propos de la douleur.
Toutes les études le confirment : l’apprentissage de la méditation aide à « mieux souffrir » lorsque les douleurs arrivent : « mieux souffrir », c’est-à-dire limiter l’envahissement, l’omniprésence et la dictature de la souffrance. C’est ce que rappelle la philosophe Simone Weil : « Ne pas chercher à ne pas souffrir, mais à ne pas être altéré par la souffrance. »
Je sais, ce n’est pas facile, et rien de plus irritant que les professeurs de douleur qui nous invitent à relativiser, parce que c’est comme ça, parce qu’on n’est pas le seul dans ce cas, etc. Vous connaissez la formule assassine de La Rochefoucauld : « On a toujours assez de force pour supporter les maux d’autrui. » On aimerait bien les voir alors, ces bons conseilleurs, prendre notre place et notre souffrance, et nous faire une petite démonstration de leur savoir-faire !
Face à la douleur, chacune et chacun fait qu’il peut, comme il peut ! Mais chacun fait aussi ce qu’il a appris à faire, d’où l’importance de proposer des approches psychologiques de nature à aider nos patients à moins souffrir. En les laissant libres de se tourner ou non vers ces dernières…
Et vous, quand vous avez très mal à la tête, c’est médicament ou méditation ?
Illustration : " je te dis que j'ai mal, tu es bouché ou quoi ?! "
PS : ce texte reprend ma chronique du 15 octobre 2019 sur France Inter dans l'émission Grand Bien Vous fasse d'Ali Rebeihi.
vendredi 25 octobre 2019
Inégalité et Santé
C’est un souvenir ancien, tenace, de mes études de médecine. J’étais externe dans un service de pédiatrie et j’avais sympathisé avec une petite patiente atteinte de leucémie, avec qui je bavardais chaque matin. Un jour, découragée par la maladie, fatiguée des examens répétés, des complications des traitements, elle me confia : « j’en ai marre d’être toujours malade ! pourquoi je n’ai pas de chance, moi ? ».
Je me souviens d’avoir marqué un temps d’arrêt avant de lui répondre, et de l’encourager de mon mieux. Avec, à cet instant, le sentiment d’une injustice poignante : effectivement, pourquoi elle ? Pourquoi d’autres enfants profitaient-ils de leur enfance, au même instant, avec insouciance ? Et d’autres adultes, de leur vie ?
Je me souviens d’avoir marqué un temps d’arrêt avant de lui répondre, et de l’encourager de mon mieux. Avec, à cet instant, le sentiment d’une injustice poignante : effectivement, pourquoi elle ? Pourquoi d’autres enfants profitaient-ils de leur enfance, au même instant, avec insouciance ? Et d’autres adultes, de leur vie ?
Cette question des inégalités me tourmente depuis toujours, comme humain (à propos des inégalités dans la société) et comme médecin (à propos des inégalités dans la santé). Tous les humains sont différents : grands ou petits, blonds ou bruns, peaux sombres ou peaux claires, musclés ou maigrichons, etc. Mais certaines différences sont des inégalités, lorsqu’elles concernent des domaines où il existe clairement un mieux et un moins bien : le bonheur et la santé en sont deux exemples majeurs.
D’où vient la bonne santé ? Elle relève en partie de facteurs génétiques, expliquant par exemple la longévité : l’autre jour, mon dentiste m’annonçait fièrement que sa mère âgée de 93 ans voyageait encore dans toute l’Europe, et que son père était mort à 100 ans, « plutôt en forme ». Cette chance génétique explique que certains humains bénéficient d’une santé qui apparaît parfois « imméritée » : il existe ainsi des personnes qui fument depuis toujours sans être touchées par le cancer (alors qu’il existe des cancers pulmonaires chez des non-fumeurs), etc.
La santé relève aussi des événements et modes de vie de l’enfance : avoir eu des parents prenant soin de nous est un facteur protecteur important pour la santé d’un adulte. S’ils vérifiaient que nos dents étaient bien brossées et ne nous gavaient pas de sucreries, ils protégeaient notre santé dentaire, etc. De même un environnement affectif sécurisant est un facteur protecteur démontré pour la bonne santé du futur adulte.
La santé relève aussi des événements et modes de vie de l’enfance : avoir eu des parents prenant soin de nous est un facteur protecteur important pour la santé d’un adulte. S’ils vérifiaient que nos dents étaient bien brossées et ne nous gavaient pas de sucreries, ils protégeaient notre santé dentaire, etc. De même un environnement affectif sécurisant est un facteur protecteur démontré pour la bonne santé du futur adulte.
Donc, si j’hérite des bons gênes et de la bonne famille, mes chances d’être en meilleure santé sont nettement augmentées, sans que j’aie à produire le moindre effort. On peut alors, si on n’a pas eu la chance de recevoir ces bonnes cartes, éprouver un sentiment d’injustice. De découragement aussi ? Pas forcément, car fort heureusement, nous disposons d’une relative marge de manœuvre, même devenus adultes.
Depuis plusieurs années, les études scientifiques se sont multipliées pour mettre en évidence comment certaines attitudes quotidiennes et certains styles de vie exercent un rôle protecteur sur notre santé. On dispose aujourd’hui de travaux convaincants montrant les bienfaits d’une activité physique régulière (pas forcément un sport intensif), d’une alimentation équilibrée (privilégiant les fruits et les légumes), de liens sociaux épanouissants (famille, amis, connaissances), de la pratique de la méditation ou de disciplines proches (yoga, sophrologie, etc.).
Et il ne s’agit pas seulement du bien que ces activités nous offrent moralement, en nous procurant des émotions agréables. Mais d’un effet biologique ! L’activité physique diminue le niveau d’inflammation présent dans notre corps ; les émotions agréables et la méditation freinent le vieillissement cellulaire en stimulant la sécrétion de télomérase, une petite enzyme réparatrice de nos chromosomes ; les fruits et légumes sont très riches – entre autres - en antioxydants, bénéfiques à la santé de nos cellules, etc.
Et il ne s’agit pas seulement du bien que ces activités nous offrent moralement, en nous procurant des émotions agréables. Mais d’un effet biologique ! L’activité physique diminue le niveau d’inflammation présent dans notre corps ; les émotions agréables et la méditation freinent le vieillissement cellulaire en stimulant la sécrétion de télomérase, une petite enzyme réparatrice de nos chromosomes ; les fruits et légumes sont très riches – entre autres - en antioxydants, bénéfiques à la santé de nos cellules, etc.
Les recherches actuelles montrent aussi un possible effet « épigénétique » favorable de ces mêmes habitudes de vie : elles permettent de rendre inactifs de nombreux gênes induisant stress ou inflammation, elles ralentissent ce qu’on appelle l’« horloge épigénétique » (une sélection de marqueurs biologiques de vieillissement de l’ADN). Ces données sont très réconfortantes, quant à la possibilité offerte à chaque adulte de réparer une partie des inégalités liées à la génétique familiale et à l’enfance.
On ne sait pas clairement jusqu’où peut aller cette réparation : rattrapage partiel ou effacement complet ? Ni si les effets en sont transitoires (seulement tant qu’on fait les efforts) ou s’il existe un « effet cliquet » possible (maintien définitif ou durable des bénéfices après un temps prolongé d’efforts) ?
En tout cas, on sait aujourd’hui ce qui va dans le sens d’une bonne santé. Ces modifications de style de vie sont bénéfiques pour tout le monde. Mais elles sont indispensables pour les personnes fragiles ou malades ! Du moins celles d’entre elles qui veulent ou peuvent s’impliquer personnellement dans leur santé.
On ne sait pas clairement jusqu’où peut aller cette réparation : rattrapage partiel ou effacement complet ? Ni si les effets en sont transitoires (seulement tant qu’on fait les efforts) ou s’il existe un « effet cliquet » possible (maintien définitif ou durable des bénéfices après un temps prolongé d’efforts) ?
En tout cas, on sait aujourd’hui ce qui va dans le sens d’une bonne santé. Ces modifications de style de vie sont bénéfiques pour tout le monde. Mais elles sont indispensables pour les personnes fragiles ou malades ! Du moins celles d’entre elles qui veulent ou peuvent s’impliquer personnellement dans leur santé.
Il semble important aussi de cultiver une vision lucide de la santé : pas de perfectionnisme ! On est le plus souvent contraint de renoncer à une santé parfaite et idéale (celle dont jouissent certaines personnes chanceuses), mais on peut toujours s’attacher à cultiver et savourer la meilleure santé possible dans son propre cas. Autrement dit, ne pas se comparer aux autres, ou pas trop, ou pas trop souvent ; et seulement, alors, pour s’inspirer de leurs bonnes habitudes. L’envie, le découragement, le ressentiment sont des émotions néfastes pour la santé, en plus d’être des états d’âme douloureux !
Et puis, il y a les devoirs des personnes en bonne santé. En tant que médecin, je suis souvent agacé lorsque ceux qui vont bien se permettent de juger ceux qui sont malades : « c’est dans la tête ; il se plaint tout de même beaucoup ; elle doit aimer aller chez les médecins… » C’est aussi révoltant que lorsque les riches critiquent les pauvres. Or, il existe des devoirs liés à la richesse, qu’elle concerne la fortune ou la santé : ces devoirs sont d’une part l’humilité et la discrétion (ne pas offenser les autres, et surtout les « pauvres », par l’étalage de ses chances) ; et d’autre part, le partage, la générosité, la redistribution.
On voit bien ce que cela signifie pour de l’argent. Mais redistribuer sa santé ? C’est très simple : si on est en bonne santé (ou durant les périodes où cela nous est offert par la vie), donner du soutien, de l’affection, du respect à celles et ceux qui sont malades ; le cas échéant, leur offrir des conseils de santé prudents et bien dosés, sans rien imposer, ni se mettre en avant. La République Française a pour devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». Pour corriger les inégalités, la fraternité est un pas précieux et important…
Illustration : se reposer pour résister les vents contraires et violents de l'adversité... (photo de Pieter Hugo).
PS : cet article a été précédemment publié dans la revue Sens & Santé en mai 2018.
Inscription à :
Articles (Atom)