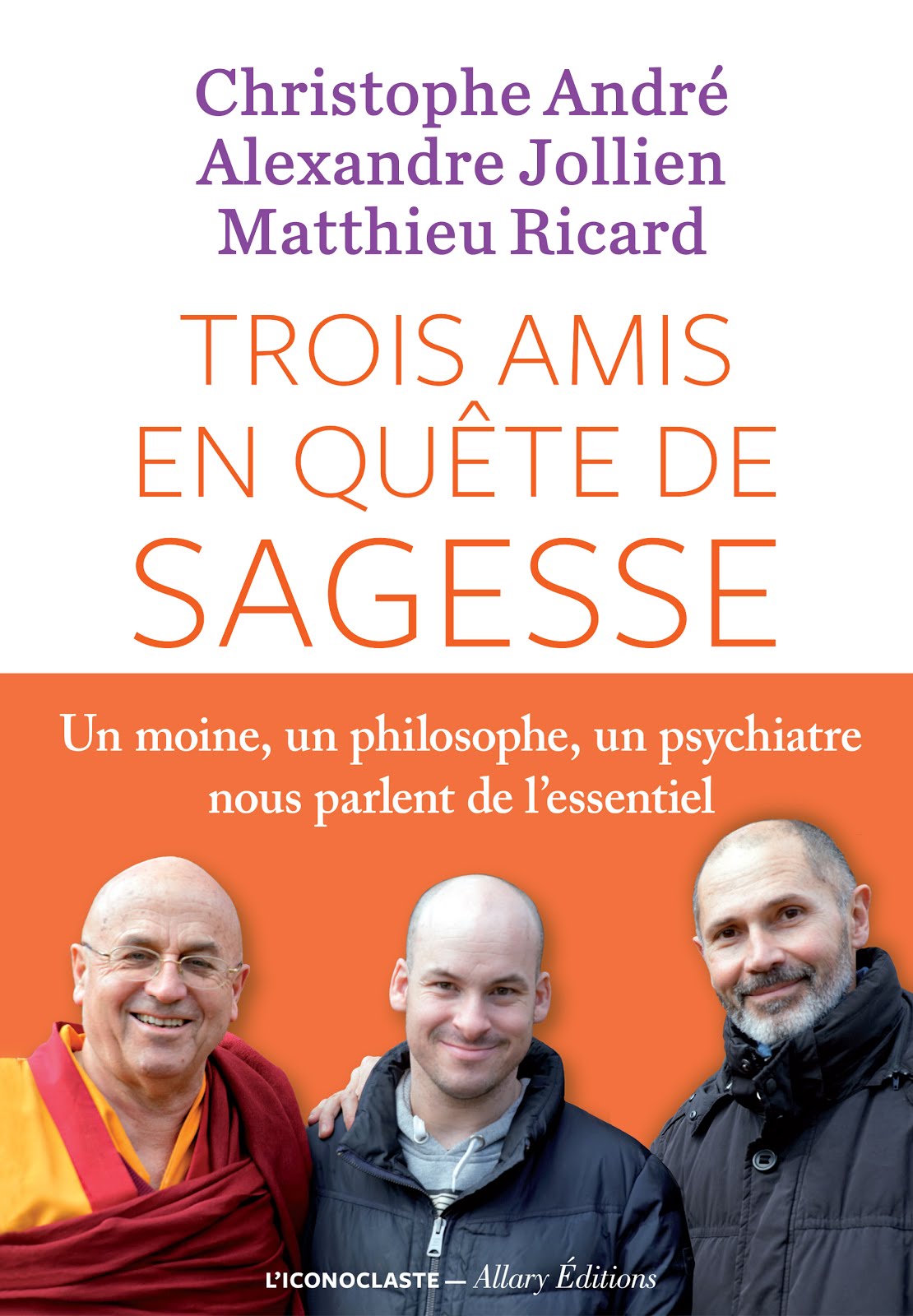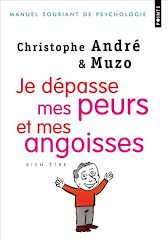Il y a toutes sortes d’inégalités qui frappent les humains : richesse, beauté, intelligence et bien d’autres. Mais les plus cruelles, à mes yeux de médecin, sont les inégalités en matière de santé : certains peuvent fumer jusqu’à 100 ans car ils ont les bons gênes, tandis que d’autres, malgré une vie plus que saine, meurent à 30 ans.
Et c’est la même chose en terme de santé mentale : parmi les humains il y a des résilients absolus, que rien en peut abattre, mais aussi des ultra-fragiles, brisés par toutes les adversités.
Certains (dont je suis) doivent souvent faire des efforts pour activer leur logiciel de bonne humeur, dès le matin et tout au long de la journée ; et d’autres n’en ont aucun besoin, comme Montesquieu par exemple, dont voici un extrait de l’autoportrait : « Je m’éveille le matin avec une joie secrète de voir la lumière ; je vois la lumière avec une espèce de ravissement ; et tout le reste du jour je suis content. Je passe la nuit sans m’éveiller ; et le soir, quand je vais au lit, une espèce d’engourdissement m’empêche de faire des réflexions. »
Quel veinard, ce Montesquieu ! Et il n’est pas le seul…
Bon, et quand on ne fait pas partie de ces chanceux, chez qui le logiciel de joie de vivre a été livré de série dès la naissance ? Quand on en arrive à souffrir de maladie dépressive, et à tomber au fond du trou ?
Dans ces cas-là, les antidépresseurs sont une bénédiction : lorsqu’ils marchent (seulement dans 2/3 des cas, hélas) ils sont à même de considérablement alléger les souffrances dépressives, et de permettre aux patients de refaire des efforts au quotidien.
Mais les antidépresseurs, aussi précieux qu’ils soient parfois, ne représentent pas une solution parfaite : ils peuvent entraîner des effets secondaires gênants, et ne sont pas satisfaisants pour l’image que les patients ont alors d’eux-mêmes : ce n’est pas valorisant de s’appuyer sur une béquille chimique. Et même lorsqu’ils marchent bien et sont bien supportés, tôt ou tard va se poser la question de leur arrêt. Par quoi les remplacer alors ?
C’est pour cela qu’il est recommandé d’associer dès le début les antidépresseurs à une psychothérapie, et d’éviter les « prescriptions orphelines », sans accompagnement psychologique, ni remise en question de ses habitudes de pensée.
Mais les soignants sont en train d’acquérir la conviction qu’il faut modifier non seulement ses habitudes de pensée, mais aussi ses habitudes de vie, concrètement, au quotidien. De plus en plus d’études montrent ainsi le rôle protecteur de la méditation, de l’exercice physique, du soutien social, des émotions positives… pour prendre le relais des antidépresseurs (et peut-être même pour les éviter dans les cas les moins sévères).
Et l’attitude la plus recommandable pourrait bien être alors non pas de les arrêter comme ça d’un coup, ce qui est déconseillé, mais de les diminuer peu à peu, une fois qu’on a changé durablement son mode de vie selon les directions que je viens d’évoquer…
Voilà, vous l’aurez compris, en tant que médecin, je suis favorable au bon usage des antidépresseurs : ils sont comme la bouée qu’on jette à une personne en train de noyer ; ce n’est pas le moment alors de lui apprendre à nager, mais de sauver sa peau. Ce n’est qu’une fois remontée à bord, qu’on peut l’aider ensuite à modifier ses façons de vivre et de pensée, pour qu’elle puisse un jour se rejeter à l’eau sans bouée, et affronter les inévitables douleurs et adversités survenant dans toute vie humaine.
C’est alors, et alors seulement, une fois qu’ils sont guéris, que les patients peuvent éventuellement tirer les enseignements de leur dépression, sans embellir l’histoire, comme le font souvent les personnes qui n’ont jamais été déprimées, avec des phrases du genre « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».
Tu parles ! ce qui ne nous tue pas peut aussi nous rendre éclopé à vie… Je préfère ce que disait Cioran :« Sur le plan spirituel, toute douleur est une chance ; sur le plan spirituel seulement… »
Et vous, vous les surmontez comment vos moments de déprime ? Jogging ou Prozac ?
Illustration : si votre ciel mental ressemble à ça, le matin, c'est bon signe ! (Le Croisic, automne 2019, merci Dominique !).
PS : ce texte reprend ma chronique du 10 septembre 2019 sur France Inter dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi.