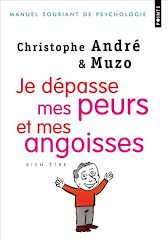Le blog Psycho Actif déménage !
Pour arriver à la nouvelle adresse
et découvrir les nouvelles publications,
merci de cliquer ici !
États d'âme d'un psychiatre
Le blog Psycho Actif déménage !
Pour arriver à la nouvelle adresse
et découvrir les nouvelles publications,
merci de cliquer ici !
Je suis en visite chez des amis gagas des chats : chez eux, il y en a partout. Je m’amuse à les observer, j’aime surtout regarder les jeunes chats jouer : explorant, accélérant, se figeant, s’amusant à mimer des scènes de combat, de chasse. En jouant, ils s’entraînent pour la vraie vie, comme des acteurs en répétition avant une pièce.
Cela m’intéresse d’autant plus de les observer que je n’aime guère jouer. En tout cas, je n’aime pas le jeu en tant que tel. Par exemple, gagner ou perdre m’a toujours été indifférent.
J’ai longtemps joué au rugby : mais ce que j’y aimais, ce n’était pas le jeu pour la victoire, comme certains de mes partenaires ; j’aimais la fraternité, l’effort du corps, le dépassement de ses craintes et de ses limites ; j’aimais les fêtes qui suivent toujours les matches, ces fameuses troisièmes mi-temps festives, propres au rugby, au terme desquelles on comprend que la victoire ou la défaite importent peu.
Je participe parfois, avec ma famille ou mes amis, à des jeux de société : le résultat ne m’intéresse pas. Ce que j’aime, c’est observer le comportement des autres joueurs, discussions, négociations, mauvaise foi, engueulades et réconciliations ; observer mes propres emballements lorsque je perds ou que je gagne ; rire de moi, de mes inquiétudes ou de mes fiertés dérisoires ; faire le clown, dire des bêtises. J’aime que le jeu nous donne de la joie, des rires.
Je suis attentif, aussi, aux dérives du jeu. Je me souviens d’une visite à Las Vegas, des immenses salons remplis de machines à sous, et sans fenêtres : les joueuses et joueurs, sous un éclairage artificiel permanent, oublient le temps ; des buffets proposent nourriture et boissons à bon marché, pour qu’on reste des heures à jouer, boire et manger ; dès qu’un joueur gagne, les machines clignotent et couinent, attirant l’attention de tout le monde ; mais elles ne font rien, ni son ni flash, lorsqu’on perd.
Je me souviens de la seule fois où j’ai joué, il y a longtemps, à un jeu vidéo, Civilization : je ne pouvais plus m’en décrocher tant ma mission (conduire ma tribu de la préhistoire à l’époque moderne) était à la fois passionnante et plutôt facile au début ; le premier soir, j’ai lâché le jeu à 1h du matin ; le deuxième, à 3h ; le jour suivant, j’ai décidé de ne plus m’approcher de l’ordinateur. Le plaisir du jeu était suivi d’un sentiment désagréable de vide : pas dormi, rien appris...
Je vois qu’aujourd’hui, des jeux se proposent d’aider les enfants ou les adultes à apprendre et à progresser, dans tout un tas de domaines. C’est très bien, après tout, si ça marche. Cet été, une jeune cousine a voulu nous initier à l’écologie à l’aide d’un jeu pédagogique. Dans mon cas, ce fut le bide : s’il s’agit d’apprendre, je préfère lire ou écouter un cours ; s’il s’agit de s’amuser, je préfère bavarder avec des amis, danser, jouer de la musique ; s’il s’agit de se changer les idées, je préfère un roman, un film, une balade. Bref, je reste un indécrottable non-joueur.
C’est en lisant l’écrivain Roger Caillois, théoricien des activités ludiques dans son livre Les Jeux et les hommes, que j’ai compris mon problème : « Le jeu est une activité réglée, qui a sa fin en elle-même et ne vise pas une modification utile du réel. »
Finalement, je préfère le réel, la vie : l’observer, l’admirer, la comprendre, la transformer. Le jeu nous rend joyeux, mais seule la vraie vie nous rend heureux...
Illustration : un chat qui n'aime pas les jeux, lui non plus...
PS : cet article est paru dans la revue Kaizen de novembre-décembre 2020.
Comme je parle souvent de méditation, et de l’intérêt de savoir vivre l’instant présent, on me remonte parfois les bretelles en me disant « l’instant présent, l’instant présent... et l’instant d’après, alors ? et l’instant d’avant ? ça compte pour du beurre, notre passé et notre futur ?
Non, c’est important aussi ! Tout est important : le présent, le passé, le futur ! Mais ce qui est précieux, c’est la liberté de mouvement, c’est de pouvoir naviguer librement dans ces trois temps psychologiques, et de ne rester durablement prisonnier d’aucun.
Vivre au présent est capital, mais c’est bon, aussi, de faire des projets et d’avoir des espérances. Et c’est bon, enfin, d’avoir des regrets et même de la nostalgie !
La nostalgie est le mélange en nous de la douceur et de la douleur des souvenirs, elle mêle l’agréable - on se souvient des beaux instants - et le désagréable - on est triste que ces moments soient passés.
La nostalgie n’est pas une simple émotion, elle est un état d’âme subtil, mêlant les sensations, les images, les pensées, liées à l’évocation de notre passé, où bonheur et malheur se trouvent harmonieusement mêlés, comme dans la vraie vie.
L’état d’âme de nostalgie est un phénomène très intime et très personnel, c’est pourquoi aucune nostalgie ne ressemble à une autre. Il y a par exemple des personnes, dont je fais partie, qui sont capables de ressentir de la nostalgie même pour des époques qu’elles n’ont jamais vécues, des lieux où elles ne se sont jamais rendues, des personnes qu’elles n’ont jamais rencontrées, des musiques qui existaient avant même qu’elles ne soient nées...
Pendant longtemps, on a considéré que la nostalgie était à éviter, qu’elle représentait une forme de tristesse et de mélancolie pouvant s’avérer problématique.
Mais les travaux récents en psychologie des émotions tendent à la réhabiliter : chez la plupart des personnes, elle entraîne des ressentis plutôt agréables, elle aide à se sentir moins seul, elle joue un rôle important dans le sentiment d’identité personnelle, en établissant une continuité entre passé et présent.
Il est précieux de laisser régulièrement naître en nous la nostalgie, et sans doute précieux aussi d’apprendre à la fréquenter et à la savourer : elle est délicieuse si elle est transitoire, mais dangereuse si on s’y éternise, surtout si on a un tempérament mélancolique, voire dépressif.
La question, finalement, c’est : vers quoi nous pousse la nostalgie ?
Saint-Exupéry la définit comme « le désir d'on ne sait quoi ». Ce flou est son charme et son péril.
Si la nostalgie nous pousse aux regrets répétés, attention, danger ! Mais si nous comprenons son message : « ce qui compte dans ta vie, c’est le bonheur » et si nous sommes attentifs à son visage lumineux, et pas seulement douloureux, alors nous pourrons, grâce à elle, revenir vers le présent : « ma vie, c’est aussi ici et maintenant », et vers l’action : « je veux vivre de nouveaux instants heureux ».
Car nos bons souvenirs de demain, c’est aujourd’hui que nous les vivons…
Illustration : une collection de porte-clés (merci à Carlotta).
PS : cet article reprend ma chronique du 3 mars 2020 dans l'émission de France Inter, Grand Bien Vous Fasse.
On vit vraiment une drôle de période, une période un peu folle, qui nous pousse à des réactions qui le sont tout autant : énervements et abattements, frustrations et incompréhensions, rouspétances et incohérences.... Bref, nous aurions bien besoin d’un peu de sagesse !
Quand on parle de sagesse, on cède souvent à deux stéréotypes.
Le premier est de penser tout de suite à un vieux monsieur barbu, figure traditionnelle du sage. Mais nous devrions moderniser un peu nos clichés sur la sagesse : car il y a aussi, bien évidemment, des femmes sages, même si l’on parle moins d’elles !
Et puis, il y a un autre stéréotype : la sagesse comme une tradition orientale. Mais inutile de prendre l’avion pour chercher au loin : les figures de sagesse se retrouvent en tous lieux, et notamment en Occident !
Prenez Montaigne, par exemple, qui fut, en Dordogne et en son temps, un homme sage et prudent, dont les propos peuvent nous aider aujourd’hui encore.
Car un humain qui écrit (Essais III, 8, De l’art de converser) : « Quand on me contredit, on éveille mon attention et non pas ma colère » a beaucoup à apprendre à ses semblables !
Je répète, parce que les phrases de sagesse, il faut les répéter : « Quand on me contredit, on éveille mon attention et non pas ma colère ».
Mon beau-père, lui aussi, était pour moi un modèle de sagesse au quotidien, avec une incroyable capacité à extraire du bonheur de tous les moments de sa vie, même des instants peu réjouissants à première vue.
Ainsi, ayant fait un jour, dans sa maison reculée du Pays Basque, une grave chute sur le crâne, suivie d’une hémorragie, il avait dû être évacué par hélicoptère vers l’hôpital de Bayonne, où examens et soins lui furent prodigués. Lorsqu’il nous téléphona le soir venu, pour nous raconter ses aventures, il ne parla pas un instant de ses peurs ni de ses vingt points de suture !
Mais de la compétence et de la bienveillance des soignants, et des pompiers ; de son incroyable voyage en hélicoptère, qui l’avait enchanté ; et de la chance qui avait été la sienne. Il donnait toujours la priorité à tout ce qui pouvait aider à mieux vivre, à rendre l’existence plus belle. C’était sa sagesse à lui.
Le philosophe André Comte-Sponville a un jour défini la sagesse ainsi : « Le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité ».
Mon beau-père, qui aimait le genre humain, aurait parlé du « maximum de bonheur dans le maximum de générosité ».
Alors, additionnons les deux, et nous aurons la formule de sagesse idéale : « le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité et de générosité » !
Je suis sûr qu’elle aurait plu à Montaigne !
Illustration : même les escaliers ne s'y retrouvent plus...
PS : cet article est inspiré de ma chronique du 17 novembre 2020, dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi, sur France Inter.
Je suis sur mon scooter, sur une voie urbaine autour de Paris. La circulation n’est pas trop dense, alors j’ai le temps de regarder par petits coups d’œil le ciel et les bâtiments qui défilent. Avant de passer sous un pont, je déchiffre un message peint en grosses lettres maladroites sur le parapet de béton : « Repentez-vous ! »
La formule se fiche dans mon crâne. Ce mot de « repentir », à la connotation religieuse, me déstabilise. Repentez-vous ! Qui a pu écrire ça ? En bon psychiatre, je pense à un délire mystique ou un état délirant. Mais tout de même, il a fallu de l’organisation pour arriver à peindre ces grandes lettres, dans un endroit d’accès compliqué. Alors, un prédicateur allumé, ou très motivé ?
Puis je me dis que ce n’est pas la question. Après tout, le meilleur moyen de ne pas écouter les messages qu’on nous adresse, c’est de disqualifier la personne qui les délivre. Or, ce message me touche. Pourquoi ?
Je n’ai pas l’impression d’avoir commis des actes appelant de la repentance. Pas ces temps-ci. Mais dans ma vie, si. J’ai fait du mal à tout un tas de gens. Par inconséquence et par égoïsme dans ma vie amoureuse, quand j’étais jeune. Par manque de disponibilité et par mauvaise humeur, avec des proches, du fait du stress, quand je travaillais trop. Par manque de disponibilité ou de discernement, dans tout un tas de circonstances.
La liste est longue, et sans doute l’est-elle encore plus que je ne l’imagine, du fait de tout ce qui passe sous le radar de ma mémoire, de tout le petit mal que j’ai fait et que j’ai oublié ou méconnu. Dois-je m’en repentir ?
Le repentir, pour Descartes, « c’est une espèce de tristesse qui vient de ce qu’on croit avoir fait quelque mauvaise action ; et elle est très amère, parce que sa cause ne vient que de nous. Ce qui n’empêche pas néanmoins qu’elle soit fort utile » Quelques siècles plus tard, le psychologue Pierre Janet note : « Le remords se distingue du repentir, qui désigne un état d’âme plus volontaire, moins purement passif... »
Mais ça commence à me mettre en danger ces histoires de repentir, il est temps que je me reconcentre sur la route : en scooter, ne pas conduire en pleine conscience, c’est mettre sa vie en danger.
Le soir en m’endormant, je repense à cette histoire. J’espère que si le « Repentez-vous ! » a été écrit par quelqu’un de perturbé, il (ou elle) va mieux aujourd’hui. Je me dis que je ne devrais pas me prendre la tête pour un oui ou pour un non, pour un simple graffiti. Je me demande si ça vaut la peine de prendre le temps chaque soir, de se poser la question du mal qu’on a pu faire à autrui. Ou si s’attacher simplement à faire du bien chaque fois que possible ne suffirait pas. Les deux, sans doute ?
Je n’ai pas la réponse.
Alors je m’endors...
Illustration : un ciel de Paris en hiver 2020, par l'ami Ali.
PS : cet article a été publié dans le magazine Psychologies en octobre 2020.
Les cauchemars, c’est l’irruption de l’angoisse dans le cocon douillet du sommeil. En tant que psychiatre, je sais que ça peut gâcher bien plus que nos nuits, nos journées aussi, et nos vies. Je me souviens par exemple d’une patiente qui ne voulait plus dormir, par peur des cauchemars qu’elle faisait chaque nuit.
Depuis qu’elle avait eu une crise d’angoisse dans son sommeil, une véritable attaque de panique, elle faisait des rêves terribles, durant lesquels elle s’étouffait, se noyait, se faisait étrangler ou enterrer vivante : l’horreur... Alors, elle ne se mettait plus au lit, mais somnolait sur son canapé, sans jamais éteindre ni la télé ni la lumière.
Heureusement pour la plupart d’entre nous, nos cauchemars ne prennent pas cette ampleur.
Pour ma part, j’ai eu toute une période de ma vie où, je travaillais trop, où je me sentais toujours débordé, submergé, trop sollicité. Et durant cette période, je faisais très souvent des cauchemars d’empêchement : quelque chose ou quelqu’un m’empêchait de faire ce que j’avais à faire ; des gens m’empêchaient de monter dans le train que je devais prendre, des embouteillages m’empêchaient d’avancer sur le périphérique alors que j’avais un rendez-vous urgent, des barrières m’empêchaient de porter secours à mes enfants en difficulté... Ces cauchemars répétitifs d’empêchements, j’en émergeais en gesticulant et en hurlant de colère autant que d’inquiétude : je vous laisse interpréter tout ça comme vous voudrez...
Bon, heureusement, tous nos rêves ne sont pas des cauchemars. Il y en a aussi de simplement... étranges.
Je me souviens d’avoir lu un jour un livre du philosophe Clément Rosset qui racontait comment, lors d’une grave dépression, il avait l’impression irréelle de faire régulièrement les rêves de quelqu’un d’autre. Et puis, il y a des rêves pleins de charme et de poésie, où l'on croise des anges parés de leurs plumes réglementaires...
Des rêves où l’on rencontre des anges, c’est merveilleux et délicieux ! Mais peut-être que pour voir des anges la nuit, il faut les avoir déjà vu passer dans nos journées. Peut-être faut-il apprendre à les deviner derrière chaque petite grâce qui nous émeut, derrière chaque adversité aussi, qu’ils nous envoient comme un message ou une mise en garde.
C’est le poète Christian Bobin qui nous éclaire sur le rôle de ces anges, qui est de nous aider, mais à leur manière : « L’aide véritable ne ressemble jamais à ce que nous imaginons. Ici nous recevons une gifle, là on nous tend une branche de lilas, et c’est toujours le même ange qui distribue ses faveurs. La vie est lumineuse d’être incompréhensible ».
Nos rêves aussi sont parfois lumineux d’être incompréhensibles. Alors, on peut se contenter de les savourer, d’en admirer la beauté et le mystère, de se souvenir d’eux, sans chercher forcément à les décrypter en force, là, tout de suite, et attendre simplement qu’ils s’éclairent un jour d’eux-mêmes ; un jour ou jamais, quelle importance ? Du moment que nous avons rêvé, le plus beau n’est-il pas déjà fait ?
Illustration : ça ressemble à un rêve, mais c'est juste l'enregistrement de beaux chants indiens, au débuts du XXème siècle...
PS : cet article est inspiré de ma chronique du 22 septembre 2020, dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi, sur France Inter.
« Je ne mens jamais, c’est trop difficile. Il faut sans cesse se souvenir des millions de mensonges, anti-mensonges et quasi-mensonges précédents, quel embrouillamini ! »
Cet aveu n’est pas de moi, mais du génial Joseph Delteil, écrivain inspiré et oublié du siècle dernier. Pas de moi, donc, mais j’adhère totalement à ses propos ! Non seulement, le mensonge pose un problème moral, mais en plus, il est un stresseur mental : à moins d’être un pur psychopathe, on ne sent pas bien dans le mensonge, on ne vit pas bien dans les faux-semblants, ni notre esprit ni notre corps n’aiment cela.
Alors, l’attitude inverse, celle qui consiste à s’efforcer de ne jamais - ou presque jamais – mentir, cela s’appelle comment ?
Spontanéité, sincérité, authenticité : les mots ne manquent pas, et renvoient chacun à une dimension et une nuance spécifique.
La spontanéité suggère un mouvement naturel qu’on ne réfrène pas, une impulsion.
La sincérité évoque plutôt une décision volontaire, un choix moral et relationnel.
Et l’authenticité renvoie à une manière d’être plus durable et permanente, à une façon d’être soi-même à chaque instant.
Être soi-même, c’est quelque chose qui plait beaucoup, à notre époque, où l’on valorise plus volontiers l’authenticité que les bonnes manières, par exemple. Quelqu’un d’authentique, c’est a priori quelqu’un de sympathique, quelqu’un de rassurant, qui ne ment pas, ne triche pas, quelqu’un à qui on a envie de dire : « ça, c’est vraiment toi ! »...
Alors, être authentique, être vraiment soi, ce serait donc l’idéal ? Pas si simple, tout de même...
D’abord parce que « être soi-même », ce n’est pas sûr que ça veuille dire quelque chose de précis. Quand on l’étudie de près, on finit par se demander si le « soi » existe vraiment. En tout cas, un « soi » qui serait toujours stable et prévisible, qui correspondrait à notre personnalité et notre volonté.
La psychologie scientifique nous montre plutôt que nous changeons sans cesse, en fonction des environnements et des circonstances. Une nuit d’insomnie, un succès, un échec, un peu d’amour ou un peu de détresse, et voilà notre « soi-même » qui n’est plus tout à fait le même...
Et puis, il y a un autre souci : « être soi-même », ce n’est pas une garantie de comportement adéquat. Être soi-même, c’est parfois se permettre de se montrer grognon, égoïste, borné, pessimiste, agressif, méprisant... Il y a des personnes qui sont ainsi toujours elles-mêmes, et qu’on n’a pas envie de côtoyer ou de croiser.
Bon, je n’insiste pas, vous m’avez compris, comme beaucoup de ce qui est humain, l’authenticité a ses bons et ses mauvais côtés.
Alors, pour conduire son existence, mieux vaut peut-être s’aligner non sur son ego mais sur ses idéaux... Mieux vaut peut-être s’efforcer de suivre ses valeurs plutôt qu’attendre qu’elles émergent de notre moi profond, si toutefois il existe...
C’est ce travail qui est intéressant, ce travail de mise en cohérence entre ce à quoi on aspire et ce qu’on est spontanément, en se levant chaque matin. Être soi-même, c’est facile. Il n’y a qu’à écouter les pubs : Be yourself, Venez comme vous êtes, etc...
Devenir quelqu’un de bien, ça par contre, c’est du boulot de longue haleine : lâcher son égo pour mieux se rapprocher de ses idéaux, ça prend souvent une vie entière...
Illustration : il y a des moments dans la vie où l'on n'est pas vraiment soi...
PS : cet article est inspiré de ma chronique du 8 septembre 2020, dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi, sur France Inter.
C’est l’histoire d’une dame de 80 ans, qui vit toute seule à la campagne. Son mari est mort il y a... longtemps ; ils s’étaient un peu aimés puis beaucoup disputés.
Mais elle ne se résout pas à rester veuve. Alors, elle s’achète un ordinateur et s’inscrit sur des sites de rencontre pour personnes de son âge. Et un jour elle tombe sur un monsieur de 90 ans, veuf lui aussi.
C’est le coup de foudre : ils font connaissance, ils se découvrent, deviennent complices, se promènent, chantent tous les deux des chansons de leur jeunesse ; ils s’attachent...
Leurs relations ne sont pas toujours faciles, il y a des disputes, des portes claquées, et toujours, à la fin, des réconciliations. Malgré leur âge, ils sont comme des adolescents, remués et bousculés par des émotions qu’ils avaient oubliées, qu’ils ne comprennent pas toujours, qu’ils ne contrôlent pas toujours.
Mais toujours le cœur battant, à chaque fois qu’ils se retrouvent, et leur histoire d’amour est comme un dernier arc-en-ciel dans leurs vies....
Ils savent bien qu’ils sont âgés, et que l’avenir ne leur appartient plus tout à fait. Mais ils savourent toutes ces fleurs qui déboulent dans leur quotidien, après tant de claques reçues... Ils savourent d’autant plus qu’ils sont loin l’un de l’autre : elle habite à Toulouse, il habite à Nantes.
Ils doivent, pour se voir, prendre des trains, subir de longs trajets, qui les épuisent. Ils parlent parfois de vivre ensemble, mais ils sont trop enracinés dans leurs écosystèmes : leurs maisons, leurs chiens, leurs chats, leurs voisins, les oiseaux de leurs jardins... Alors ils se téléphonent beaucoup.
Un jour, la dame ne répond plus, ni au téléphone ni aux lettres envoyées, pendant des jours et des semaines. Et le monsieur apprend que sa bien-aimée est morte. Bouleversé, il meurt, lui aussi, un an après.
On retrouvera, chez elle et chez lui, des poèmes d’amour qu’il lui écrivait, drôles et légers, habités par l’enfance et la grâce. Un de ces poèmes, qui parle de leur amour et de la distance qui les séparaient, sera lu à l’enterrement du monsieur. Et tout le monde se mettra à pleurer, parce que c’est beau et triste à la fois, ces histoires d’amour empêchées, même à 90 ans.
Aimer, c’est s’attacher. On s’attache parfois par nécessité, par fragilité ; mais quand l’attachement est heureux et réciproque, on y gagne en liberté et en joie d’exister.
Aristote enseigne qu’« Aimer, c’est se réjouir ». Spinoza ajoute que « L’amour est une joie qu’accompagne une cause extérieure ». Et voilà l’équation : Aristote + Spinoza = « Aimer, c’est se réjouir que l’autre existe ».
Vous pouvez l’apprendre par cœur, elle vous servira toute votre vie...
Illustration : le balcon de la maison de Juliette, à Vérone, sous lequel Roméo venait, peut-être, soupirer et lui envoyer des baisers...
PS : cet article est inspiré de ma chronique du 25 août 2020, dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, d'Ali Rebeihi, sur France Inter.
On se plaint souvent de la fatigue, mais il ne faut pas oublier qu’elle a aussi des avantages. Elle est comme la douleur, un signal d’alarme nous avertissant d’un problème en cours.
Au départ, la fatigue est là pour nous aider. Nous aider, par exemple, à réguler nos comportements : en nous rappelant que nos réserves d’énergie sont épuisées ou que nos capacités sont dépassées, elle nous empêche alors d'aller au-delà de nos forces. La fatigue nous avertit que l’heure du repos et de la récupération est arrivée !
Ça, c’est pour notre fatigue à nous. Et puis il y a la fatigue des autres. Parfois, nous aimerions bien que certains autres soient un peu plus fatigués ! Nos enfants, par exemple, quand ils sont petits, et que, le soir venu, leur énervement masque leur fatigue. Ou nos voisins, notamment lorsqu’ils font du bruit : vivement qu’ils se fatiguent !
Autrefois, si quelqu'un qui se sentait heureux avait envie de chanter ou de faire de la musique avec un instrument, bien sûr ça cassait un peu les oreilles de l’entourage ; mais au bout d'un moment, le chanteur ou le musicien, fatigué, s'arrêtait. Et les voisins pouvaient souffler. La grande vertu de la fatigue, c’est qu’elle fatigue ! Et que quand on est fatigué, on arrête...
Ça, c’était autrefois ; parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est la technologie, venue à notre secours pour alléger notre fatigue et repousser nos limites. Alors, si quelqu'un se sent très heureux, au lieu de chanter ou de gratter sa guitare, il peut mettre sa sono, à fond, pendant des heures. La sono ne se fatigue jamais, elle. Et plus c’est fort, plus ça excite, et plus ça efface la fatigue...
Ah oui, la fatigue a parfois du bon !
Et puis, elle en dit long sur la condition humaine, et sur la manière dont chaque personne traverse l’existence : entre les toujours-fatigué(e)s et les jamais-fatigué(e)s, les fatigué(e)s du corps et ceux de l’esprit, ceux qui l’écoutent et ceux qui la refusent...
Nous l’avons dit, la fatigue est une conséquence naturelle de toute forme d’action. C’est facile à comprendre pour les actions du corps. Parfois plus subtil pour les actions de l’esprit.
Pourtant notre cerveau lui aussi a ses limites. Réfléchir fatigue, faire attention fatigue, stresser fatigue, passer son temps sur les écrans fatigue... D’où l’étrange apaisement obtenu par la pratique de la méditation de pleine conscience, qui nous réapprend, finalement, à ne rien faire, et à offrir enfin du repos à notre cerveau...
L’intelligence de soi qu’apporte la méditation débouche aussi sur une intelligence de la fatigue, un art de l’écouter. Mais pas trop, tout de même, comme le rappelle Proust : « Dans la fatigue la plus réelle, il y a, surtout chez les gens nerveux, une part qui dépend de l’attention et qui ne se conserve que par la mémoire. On est subitement las dès qu’on craint de l’être, et pour se remettre de sa fatigue, il suffit de l’oublier. »
Il en est de la fatigue comme de toutes les adversités : certaines sont à ignorer, d’autres à écouter. Et d’ailleurs... Mais non : je sens que vous êtes fatigués de me lire, je m’arrête !