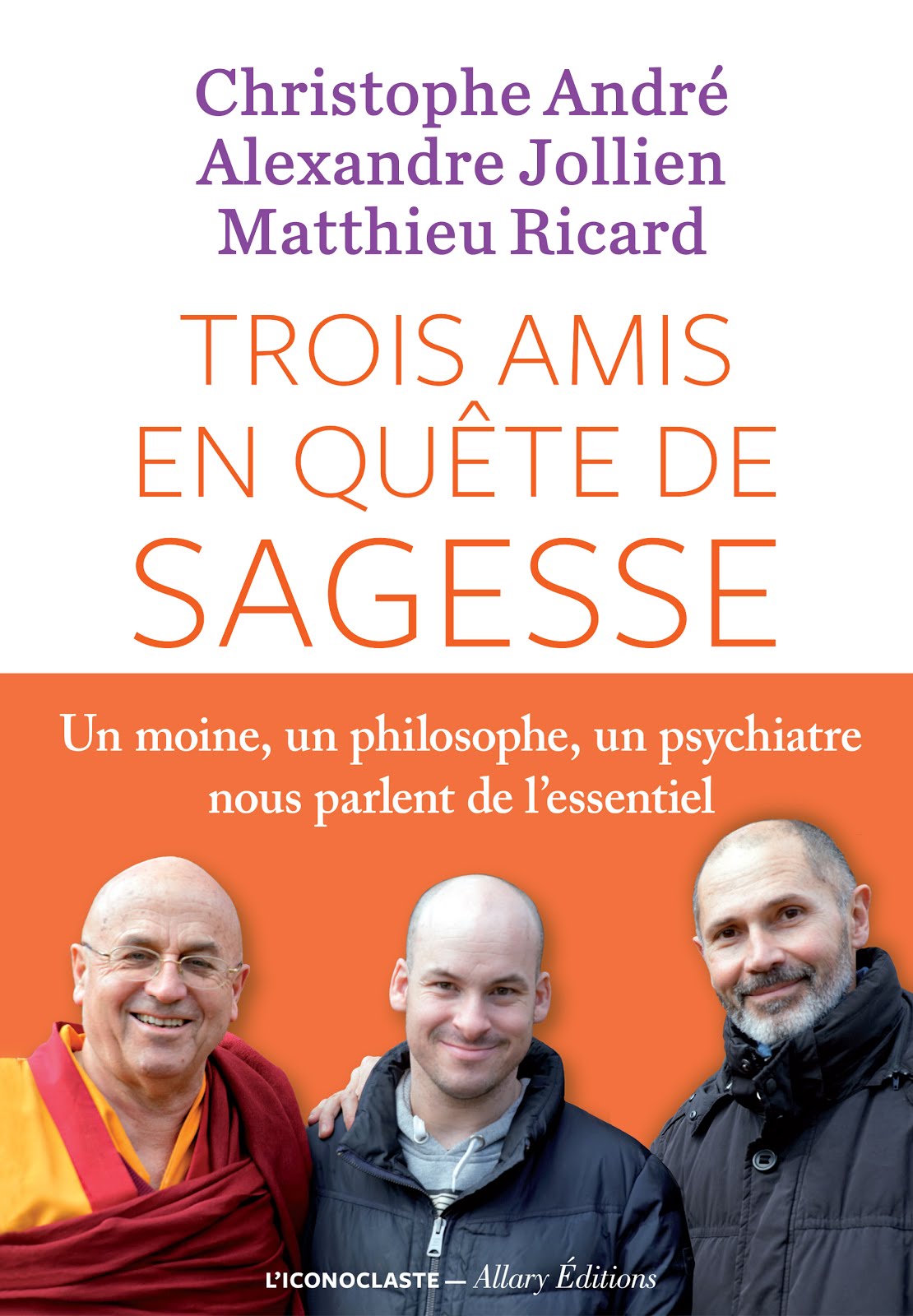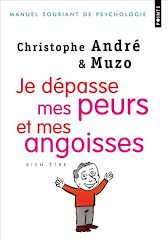Ça se passe au
marché, chez « ma » marchande de fruits et légumes.
Devant moi, une dame
prend vraiment tout son temps : pour choisir, changer d’avis, interroger
la vendeuse. Ignorant superbement la longue file d’attente qui se forme
derrière elle. Ou savourant peut-être son pouvoir, comme me le suggéra plus
tard un ami psychanalyste…
En tout cas, la dame prend son temps jusqu’au dernier moment : elle insiste pour donner l’appoint, cherchant une à une ses petites pièces de monnaie dans le fond de son sac.
En tout cas, la dame prend son temps jusqu’au dernier moment : elle insiste pour donner l’appoint, cherchant une à une ses petites pièces de monnaie dans le fond de son sac.
Pendant ce temps, dans
la file, une autre dame s’agace, et s’en prend du coup aux tomates de
l’étalage, dans lesquelles elle enfonce méthodiquement son index rageur, pour
voir, je suppose, si elles sont mûres à sa guise.
Et moi aussi je
commence à m’agacer un peu de tout ça, mais ma petite alarme intérieure
s’allume alors, heureusement : « Bip ! L’option stress est-elle
indispensable dans cette situation ? »
Non, évidemment. Je
perçois que j’ai le choix. Pas le choix de la situation matérielle : je
suis dans la file d’attente, et je n’ai pas l’intention de passer devant les
deux dames en leur expliquant qu’elles sont stupides et que je n’ai pas de
temps à perdre avec leurs névroses (en leur avouant que ma névrose à moi, c’est
de ne pas aimer attendre).
Mais j’ai le choix de mon attitude intérieure : je peux continuer de les surveiller et de m’agacer en ressassant des critiques à leur égard ; je peux aussi généraliser ces critiques au genre humains (« mon Dieu, que les gens sont chiants ! ») ; ou je peux décider qu’il y a vraiment, vraiment plus grave, choisir de respirer, de sourire, et de m’amuser de leurs manies, ou de m’en foutre et de regarder ailleurs, vers les fruits, les légumes, le marché, la vie, le ciel…
Mais j’ai le choix de mon attitude intérieure : je peux continuer de les surveiller et de m’agacer en ressassant des critiques à leur égard ; je peux aussi généraliser ces critiques au genre humains (« mon Dieu, que les gens sont chiants ! ») ; ou je peux décider qu’il y a vraiment, vraiment plus grave, choisir de respirer, de sourire, et de m’amuser de leurs manies, ou de m’en foutre et de regarder ailleurs, vers les fruits, les légumes, le marché, la vie, le ciel…
Je comprends à cet
instant plein de choses.
Que ce petit effort de ma part n’est pas seulement un exercice de gestion du stress mais de vision du monde.
Que si je traverse cette histoire avec sourire et bienveillance, je renforcerai alors en moi une vision juste du monde : « il y a des choses graves et de choses pas graves, ne consacre pas une once d’énergie à ces dernières, et garde-la pour ce qui importe vraiment. »
Que dans nos vies, tout compte, et que si je me sors intelligemment de cet instant, j’aurais mis en marche un logiciel qui m’aidera pour le reste de la journée, j’aurais fait fonctionner les bonnes voies neurales à dédier à la petite adversité, celles du recul et de l’humour.
Ça y est, la première dame s’en va en souriant, contente de ses choix. En voilà une au moins qui ne stresse pas à l’idée de provoquer une longue file derrière elle ; sans doute est-ce une force, et tant mieux pour elle ! La seconde va très vite : elle sait exactement quelles sont les tomates qu’elle désire, pour les avoir toutes palpées.
C’est à mon tour, et je ne peux m’empêcher de rire intérieurement : que vais-je bien pouvoir faire, sans le vouloir, pour agacer les autres clients qui attendent après moi ?
Que ce petit effort de ma part n’est pas seulement un exercice de gestion du stress mais de vision du monde.
Que si je traverse cette histoire avec sourire et bienveillance, je renforcerai alors en moi une vision juste du monde : « il y a des choses graves et de choses pas graves, ne consacre pas une once d’énergie à ces dernières, et garde-la pour ce qui importe vraiment. »
Que dans nos vies, tout compte, et que si je me sors intelligemment de cet instant, j’aurais mis en marche un logiciel qui m’aidera pour le reste de la journée, j’aurais fait fonctionner les bonnes voies neurales à dédier à la petite adversité, celles du recul et de l’humour.
Ça y est, la première dame s’en va en souriant, contente de ses choix. En voilà une au moins qui ne stresse pas à l’idée de provoquer une longue file derrière elle ; sans doute est-ce une force, et tant mieux pour elle ! La seconde va très vite : elle sait exactement quelles sont les tomates qu’elle désire, pour les avoir toutes palpées.
C’est à mon tour, et je ne peux m’empêcher de rire intérieurement : que vais-je bien pouvoir faire, sans le vouloir, pour agacer les autres clients qui attendent après moi ?
Illustration : des radis du marché, pas du tout décidés à se laisser croquer, par Sabine Timm.
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en mai 2019.