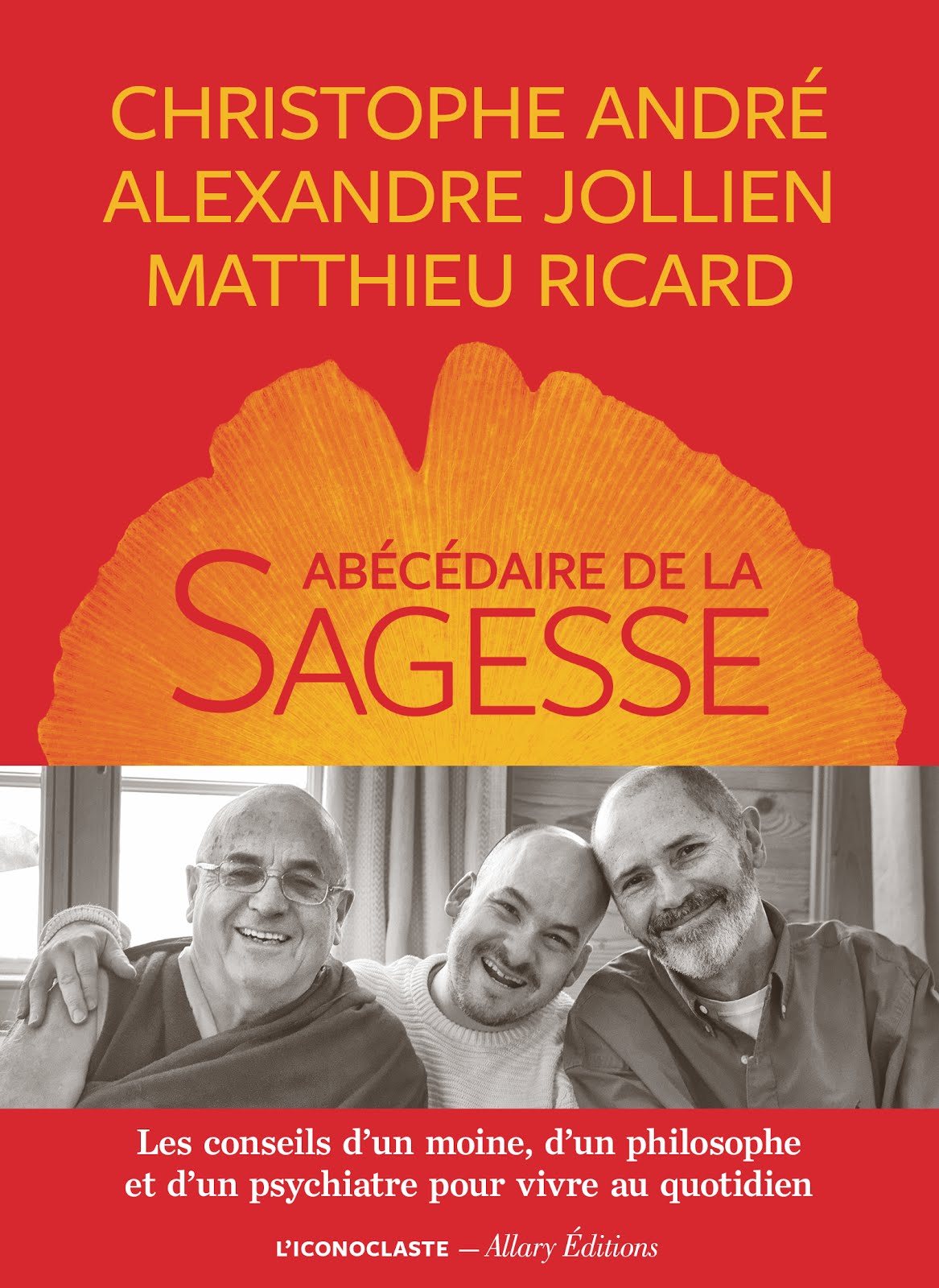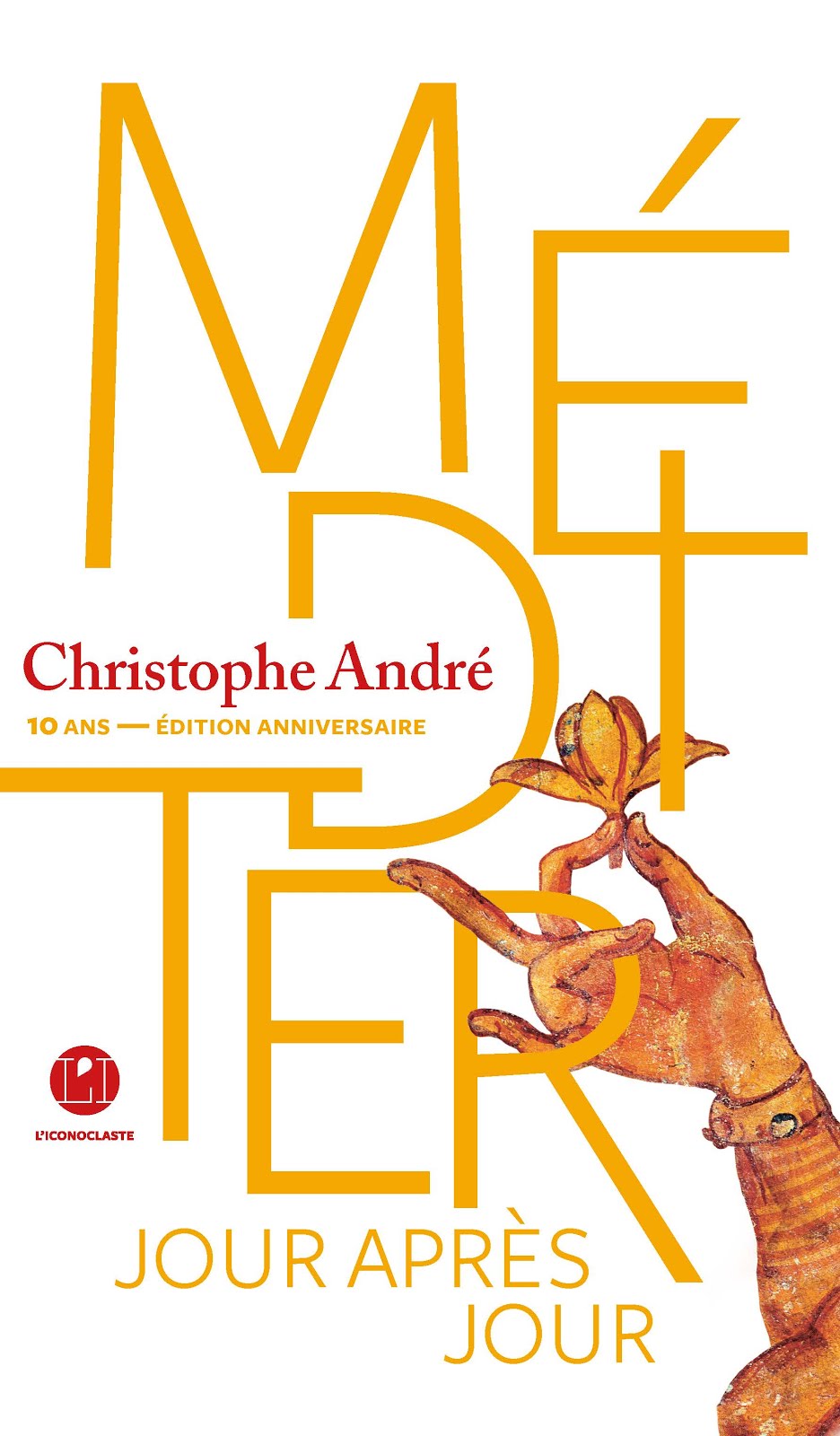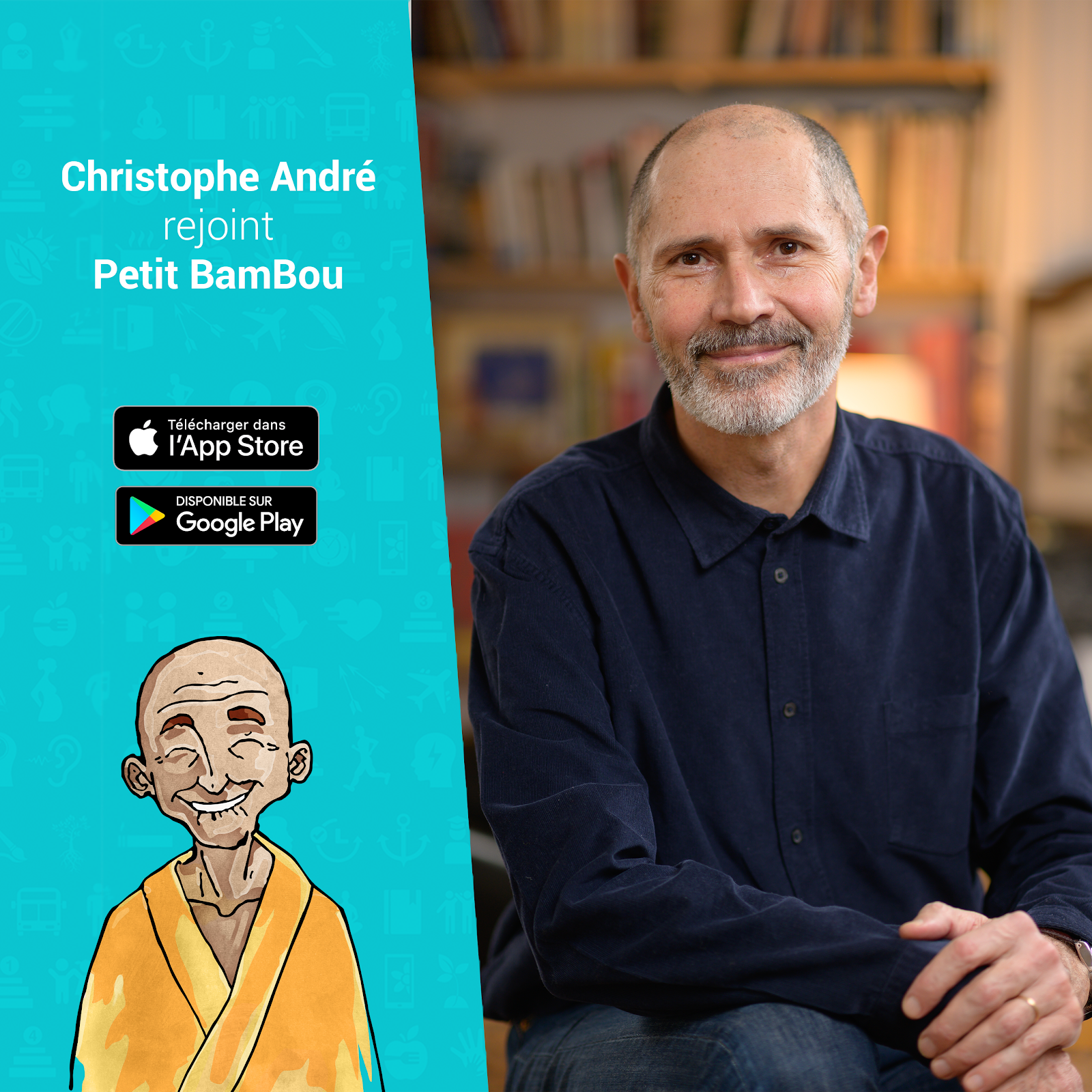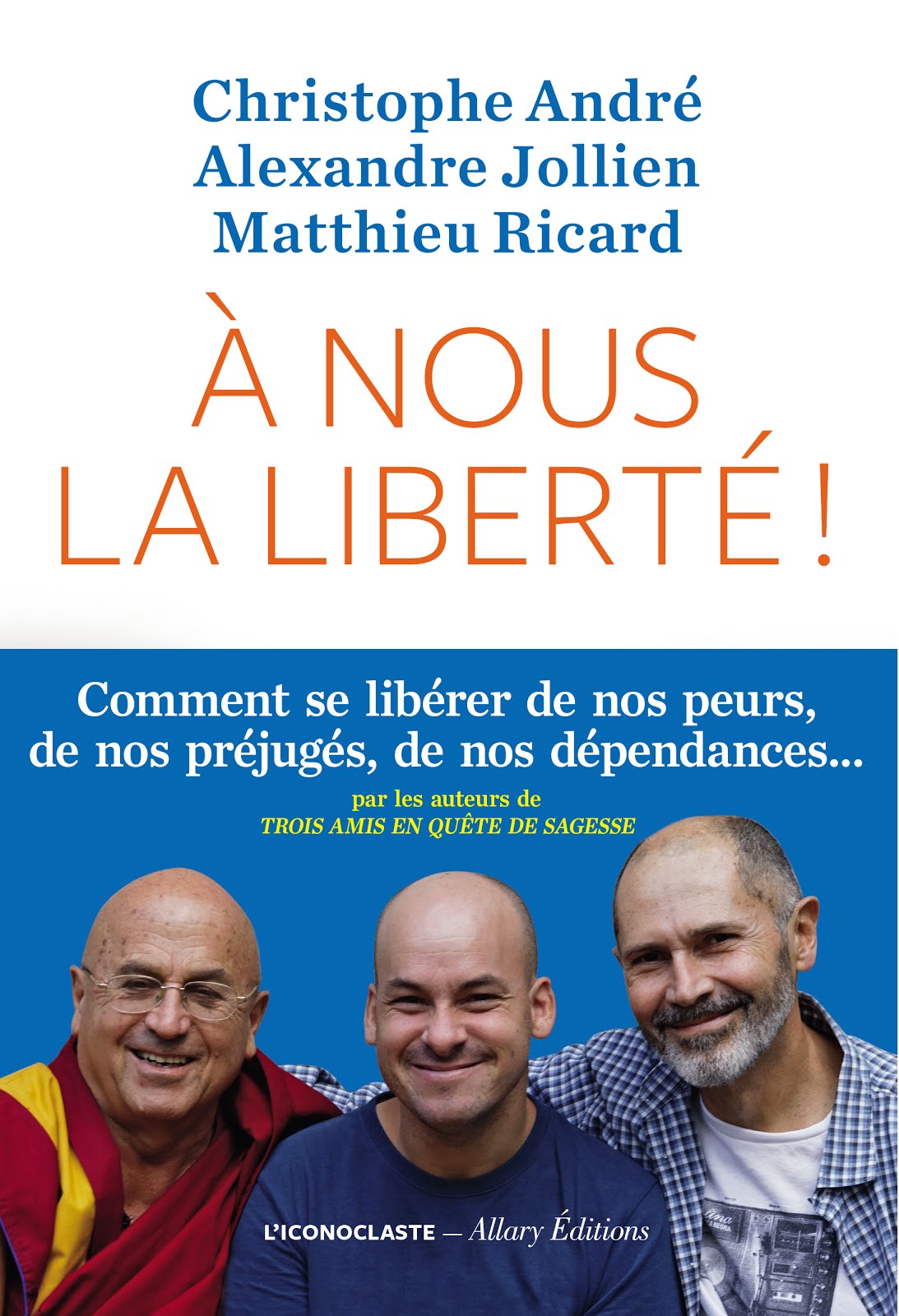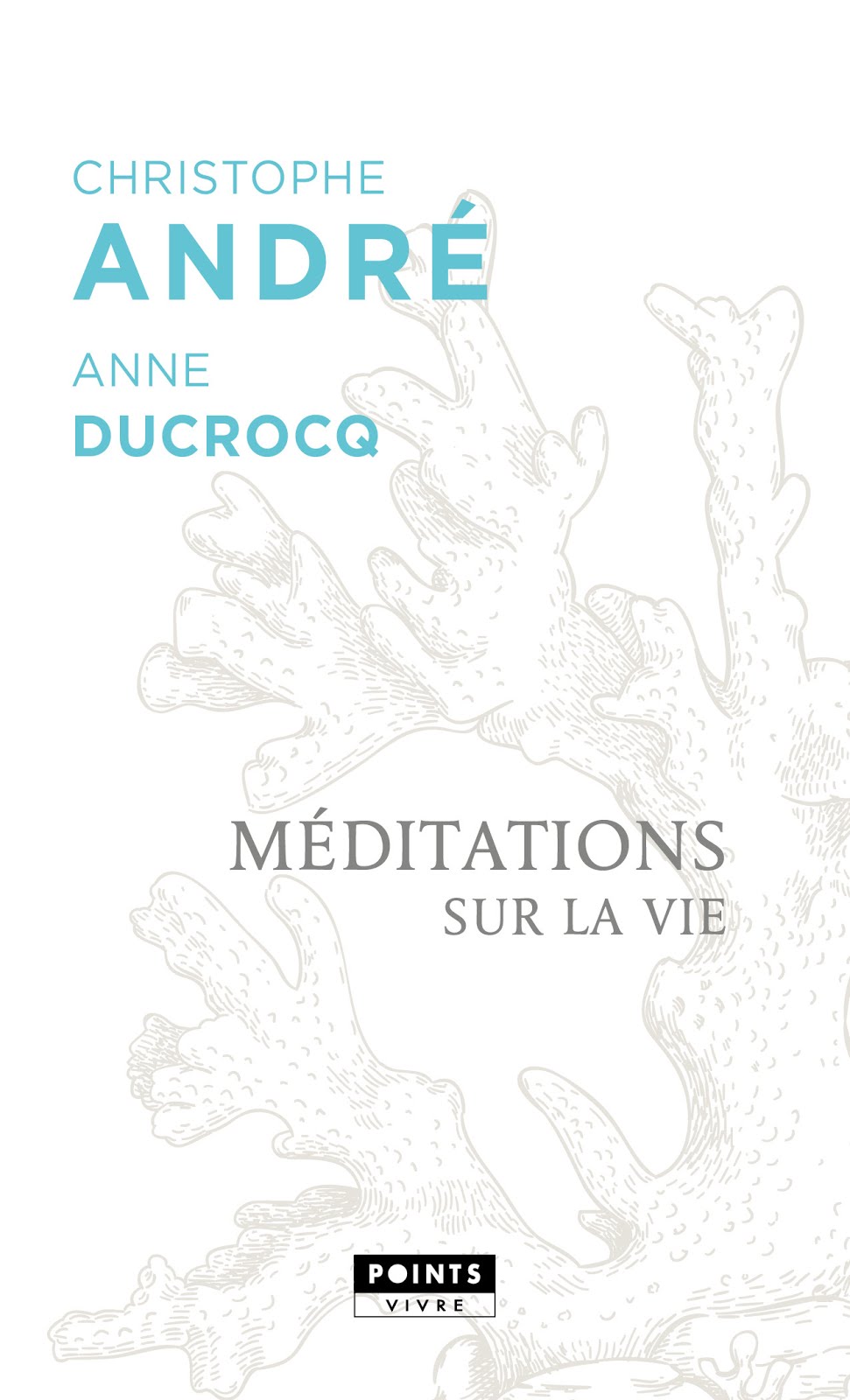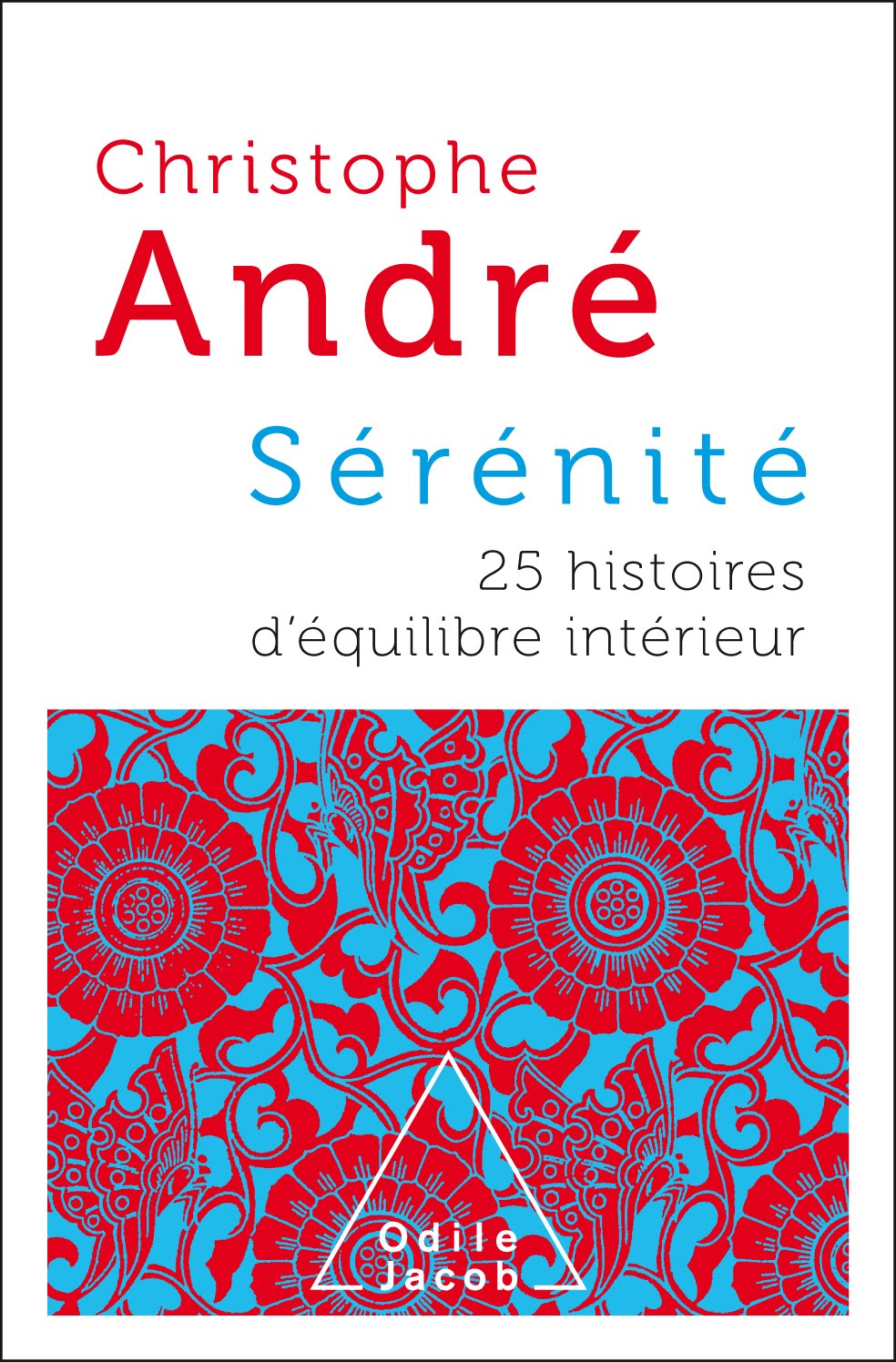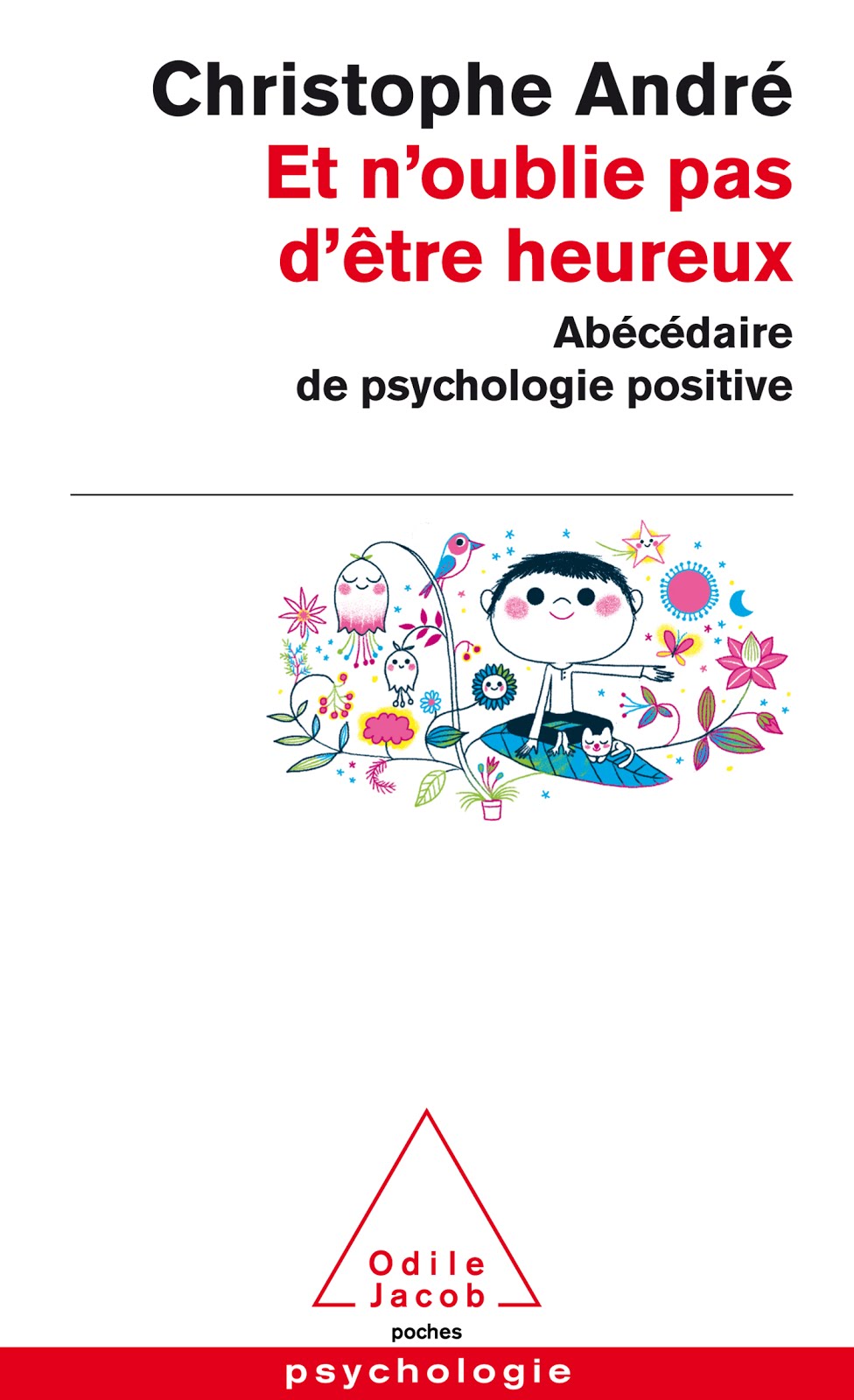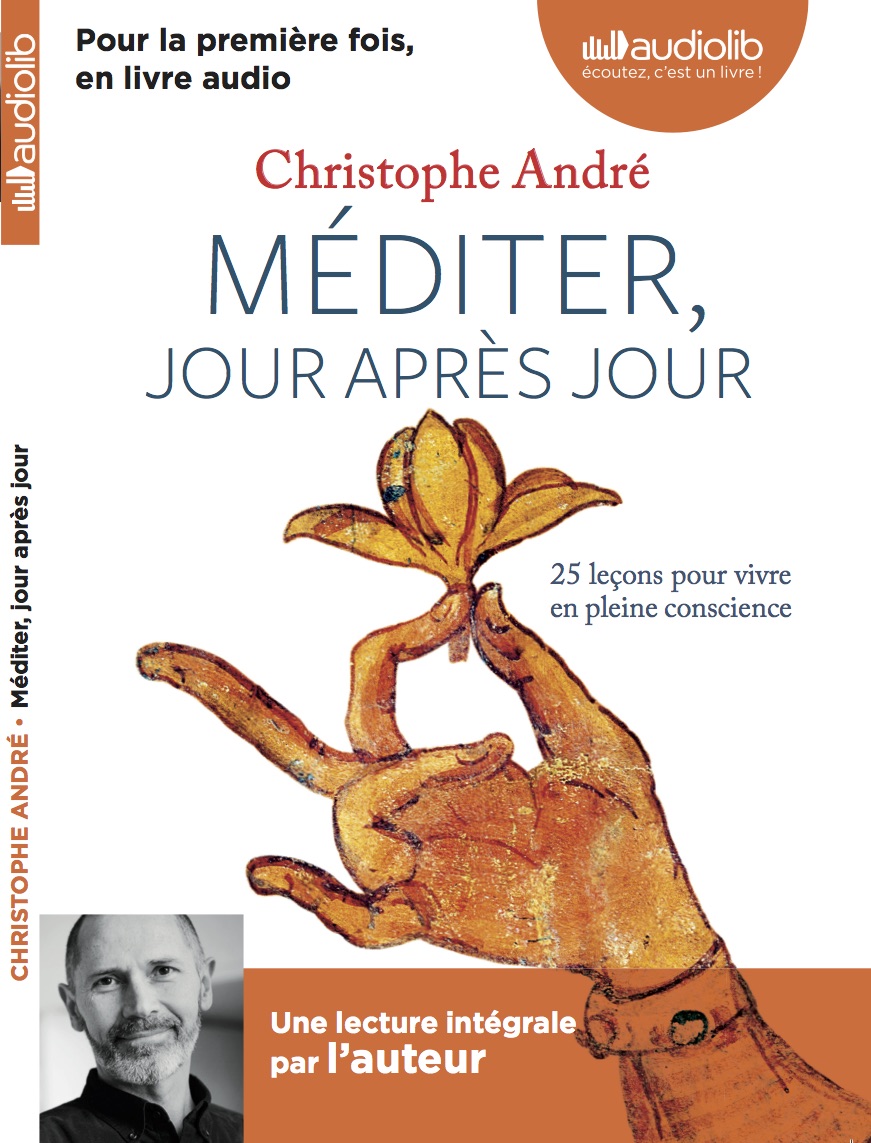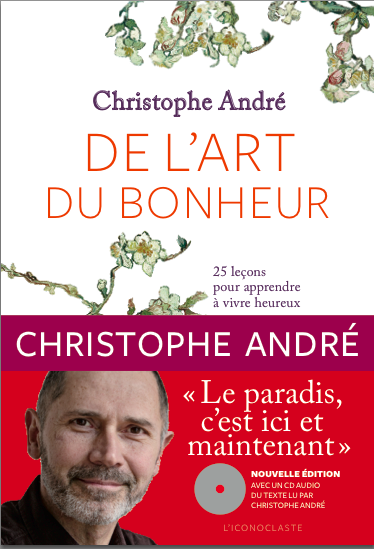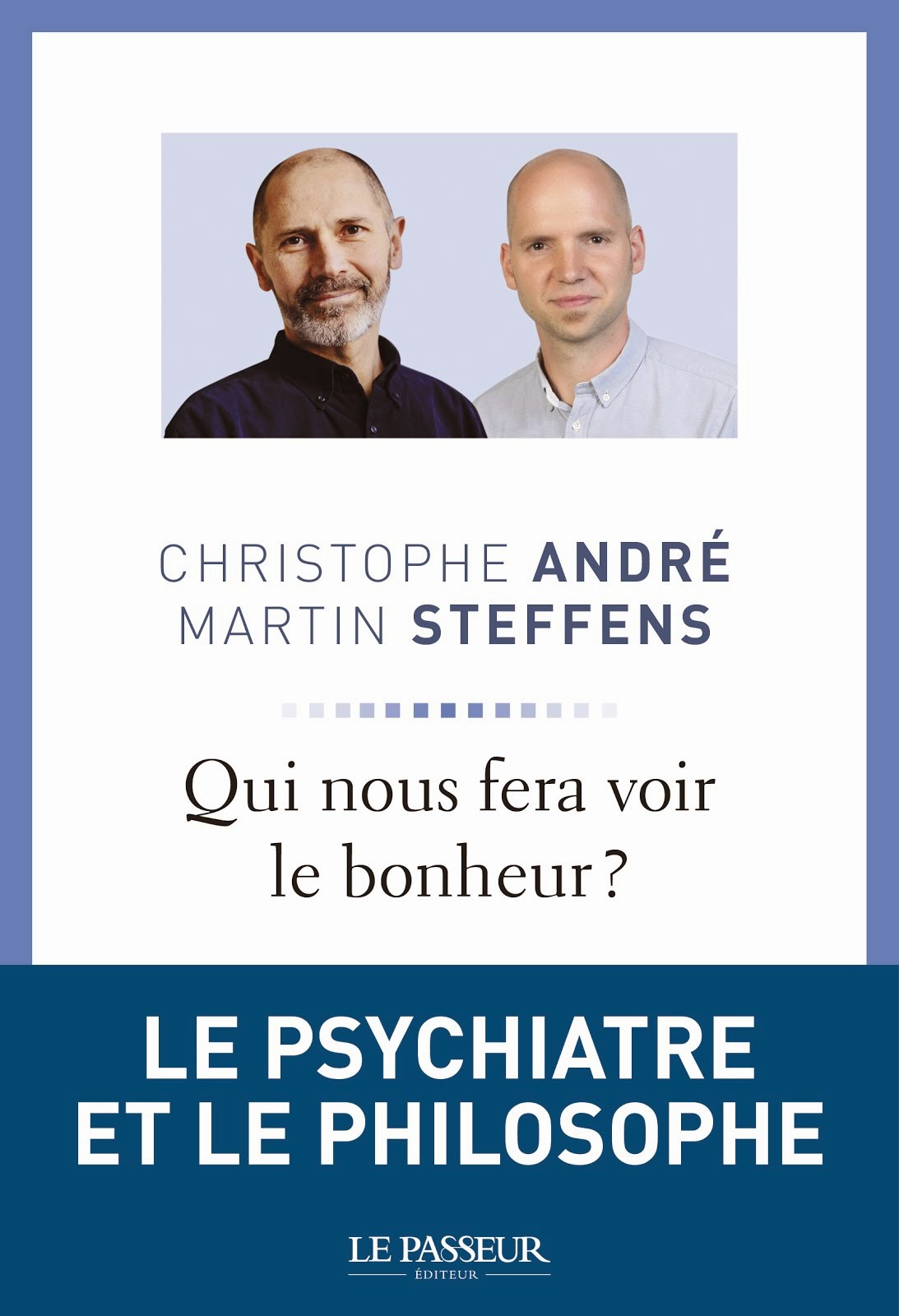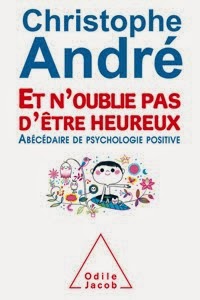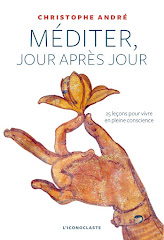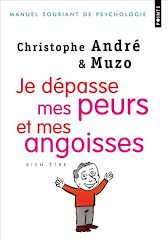lundi 29 janvier 2018
jeudi 25 janvier 2018
Tout le monde a des problèmes !
La scène se passe
l’été dernier, au petit déjeuner, lors d’une discussion avec des amis chez qui
nous sommes en vacances. Vous avez remarqué combien les grands débats au
petit déjeuner sont un des marqueurs du temps des vacances ? On traîne à table,
on prend son temps dès le matin, ce qu’on ne fait guère durant l’année, où le
travail nous attend. On écoute sans juger, on est réceptif…
Nous sommes ce
matin-là en train de discuter des personnalités difficiles, pénibles, des gens
qui nous cassent les pieds dans les temps de cohabitation comme les vacances,
et surtout les proches à problèmes. Nous en arrivons à la conclusion que, parce
qu’on les connaît bien, parce qu’on sait pourquoi ils sont comme ça (soucis
personnels, enfances compliquées, vies insatisfaisantes…) alors, on leur
pardonne et on les supporte en soupirant.
Mais un de nos amis hausse
le ton et rouspète : « Ben oui, mais alors on ne s’en sort
plus ! Si sous prétexte que quelqu’un a des problèmes, on ne peut plus
rien lui dire, s’il faut supporter tous ses comportements, faire les courses et
desservir la table à sa place, se l’appuyer en vacances, alors que tout va
mieux quand il n’est pas là, on va où ? Tout le monde a des
problèmes ! Qui n’a pas de problèmes autour de cette table ? Levez le
doigt ! »
Coup de génie !
Il arrête d’argumenter pour nous impliquer. Évidemment, tout le monde dans le
groupe a des problèmes, même s’ils sont mis entre parenthèses le temps des
vacances : l’une est en plein divorce, l’autre a des soucis de santé
importants, un troisième accompagne sa sœur mourante…
L’ami reprend :
« Voilà ! On a tous des problèmes ! Mais la correction et
la dignité c’est de ne pas faire chier les autres avec ses problèmes !
C’est ça la névrose, ce n’est pas d’avoir des problèmes, d’avoir une histoire
personnelle compliquée, mais c’est de les faire peser sur les autres, ses
problèmes ! » Le débat démarre, mais je n’y participe pas. Je suis en
train de suivre mes pensées…
Je me dis que ce
n’est pas si mal comme définition ! Ce n’est pas celle que j’utiliserai
dans mon métier, mais au fond, c’est un repère simple, à la fois pour chacun de
nous (« est-ce que je ne suis pas en train de peser sur autrui avec mes
soucis ? ») et pour la cohabitation avec nos proches compliqués
(« j’ai moi aussi le droit de profiter de mes vacances, et de la vie, sans
passer mon temps à écouter ses plaintes et à faire sa part de travail »).
La psychologie, c’est bien, ça nous aide à ne pas juger et réagir trop vite, à avoir une vision plus complexe et subtile des humains ; mais parfois c’est bien aussi de revenir à quelques fondamentaux simples. Cela n’empêche pas compréhension, bienveillance, et compassion par ailleurs. Mais c’est un petit rappel de nos droits personnels qui ne fait pas de mal…
La psychologie, c’est bien, ça nous aide à ne pas juger et réagir trop vite, à avoir une vision plus complexe et subtile des humains ; mais parfois c’est bien aussi de revenir à quelques fondamentaux simples. Cela n’empêche pas compréhension, bienveillance, et compassion par ailleurs. Mais c’est un petit rappel de nos droits personnels qui ne fait pas de mal…
Illustration : un poisson qui n'a plus de problèmes (mosaïque à Pompéi).
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en novembre 2017.
lundi 22 janvier 2018
samedi 20 janvier 2018
Love, love, love
Il y a des gens qui disent en avoir "marre de la bienveillance" et des bons sentiments, lorsqu'on les évoque (trop, selon eux) dans les médias.
D’abord, que moi je n’en ai pas marre de la
bienveillance ! J’en aurais plutôt marre de l’égoïsme, de l’incivisme, du
cynisme. La bienveillance, je trouve qu’il y a encore beaucoup de place pour en
accueillir davantage dans notre quotidien et notre société !
Quand on est bienveillant, on fait du bien à son prochain,
ce qui représente déjà une raison suffisante pour l’être.
Mais on s’en fait aussi à soi-même. Attention, je ne parle
pas de l’autosatisfaction, du plaisir qu’il pourrait à y avoir à se montrer
bienveillant (encore que, pourquoi pas ?). Non, je parle de l’état de
notre corps. Avez-vous déjà observé dans quel état est votre corps quand vous
pensez et agissez avec bienveillance, amour, affection, gentillesse ? Et à
l’inverse, avez-vous pris le temps d’observer dans quel état la colère,
l’agacement, la mesquinerie, l’envie, le ressentiment mettent ce même
corps ? Eh oui, la bienveillance est bonne pour ceux qui la reçoivent et
aussi pour ceux qui l’émettent.
Et puis, au-delà de nos petites personnes, elle est importante
pour toute forme de vie en société : la bienveillance aide à s’entraider
pour affronter les difficultés et l’adversité, à se faire confiance et à
s’apprécier les uns les autres. Elle embellit les rapports humains : c’est
elle qui est la source du respect, du sourire, de la politesse, de l’écoute
pour les inconnus ; de la tendresse, du réconfort, de l’affection, de l’amour
pour les proches. Si tout ça n’existe pas, alors à quoi bon vivre ?
La bienveillance est très importante donc. Tellement importante
qu’on en attend peut-être trop… Un peu comme avec l’amour, dans les années 60
et 70. Ah ! l’idéal baba-cool… Quand on pensait, comme les Beatles, en
1967, que chanter la paix et l’amour, le fameux slogan hippie Peace and Love, pouvait les faire
advenir…
Changer le monde par l’amour et la bienveillance ! Ça
serait bien, et ce serait une manière agréable de faire.
Mais hélas, la bienveillance ne suffit pas.
Elle est une base merveilleuse pour les rapports entre
humains, mais elle ne peut pas servir de pratique politique. Elle ne fait hélas
reculer ni les tyrans ni les terroristes. Sa propagation aide à changer les
esprits et les habitudes. Mais ce qui fera décliner la violence, par exemple,
ce n’est pas la seule bienveillance. Ce qui fait reculer la violence dans le
monde depuis des siècles, puisqu’on sait aujourd’hui que la violence recule, ce
sont les lois et les règles, l’émergence d’états organisés et démocratiques, les
échanges et le commerce qui forcent les humains à se parler les uns les autres,
l’amélioration de la condition des femmes, l’accès à l’école et à l’éducation…
Mais, ce qui rend le quotidien vivable depuis des siècles,
depuis toujours, c’est la bienveillance que nous recevons et donnons
régulièrement. Elle est, tout simplement, la composante essentielle et indispensable
de toute vie en société.
En
plus, quoi de plus simple ? Il est sans doute très difficile d’être toujours
bienveillant, à moins d’être un saint. Mais il est tellement facile de l’être
plus souvent…
Illustration : une manifestation pacifique en faveur de la bienveillance (David Plowden, 1964).
PS : ce texte reprend ma chronique du 17 octobre 2017, dans l'émission de mon ami Ali Rebehi, "Grand bien vous fasse", tous les jours de 10h à 11h sur France Inter.
vendredi 12 janvier 2018
mercredi 3 janvier 2018
Trampoline
Au printemps
dernier, nous participons à un stage de méditation, avec un petit groupe de proches, d’amis et de cousins. Nos pratiques
méditatives ont lieu le matin, et l’après-midi est consacré à des activités
libres : marche silencieuse en pleine conscience, ou balade en plein
bavardage, etc. Le tout dans un beau village de vacances, au bord d’un lac
perdu dans une grande forêt. Avec, dans un coin, de magnifiques trampolines…
Une de nos filles est
du déplacement. Un soir, elle m’invite à aller rebondir avec elle sur ces
engins. J’accepte, un peu pour lui faire plaisir, un peu pour essayer, car je
n’en ai jamais fait de ma vie, et que ça m’amuse. Je ne suis pas très
tranquille lors des premiers sauts : mon corps n’est pas habitué à ce
truc, j’ai du mal à assurer mon équilibre, une fois propulsé en l’air.
Puis peu à peu, j’y arrive, je ressens du plaisir et même une légère euphorie à faire de grands bonds vers le ciel ; je comprends clairement l’expression « sauter de joie », et je comprends aussi, à cet instant, que si la joie fait sauter en l’air, sauter en l’air peut donner de la joie. C’est comme pour le sourire, ça marche dans les deux sens.
Puis peu à peu, j’y arrive, je ressens du plaisir et même une légère euphorie à faire de grands bonds vers le ciel ; je comprends clairement l’expression « sauter de joie », et je comprends aussi, à cet instant, que si la joie fait sauter en l’air, sauter en l’air peut donner de la joie. C’est comme pour le sourire, ça marche dans les deux sens.
Je commence à
prendre confiance, et je tente des figures acrobatiques. Mon corps a de nouveau
peur, et me dit « non, non, ça suffit comme ça, contente-toi de sauter en
l’air normalement ». Mais mon cerveau n’est pas d’accord :
« quoi ? toi, le spécialiste de la peur et des phobies, qui a
encouragé tant de personnes à affronter leurs peurs, voilà que tu te dégonfles ? que
diraient tes patients s’ils te voyaient obéir à ta peur ? »
C’est vrai, après
tout ! Pourquoi ne pas apprivoiser ma peur ? Peu à peu, je tente les
sauts en arrière. Au début, c’est minable. Et puis, j’y arrive ! Ça
marche ! Je me jette en arrière et je rebondis en arrivant à retomber sur
mes pieds. Là, ce n’est plus de la joie, ni de l’euphorie, c’est carrément de
l’ivresse.
Les grecs de l’Antiquité mettaient en garde contre l’hubris, cet orgueil lié aux succès, qui pousse à aller trop loin. Mes galipettes de plus en plus réussies me précipitent dans l’hubris. Et dans le saut de trop : grisé par mes bonds, je me lance dans un dernier salto arrière.
Crac !
Une violente douleur dans le dos m’annonce qu’il y a un souci. Je reste le souffle coupé, immobile sur mon trampoline, à regarder le ciel et à évaluer la douleur ; je pense à une fracture. C’est presque ça : tassement vertébral de la première lombaire.
Les grecs de l’Antiquité mettaient en garde contre l’hubris, cet orgueil lié aux succès, qui pousse à aller trop loin. Mes galipettes de plus en plus réussies me précipitent dans l’hubris. Et dans le saut de trop : grisé par mes bonds, je me lance dans un dernier salto arrière.
Crac !
Une violente douleur dans le dos m’annonce qu’il y a un souci. Je reste le souffle coupé, immobile sur mon trampoline, à regarder le ciel et à évaluer la douleur ; je pense à une fracture. C’est presque ça : tassement vertébral de la première lombaire.
On vient me secourir,
on me plaint ; puis mon épouse m’engueule : « tu te rappelles
que tu as 60 ans ? et qu’à 60 ans on ne fait pas le pingouin sur un
trampoline ? » Ben non, j’avais oublié mon âge et mon inexpérience.
Mais je ne regrette rien. Au moins une fois dans ma vie, j’aurais compris, dans mon corps, pourquoi la joie est associée aux sauts ; et j’aurais ressenti ce que ressentent alors les tout petits enfants.
Mais je ne regrette rien. Au moins une fois dans ma vie, j’aurais compris, dans mon corps, pourquoi la joie est associée aux sauts ; et j’aurais ressenti ce que ressentent alors les tout petits enfants.
Illustration : Plongeur, par Marc Riboud.
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en octobre 2017.
Inscription à :
Articles (Atom)