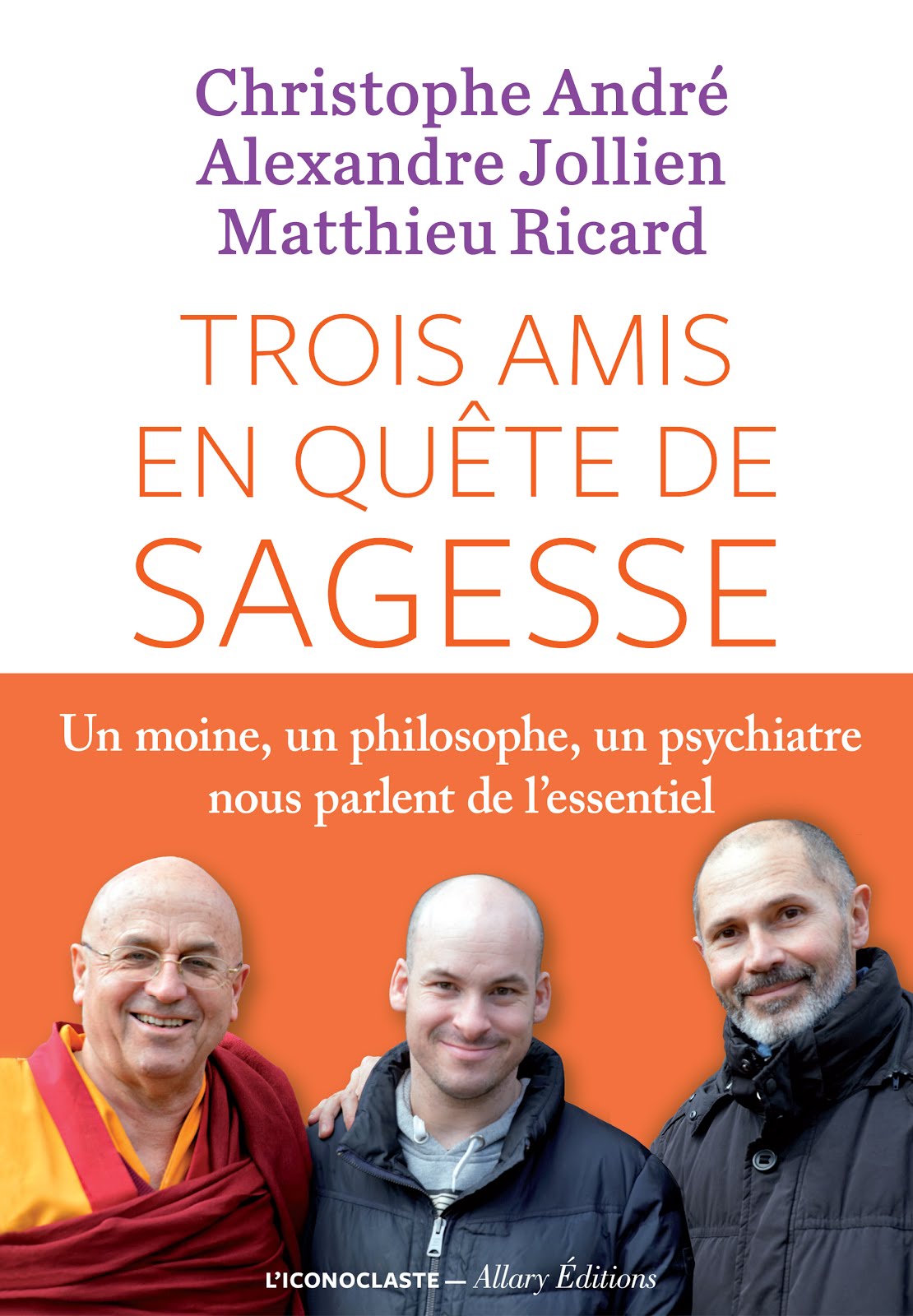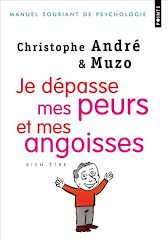lundi 11 février 2013
Voyages de tristesse
Tous ces voyages où l’on va vers de la tristesse et du chagrin : visite à un proche très malade, enterrement d’un ami. La tonalité du voyage est grave, douloureuse, mais aussi étrange, lestée d’une pesanteur inhabituelle à nos vies.
Le voyage ressemble à la marche dans une forêt où aucun oiseau ne chanterait ; aucun pas n’est léger ni anodin, chacun nous rapproche de la souffrance, et de la mort, redoutée ou advenue, de la personne que l’on aime, et un peu la nôtre aussi.
Tous les détails nous touchent, toutes les rencontres sont intenses. Le visage de la réceptionniste de l’hôtel où l’on va poser sa valise, le regard de l’infirmière qui nous accueille à l’hôpital et nous indique la chambre, l’odeur du couloir, l’entrée et le premier regard. Ou le parvis de l’église, puis le son des graviers des allées du cimetière.
Faire bonne figure, ne pas ajouter de la tristesse à la détresse. Doucement sentir de quoi il est possible – peut-être nécessaire - de parler. Quels sont les bons gestes, les bons mots. Ne pas faire semblant de quoi que ce soit, mais ne pas non plus pleurer là où il faudrait consoler, ne pas non plus en rajouter dans la gravité là où il faudrait parler du ciel, du soleil, de la vie. Sentir tout cela, être intensément présent.
Chaque seconde est habitée. Chaque parole, chaque silence pèsent des tonnes. Plus rien de léger. Goût de tragique dans chaque respiration (tragique : tout ce qui nous rappelle que la souffrance et la mort ne sont jamais loin des rires et de la vie). Mélange indicible d’’états d’âme : tristesse, incrédulité, extrême sensibilité aux détails, perméabilité à tout. On respire un air venu du monde des morts, on marche au bord d’un gouffre. Et les oiseaux chantent quand même, tout autour de nous. Les nuages passent quand même dans le ciel, là-haut.
Puis le voyage de retour. Pas de soulagement, juste du répit, la pression est moins forte, peut-être. On est bousculé de souvenirs que l’on est totalement incapable d’organiser pour en faire un récit, souvenirs animaux et bruts : des images, des sons, des odeurs, des impressions, des vertiges, des d’émotions. Pas de sens à donner à tout ça, pas de sens. Juste de la souffrance ouatée, avec des pointes violentes parfois, qui nous forcent à respirer plus fort, à regarder plus attentivement tout ce qui défile par la fenêtre du train, pour nous reconnecter à la vie.
Puis la lente digestion de tout ce que l’on a vécu. Impression qu’il va être impossible ou très compliqué de reprendre le cours de son existence. Et certitude pourtant qu’on le fera. Facilement : l’action est antalgique, l’action est amnésiante. Et que cette facilité à se remettre dans la vie après avoir côtoyé le monde de la mort sera à la fois rassurante et inquiétante.
Et puis un éclat qui éclaire tout. Comme ce passage d’un livre de Christian Bobin, le poète médecin des âmes, dans ce qui me semble être son chef d’œuvre (merci Catherine), Prisonnier au berceau :
« Je compris aussi très vite que l’aide véritable ne ressemble jamais à ce que nous imaginons. Ici nous recevons une gifle, là on nous tend une branche de lilas, et c’est toujours le même ange qui distribue ses faveurs. La vie est lumineuse d’être incompréhensible. »
Et c'est la brèche où rentre le soleil...
Illustration : Un ange au violon, par Francesco Botticini ; celui qui nous envoie des gifles et du lilas ?