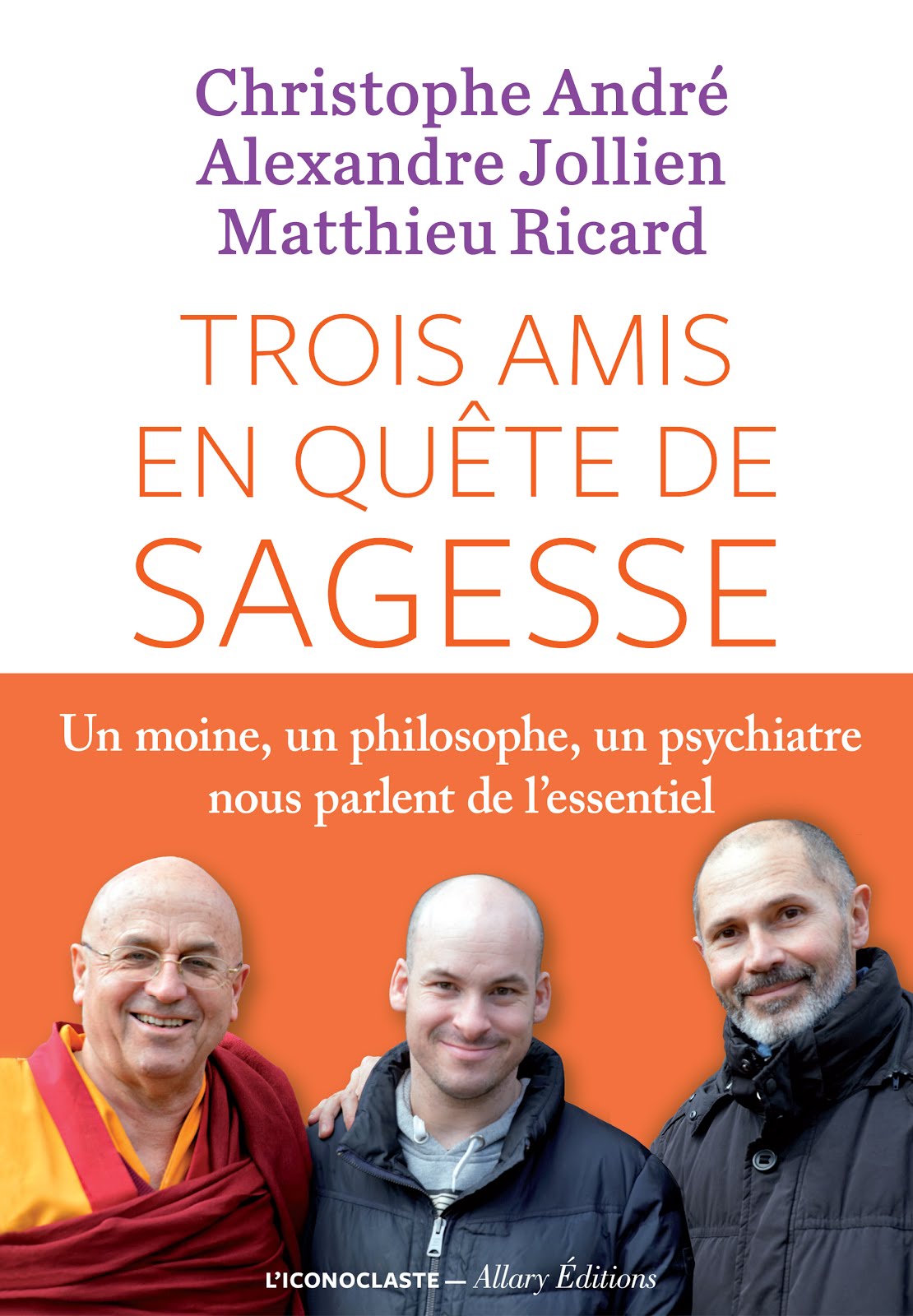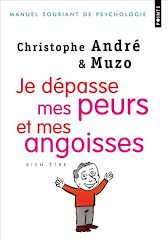Je suis heureux de vous annoncer la parution aujourd'hui de notre nouvel ouvrage collectif : "Les psys se confient".
Je suis heureux de vous annoncer la parution aujourd'hui de notre nouvel ouvrage collectif : "Les psys se confient".
Avec une vingtaine de collègues et ami(e)s, nous y racontons nos motivations (ou obligations...) à devenir psychothérapeutes, et tout ce que cet incroyable métier nous a apporté et révélé sur la nature humaine en général, et sur la nôtre en particulier !
Nous nous sommes livrés à cet exercice avec la conviction que ces récits et remarques ne représentent pas seulement de simples autobiographies introspectives, mais aussi une source de réflexion et d'inspiration pour nos lecteurs, qu'ils soient eux-mêmes thérapeutes ou non.
Voici, en avant-goût, un extrait de chacun des chapitres composant le livre...
Christophe André : Un tramway nommé La Vie
« J’avais hérité de bons gros gênes anxieux et dépressifs, mais pas des modes d’emploi pour les désactiver : mes parents et mes proches avaient assez à faire avec leur survie matérielle et leurs propres difficultés, ils n’allaient pas en plus s’embarrasser à être des modèles de bonheur et d’équilibre ; cela ne faisait partie ni de leurs priorités ni de leurs possibilités. »
Nicolas Duchesne : Ce bouquet de souvenirs en partage
« Depuis une quinzaine d’années, je pleure très facilement devant un film, toujours dans les moments heureux, retrouvailles plus ou moins attendues, pardon généreux ou autres happy-end, ce qui ne cesse de faire ricaner mes deux grands garçons et d’attendrir mes deux filles. »
Bernard Geberowicz : L’Accro du lien
« Je subissais, dans le même temps, l’apprentissage de l’antisémitisme, en côtoyant, au lycée, l’extrême-droite d’après 68. Je me faisais traiter de « bolcho » et de « future savonnette » par des gens que je ne connaissais pas, et qui ne m’avaient jamais parlé. Je ne comprenais pas comment ces extrémistes pouvaient faire des généralités : quelle folie ! »
Fatma Bouvet de la Maisonneuve : Je suis deux fois psychiatre
« Nous, les psychiatres, nous pouvons être les premiers à sonner l’alerte car nous sommes parmi les premiers à pouvoir détecter de nouveaux comportements alors même qu’ils s’inscrivent encore dans l’intimité et n’ont pas débordé sur la vie publique. »
Sophie Cheval : Le choix de Sophie
« Le sentiment de ne pas être à la hauteur et la peur d’échouer deviennent mes compagnons de route : ce qui, auparavant, était seulement présent en moi avant un contrôle de maths (« je ne vais jamais y arriver, je suis nulle ») devient une petite ritournelle permanente, chantonnée par une radio intérieure qui ne s’éteint jamais, et qui joue au volume maximum les veilles d’examens ou de concours. »
Claude Penet : Comment imaginer Sisyphe heureux ?
« L’intitulé d’une série d’articles d’un magazine qu’enfant j’avais l’occasion de parcourir m’est revenu comme une question persistante : “La personne la plus extraordinaire que j’ai connue“. À chaque fois que j’y réponds, c’est l’image de mon père qui me vient. Non pas qu’il ait accompli des exploits surhumains, mais plutôt qu’il incarne une humanité qui me touche profondément. »
Caroline Duret : Quand je serai grande, je serai psy
« La médecine a sauvé ma mère. Même si la crainte d’une récidive a plané encore pendant plusieurs années, j’ai fini par guérir de ma cancérophobie. Comment accepter que des êtres humains vivent avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête ? Tout me semblait désormais futile et vain, seul comptait faire médecine ! »
Stéphanie Hahusseau: Yes we can, mais pas tout !
« Je commençais à me sentir épuisée. Je commençais à me dire que c’était trop lourd. Je commençais à me demander si ça valait la peine. A quoi bon ? Le tout dans un contexte de difficultés financières qu’on n’imagine jamais chez les médecins. Je n’étais pas déprimée car il m’arrivait de pouvoir m’amuser et rire mais c’était très rare. Je n’avais plus le temps de penser à moi, à des activités de détente. »
Christian Gay : Mais tu es né psychiatre ! (Born to be psy)
« Mais ma carrière de cancre avait commencé dès les plus petites classes, ce qui avaient conduit le responsable de l’établissement à conseiller un examen pédopsychiatrique (dont je n’ai jamais eu les résultats), puis ultérieurement mon professeur de français à m’encourager vivement à renoncer aux études pour aller vendre des frites. »
Bruno Koeltz : On ne devient pas psy par hasard
« Assez rapidement mon humeur s’altéra et ce que je pensais n’être qu’un simple coup de déprime, somme toute bien naturel, fit petit à petit place à une vraie dépression qui m’amena à consulter… un psychiatre. »
Yasmine Lienard : Rassembler ce qui est épars
« J’ai connu des périodes tristes de profond désespoir mais qui m’ont fait rechercher dans la poésie, l’art et la philosophie un apaisement.
Je commençais donc déjà à tenter de réunir les fragments en moi, les pôles opposés : ma joie et ma tristesse, mes origines orientales et occidentales, mon amour pour moi et ma tendance critique et exigeante envers moi-même. »
Anne Lorin : Les histoires qui m’ont faite psy
« L’anxiété sociale m’empêchait de vivre : dès qu’il y a plus de deux personnes, je ne peux plus « en placer une » ; mais j’ai aussi hérité du côté taiseux de mon père. L’éreuthophobie : rougir dans les situations embarrassantes : en l’occurrence pour moi, toute situation où la simple proximité d’un autre, de plusieurs autres, génère une angoisse : mes joues s’embrasent, chauffent, et virent au rouge, quelquefois une seule joue, du côté où se trouve la personne qui m’angoisse le plus… Ai-je guéri ? »
Joël Pon : La Vierge et le berger
« Mais tu es fou mon pauvre, tu es fou, on ne fait pas berger quand on a son bac ! Tu es fou ou malade ! Si tu ne sais pas que faire, viens au moins en médecine, il y a de jolies filles et on rigole ! {…} Je suis donc devenu berger des âmes en souffrance. Je tente de ramener les égarés perdus dans des goulets périlleux, j’aide aux passages escarpés de la vie, je panse les blessures des âmes, je tente de rassurer devant la peur du loup et je propose l’abri sûr quand vient l’orage."
Claire Mizzi : Être en harmonie avec soi-même, les autres et le monde
« Je me demandais quelle valeur je pouvais bien avoir aux yeux des autres. Je dormais mal. Mon langage et mon orthographe étaient brouillons, mon attention dispersée. J’ai beaucoup affabulé, m’inventant alors des histoires pour me rapprocher des autres et, sans doute aussi, pour rêver. »
Jean-Louis Monestes : Explorer le monde et l’aimer
« En haut de l’amphi, c’était la cour des miracles ! On remarquait d’abord un épais nuage de fumée. Puis, entre les volutes, il y avait tout ce que l’époque comptait de modes capillaires et vestimentaires underground : des punks aux cheveux décolorés, des babas-cools hirsutes aux robes balayant le sol, quelques new-wavers les yeux cernés de mascara noir, certains assis par terre, d’autres sur les tables, trois d’entre eux jouant de la guitare. Il y avait même un chien ! »
Didier Pleux: Histoire d’un psy révolté
« “C’est pas juste !“, cette phrase va s’ancrer en moi et m’imprégner pendant de nombreuses années. J’étais trop jeune pour envisager un futur métier d’aide aux personnes, mais je me promettais qu’il n’y aurait plus de “C’est pas juste !“, que je ferai tout pour que les enfants aient de beaux jouets à Noël ! »
Stephane Roy : Quand agir c’est exister
" Je réalise aujourd’hui à quel point c’est le sentiment de honte qui était le moteur de ma timidité et inhibait mes actions par peur des conséquences. Lorsque je me sens honteux, c’est d’abord une image négative de moi-même qui s’exprime. Mon corps devient pesant, mes gestes maladroits, ne sachant pas quoi faire de mes mains. Ce n’est plus uniquement la peur qui est présente mais un sentiment global de malaise. J’ai le sentiment d’être l’objet de l’attention d’autrui, et je crains d’avoir un comportement qui dénote ou de présenter des signes physiques qui viendraient témoigner de mon embarras."
Alain Sauteraud : La psychiatrie, une histoire qui ne se finit jamais ?
« Vers l’âge de 8 ans, un copain du fond de la classe, à la tignasse rousse et frisée, me dit en sortant de l’école à l’heure du déjeuner qu’il va être battu par son père pour ses mauvaises notes. Je ne le crois pas. L’après-midi même, devant ma mine incrédule, il soulève sa chemisette et me montre son dos strié de lignes rouges de sang. »
Marie-Christine Simon : Vivre en quête de sens
" Le bazar – le foutoir – psychologique familial m’habitait et j’en témoignai activement, dans la réalité concrète, matérielle : dès que je fus capable de déplacement, qu’il s’agisse de mon corps ou des objets alentour, un désordre proliférant parut envahir ma chambre, se propageant plus tard au casier de la table d’école, à mon cartable et mes sacs de voyage, aux cours et révisions, à mon premier chez moi, puis aux suivants. Ce jusqu’à plus de trente ans. »
Olivier Spinnler : Accepter les difficultés pour évoluer
“Car Olivier est plutôt timide, voire très timide. Il ne va pas du tout facilement au-devant des autres. Et il se sent comme un alien. Sa mère l’habille toujours en « complet-cravate ». Comme il est toujours consensuel et pas contrariant, il assume. Ça lui vaut régulièrement quelques quolibets dans les corridors et les cours de récréation, mais il a spontanément compris que « l’injure ne qualifie que son auteur ». Il joue de la flûte traversière et il n’aime que la musique classique, contrairement à ses camarades qui ne savent même pas ce que c’est.”
Jacques van Rillaer : Gérer des hasards qui nous conditionnent
« Mes parents sont morts. Une de mes petites filles n’est plus. Des amis et des collègues de mon âge sont décédés. La mort : j’y pense tous les jours. J’essaie de l’appréhender comme un stoïcien. J’en ai très souvent parlé avec des personnes venues pour se délivrer de phobies, d’obsessions et autres troubles anxieux, car ces affections se ramènent souvent à la peur de perdre le contrôle, d’être vulnérable ou de mourir. »
Frederic Fanget : Dans la tête d’un psy
« Quand je me demande pourquoi je ne veux pas souffrir je repense à ma mère blessée, abandonnée à trois ans par sa mère et qui a souffert toute sa vie d’un schéma cognitif d’abandon. Je pense qu’une des raisons (il y en a évidemment beaucoup d’autres) qui m’a amené à la psychiatrie est la volonté de guérir cette blessure psychique que j’ai côtoyée dès mon plus jeune âge auprès de cette mère blessée. J’ai perçu donc dès ma plus tendre enfance que la blessure de l’âme était une souffrance très importante (même si elle est moins mise en valeur que la souffrance physique). C’est d’ailleurs peut-être pour cela que j’ai choisi la psychiatrie et non par la médecine somatique. Entre autres raisons. »