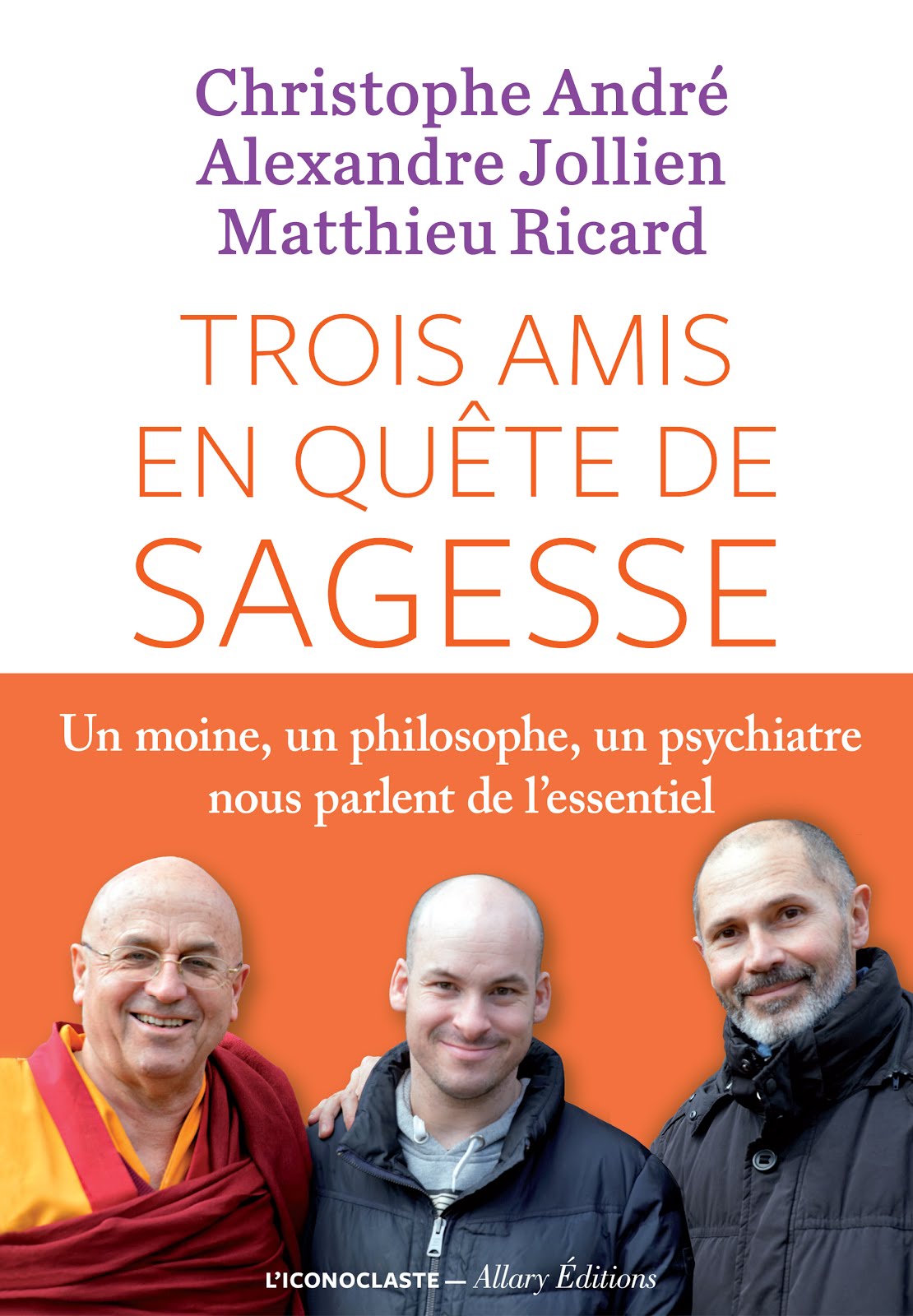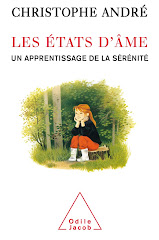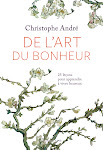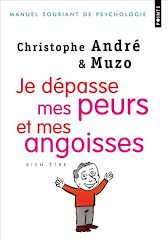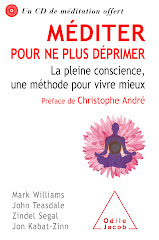L'autre jour, alors que j'étais en scooter sur le boulevard Saint-Germain, au coeur de Paris. Un taxi me double en me frôlant et en roulant trop vite. Arrive un feu rouge. Alors que j'avais remonté toute la file des voitures à l'arrêt (bon, d'accord, c'est mal...) je redémarre tranquille, et avant tout le monde. Cent mètres après, le taxi me double à nouveau, encore plus près, encore plus vite. Du coup, au feu rouge suivant, je m'approche et m'arrête à sa hauteur pour lui parler ; comme il ne baisse pas sa vitre, je lui fais signe de rouler plus doucement. Pas uniquement pour moi, mais je me dis qu'il va provoquer un accident, à la longue.
Le type devient soudainement fou de rage, son visage se décompose, il se met à hurler et m'insulter, vitre toujours fermée. Le feu passe au vert et il redémarre comme un dingue, en laissant la moitié de ses pneus accrochés au bitume, vociférant et m'adressant des gestes hostiles. Je reste sidéré quelques secondes devant le jaillissement de cette violence verbale, avant de penser moi-même à redémarrer.
Mon intervention n'aura servi qu'à l'énerver davantage. Quel imbécile ! Je parle de moi évidemment : comment ai-je pu oublier qu'on n'était pas entre personnes humaines mais entre grands singes motorisés. Ce genre d'intervention ("roule plus doucement mon gars") ne marche jamais. Ou jamais dans le sens escompté, si ce sens est de calmer les énervés. Dans l'autre sens, par contre...
Mais tout de même, ce geyser de folie haineuse m'a secoué, j'y pense toute la journée, je revois la tête du type derrière sa vitre, submergé sous la haine. C'est compliqué et dérangeant de faire une place pour ça dans ma vision du monde. Mais ça existe aussi.
PS : je ne me souviens pas s'il y avait un client à l'arrière. Si oui, il a du avoir un voyage sportif...