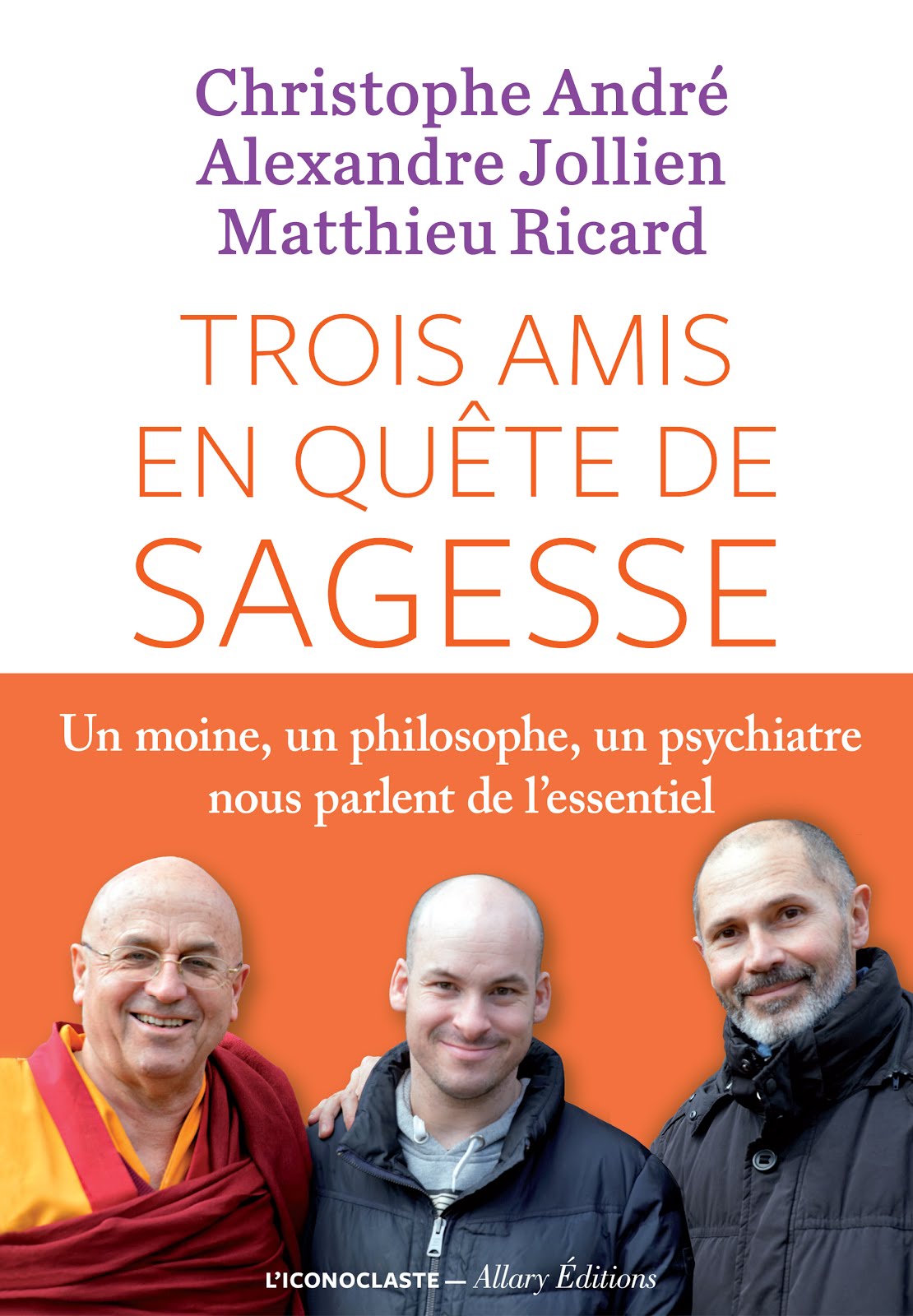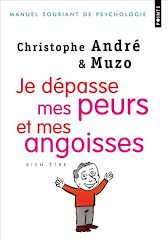Cet été, je m’étais levé tôt, comme tous les matins, et je me marchais sur une grande et belle plage de Bretagne, à marée basse.
Il y avait déjà beaucoup de monde, surtout des joggeurs et des promeneurs. Beaucoup de ces derniers étaient accompagnés de leur chien. Parmi les nombreuses vertus des chiens, en plus de leur capacité à nous donner inlassablement de l’amour inconditionnel, figure celle-ci : ils nous font faire de l’exercice physique, à chaque fois que nous devons les sortir, ils nous arrachent à nos écrans, et souvent nous font faire des rencontres...
Bref, je marchais en regardant tout ce petit monde. Les chiens, notamment, très drôles à observer, dans la variété de leurs personnalités : certains galopant comme des fous, faisant d’innombrables allers et retours vers leur maître ; d’autres ne le lâchant pas d’une semelle. Mais la plupart d’entre eux s’arrêtant, à un moment ou un autre, pour lâcher un petit pipi ou une petite crotte. Comme nous n’étions pas en Méditerranée, ça ne m’agaçait pas trop : la marée nettoierait ça d’ici quelques heures ; et peut-être même que certains poissons ou coquillages ont l’habitude de s’en régaler ? Mais tout de même, ce n’est pas très sympa, en attendant, pour les vacanciers et leurs enfants qui vont arriver tout à l’heure, avant la marée haute…
À ce moment, je vois un monsieur dont le chien vient de faire une crotte s’arrêter et la ramasser délicatement avec un petit sac plastique qu’il avait dans sa poche. C’est la première fois que je voyais ça sur cette plage, un propriétaire de chien assez citoyen pour respecter ceux qui viendraient après lui sans attendre la prochaine marée ! En général, je les vois plutôt dans les rues ou les lieux publics.
Et assez souvent, je vais les féliciter, pour les encourager, les pauvres. Je n’ai pas de chien, mais l’idée de ramasser ses crottes à la main, de les garder quelque part dans mon sac ou ma poche en continuant ma promenade ne m’enchante guère. Alors, je les valorise, ces anonymes de la propreté et de la citoyenneté. Je m’approche du monsieur, qui, me voyant venir, a un regard inquiet, se demandant ce que je lui veux : « Monsieur, c’est super de ramasser les crottes de votre chien. Ce sera génial quand tout le monde fera comme vous ! Félicitations ! »
Ça le fait sourire, il me dit que c’est normal, il a l’air un peu gêné, mais content tout de même que quelqu’un reconnaisse sa bonne et humble action. Du coup, je repars tout léger (j’aime bien les échanges positifs avec des inconnus, il me semble que ça rend le monde un peu plus souriant et agréable) et je me demande ce que je dois faire maintenant avec tous les autres, la majorité, que je vais voir ne pas ramasser les crottes de leur chien. De temps en temps, je les engueule : « c’est dégueulasse, pourquoi vous ne ramassez pas ? ». Mais le plus souvent, je ne dis rien, pour plein de raisons : pas envie de vivre un conflit, même légitime ; sentiment que ça ne servira à rien ; et parfois, par pitié pour le maître, qui me semble trop âgé pour se baisser…
Là, sur la plage, finalement, je n’apostrophe pas les propriétaires égoïstes (« mon chien chie et je m’enfuis ; pour les autres, tant pis »). Pas envie de me gâcher la balade par une querelle de plage ; même si je sais que j’ai raison, ça me fait battre le cœur un peu plus vite, ça me met de mauvaise humeur pour le reste de la promenade.
Il fait beau, c’est un de mes derniers jours de vacances, je préfère détourner le regard vers l’océan, le ciel magnifique, et écouter la rumeur sourde des vagues inlassables. Les remontées de bretelles des indélicats, ce sera pour Paris…
Illustration : Chien et passant à Neuilly, par Elliott Erwitt...
PS : cet article a été initialement publié dans la revue Kaizen à l'automne 2016.