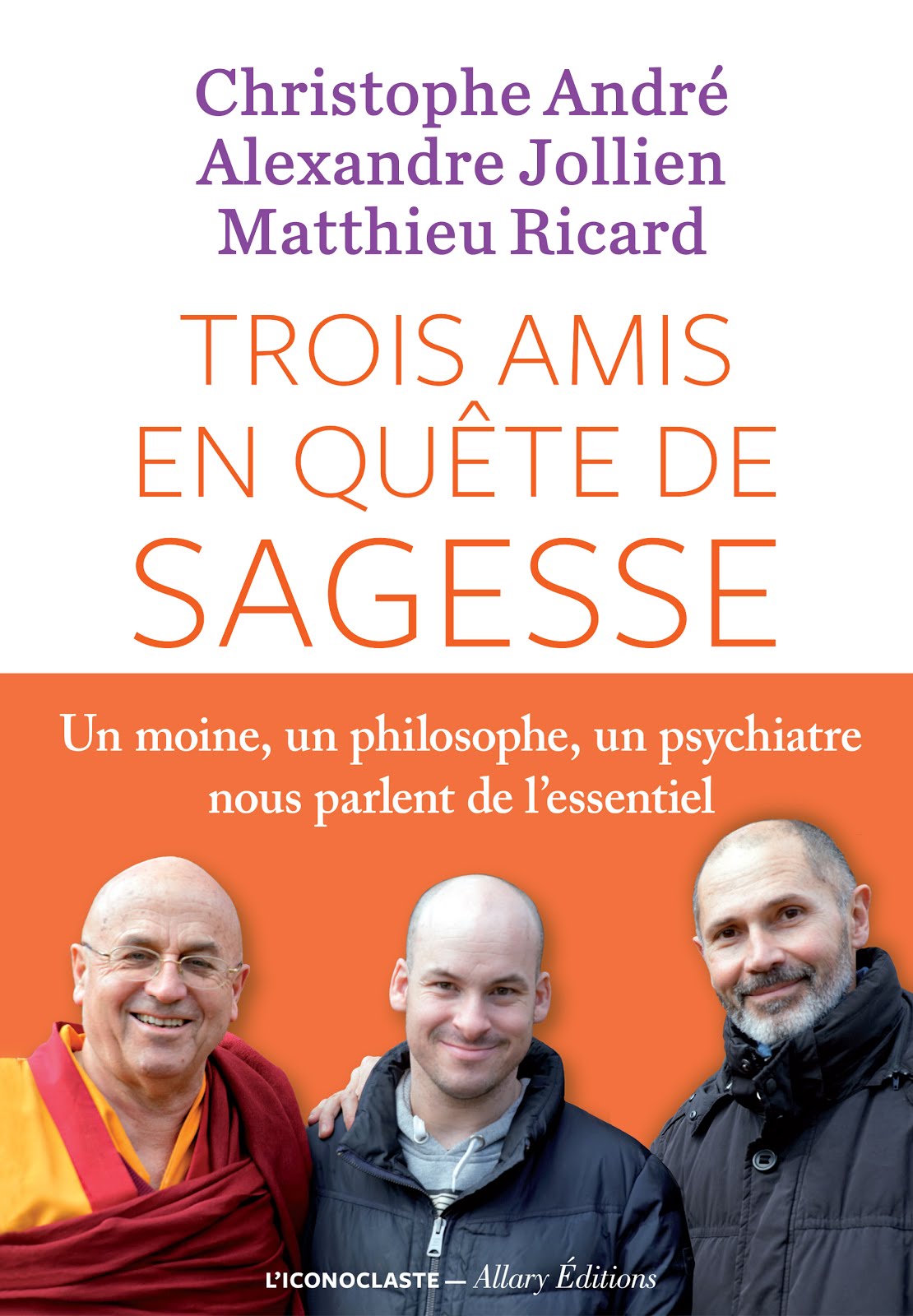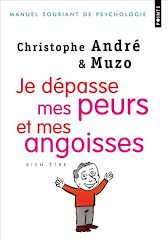lundi 21 mai 2012
« Que des ennuis... »
Il m’arrive toujours plein de choses intérieures sur les quais de gare. Je ne sais pas pourquoi, ce doit être le cocktail idéal pour mon psychisme à moi : un peu de stress, un peu de temps, un peu de changement…
Donc, ça se passe sur un quai de gare, en attendant un TGV de retour vers Paris. Je suis assis sur un banc tranquille, en bout de quai. Sur le banc voisin une dame parle dans son portable. Elle doit discuter avec quelqu’un qui habite loin, car elle parle très fort (on a montré ça, dans quelques études : même si la liaison est parfaite, on hausse le ton si le correspondant est à Tokyo, mais on parle normalement s’il est dans la rue voisine). Du coup, j’entends tout ce qu’elle raconte. Mieux : je l’écoute attentivement. Car à cet instant, je n’ai rien d’autre à faire, je suis de bonne humeur, il fait beau et doux, je me sens bienveillant et prêt à m’ouvrir à tout, à tout accepter, à tout trouver intéressant. Et de fait, ça l’est.
La dame se plaint : «On n’a que des ennuis !» Puis elle raconte tous les ennuis en question : l’internet qui est tombé en panne, le plombier qui devait venir faire des réparations et qui n’est toujours pas là, elle est en conflit avec une amie, etc.
Comme je sors d’un congrès où nous avons parlé de sclérose en plaques, évidemment, je me dis que tous ces ennuis ne sont pas méchants, et qu’elle devrait survivre à tout ça. Je repense à cette phrase de Cioran : «Nous sommes tous des farceurs : nous survivons à nos problèmes». Puis, ma petite voix intérieure fait son boulot d’autorégulation et de dégonflement de l’ego, et s’invitant dans la discussion, elle rajoute : «Ne fais pas le malin, tu es exactement comme elle ! Si ton internet et ton plombier te plantaient, tu aurais la même envie de te plaindre et de dire que tu n’as que des ennuis...» C’est vrai. Sans le savoir, cette dame inconnue me donne une leçon.
D’ailleurs, c’est fini, je ne l’écoute plus (elle continue car elle a plein d’autres ennuis, en fait), ses soucis ne m’intéressent plus. Ce qui m’intéresse, c’est la place que ces soucis bénins prennent dans sa vie. Et celle que les miens prennent dans la mienne. Je réfléchis à mes propres tendances à la plainte excessive et inutile. J’ai progressé pourtant, mais je me dis qu’il faut que je progresse encore.
Mais là, je n’ai pas envie de poursuivre ma réflexion, pas maintenant. Comme souvent dans ces cas-là, j’essaye alors d’ancrer ces résolutions en moi par un peu de pleine conscience : «ne passe pas à autre chose, mais ne continue pas à cogiter sur ça ; laisse le truc décanter, en pleine conscience, laisse-le se déposer en toi». Alors je me redresse sur le banc, j’ouvre mes épaules, je souris, je respire, j’écoute les oiseaux et la rumeur autour de moi, je regarde le ciel, les pins qui se balancent doucement.
Je regarde le sol.
Et je vois ces brins d’herbe (ceux de la photo) qui se sont faufilés dans les fissures du goudron et du béton. Herbes banales, petites plantes de rien du tout. Mais qui me réjouissent au-delà de tout. Victoire de la vie sur la mort, du faible sur le fort (ou plutôt de l’apparemment faible sur l’apparemment fort). Victoire de la vie sur les soucis. De ce qui compte sur ce qui ne compte pas. Victoire, triomphe du végétal sur le mental.
Il me semble que ces herbes viennent aimablement passer la quatrième couche de ma leçon du jour : 1) j’ai observé et écouté la dame ; 2) j’ai réfléchi sur son message ; 3) j’ai respiré et médité ; 4) et voici la muette fanfare végétale, qui s’avance et entonne son hymne sérieux et moqueur à la fois : «il n’y a pas de soucis, il n’y a pas d’ennuis qui doivent te faire oublier la vie ; regarde-nous, et puis c’est tout.»
Je regarde longuement.
Le TGV s’approche. Je me lève, je photographie les brins d’herbe avec mon portable, je renifle une dernière fois l’air frais. La dame continue de raconter ses ennuis, tous ses ennuis, rien que ses ennuis. J’ai presque envie d’aller lui dire merci. Mais je ne veux pas rater mon train. Je monte et m’installe.
Le ciel est magnifique.