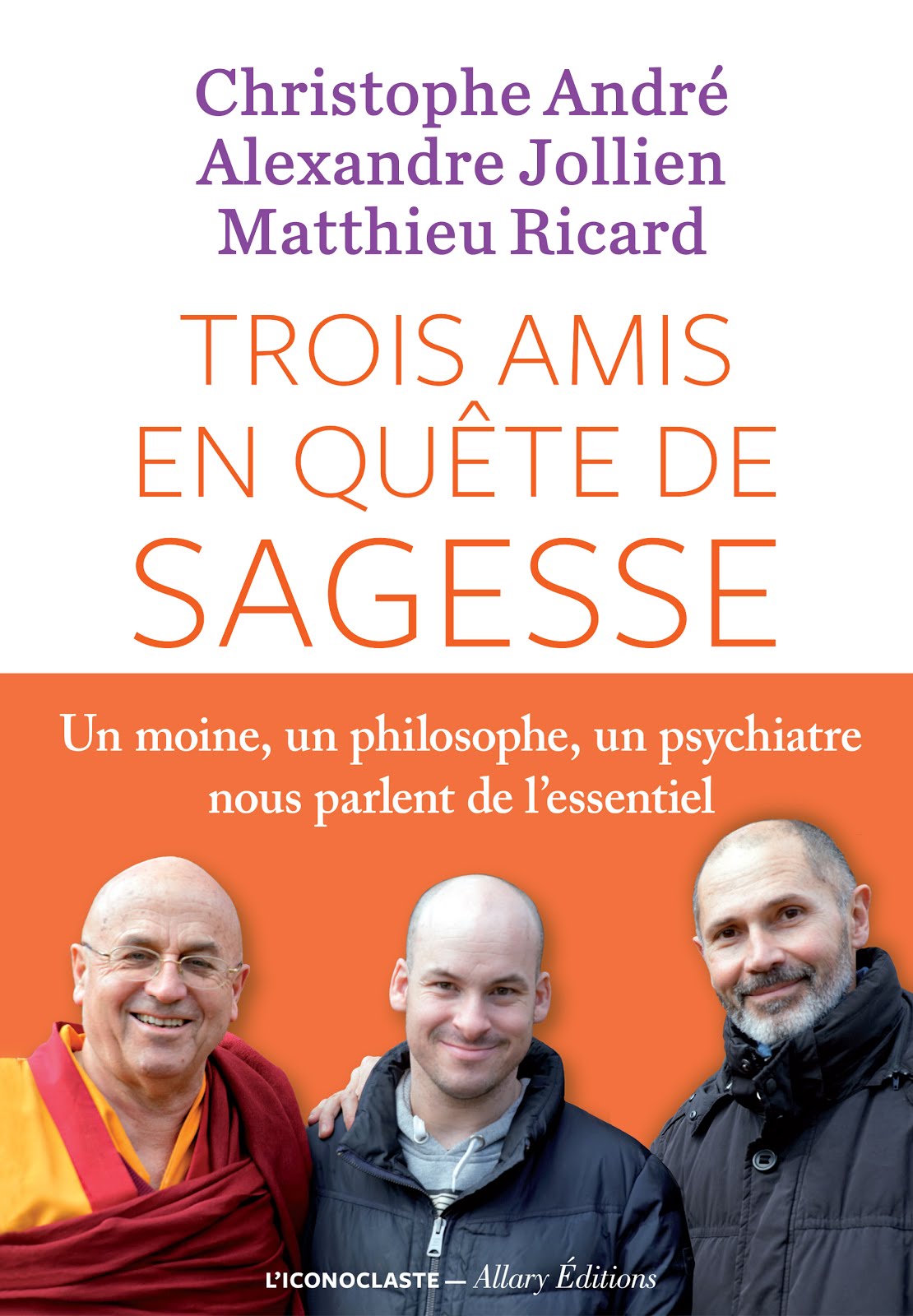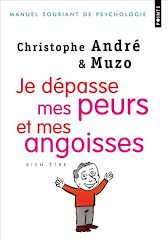C’est après un grand congrès auquel j’ai participé. Je suis sur le chemin du retour, j’arrive à la gare, et j’ai un peu d’avance avant que mon train n’arrive.
Il fait froid dans le hall, alors qu’un beau soleil d’hiver éclaire la matinée ; je sors m’installer sur un banc pour en profiter et savourer la lumière et l’instant.
Mais ce n’est pas si simple.
Rapidement, deux jeunes filles viennent me demander « un peu de monnaie ». Je n’ai pas envie de leur donner, mon porte-monnaie est au fond de ma valise, je n’ai pas envie de tout ouvrir et déballer sous leurs yeux, d’obtempérer à leur sollicitation formulée avec un mélange d’agressivité et d’indifférence feinte (je me doute bien qu’elles préféreraient avoir de l’argent plutôt que d’en demander). J’ai aussi l’impression, l’intuition, que c’est pour acheter de la drogue. Je refuse, elles s’éloignent.
Je m’installe un peu mieux et ferme les yeux pour voir le soleil à travers mes paupières.
Mais un monsieur arrive, allume une cigarette, et se tient debout à quelques mètres de moi, juste dans l’axe du petit vent froid qui souffle ce jour-là. Et qui rabat toute la fumée de la cigarette dans mes narines. Je regarde le fumeur pour voir s’il comprend que cela me gène, mais il ne comprend pas, ou fait semblant de ne pas comprendre ; il se dit peut-être « on nous empêche déjà de fumer à l’intérieur, alors ceux qui veulent en plus nous l’interdire à l’extérieur peuvent aller se faire voir ». Je note que les 9 dixièmes du temps il ne tire pas sur sa clope mais la laisse se consumer à l’extérieur ; c’est cette fumée, même pas filtrée par ses poumons, qui arrive dans les miens, et je n’aime pas ça. Comme j’ai la flemme de lui demander d’arrêter, je vais m’asseoir un peu plus loin sur un autre bout de banc.
Bien installé, je ferme les yeux, et souris doucement, je suis content d’être là, même dans le froid, même dans le bruit de la circulation, je suis mieux à cet endroit que dans le grand hall froid et bruyant de la gare.
« Monsieur, s’il vous plait ? » Un jeune homme m’arrache à mes pensées. Il voudrait lui aussi un peu d’argent. Quelques minutes après, une jeune gitane m’en demande aussi, avec le visage fermé d’une enfant dont la vie est dure et qui s’est résignée à ne pas être aimée.
Bon. Je n’y arriverai pas. Mon attente à moitié normale (passer un quart d’heure tranquille, sur un banc au soleil, en attendant mon train) est aussi à moitié chimérique, car je suis dans un lieu public, un lieu de passage, où chacun vient chercher ce dont il a besoin : soleil, tranquillité dans mon cas ; possibilité de fumer pour le monsieur ; argent pour les autres. C’est normal, c’est le monde réel. Mes droits n’y sont pas supérieurs à ceux des autres. En l’occurrence, ils me semblent mêmes moins impérieux, moins prioritaires.
Alors, ce matin là en tout cas, je ne m’agace pas. J’ai plutôt de la tendresse et de la compassion pour tous ces humains qui m’ont empêché de profiter tranquillement de mon bout de banc au soleil. Je comprends bien pourquoi ils m’ont dérangé. Et je comprends aussi que si je veux être tranquille, ce ne sera pas à cet instant et à cet endroit.
Je me relève pour rentrer dans le hall. J’aperçois un vieux monsieur, très pauvrement vêtu, presque en haillons, qui mendie près de la porte. Je réalise soudain que mes quémandeurs précédents étaient bien vêtus, en comparaison, avec des vêtements en bon état, plutôt à la mode. Je fais alors ce que je n’ai pas voulu faire jusque là, je sors un peu d’argent de mon porte-monnaie et je lui donne en passant, en lui souriant. Il a l’air presque étonné.
Je n’aime pas sélectionner les personnes à qui je donne de l’argent, j’ai toujours l’impression de faire quelque chose d’absurde. Si on mendie, c’est qu’on en a besoin, un point c’est tout, c’est qu’on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, ce matin là, mes petits agacements du début m’ont fait dire non. Puis mes états d’âme de compassion, mon renoncement à obtenir du calme, ma vision des habits déchirés du vieux monsieur ont décoincé mon blocage. Je lui donne avec joie et légèreté.
Je descends dans le hall froid. Personne ne me demande plus rien, des lois et des vigiles écartent les mendiants et les fumeurs, mais je n’ai plus le soleil et l’air frais. J’ai choisi entre deux univers. Je me demande si j’ai fait le bon choix, entre le monde réel de l’extérieur, beau et dérangeant, et le monde virtuel de la gare, où j’ai la paix sans le soleil.
Une voix de femme robotisée annonce que mon train entre en gare. Le débat sur le bon choix est clos. Je connais de toute façon la réponse. Vivre les yeux ouverts, c'est comme marcher pieds nus : parfois le sol est doux, parfois il nous fait mal. On ne peut pas passer sa vie pantoufles au pied.
Illustration : le cimetière de Negombo, au Sri-Lanka, un endroit où être vraiment tranquille, que l'on y soit visiteur ou résident (photo de Karolina Sikorska)...
PS : cet article a été initialement publié dans Psychologies Magazine en mars 2016.