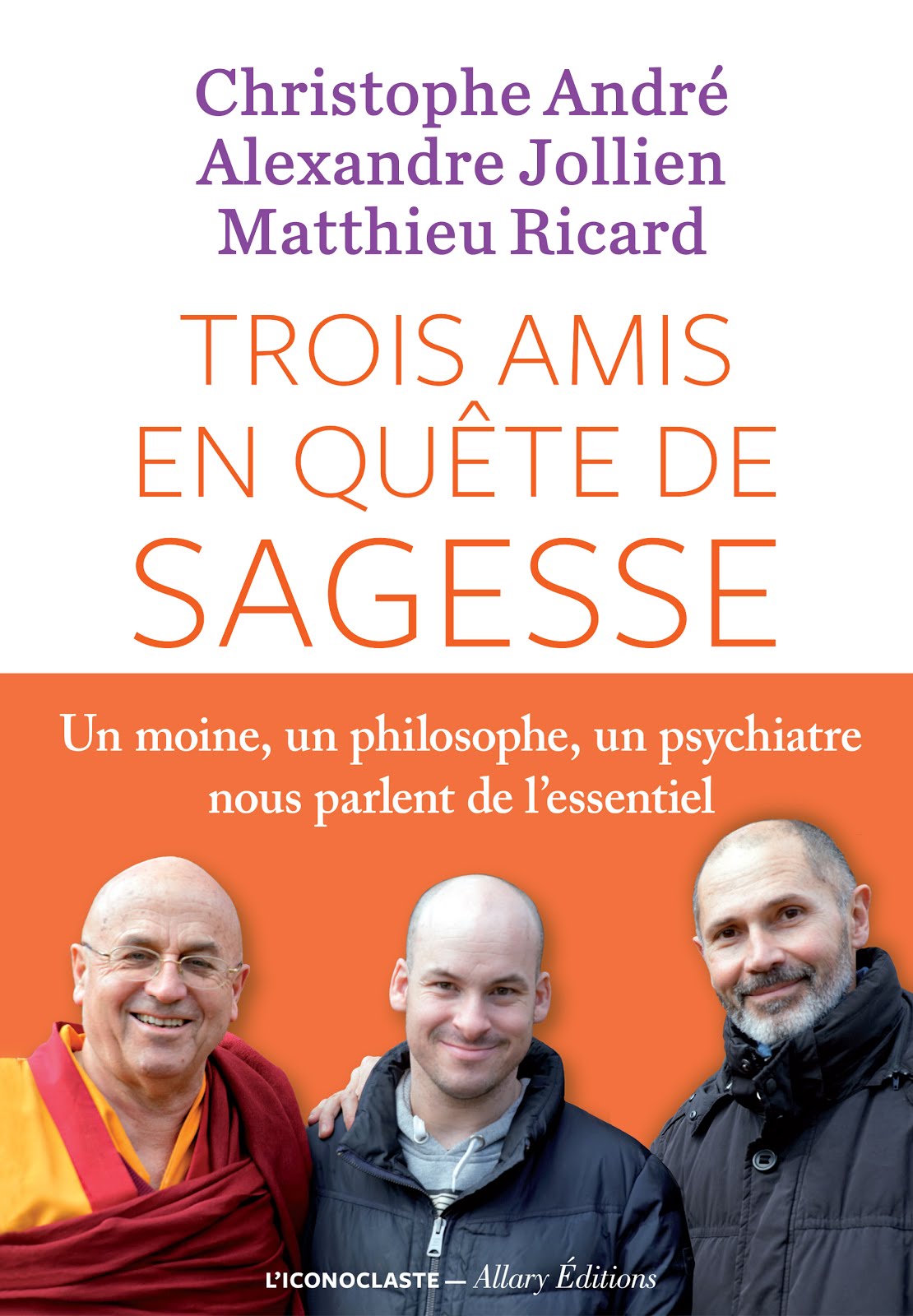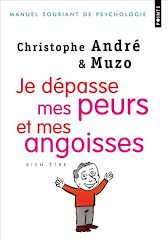La scène se passe il y a quelques semaines lors d’une de mes consultations à Sainte-Anne.
Je reçois une patiente que je connais depuis longtemps, elle-même médecin, avec des problèmes compliqués, et une personnalité compliquée elle aussi. Elle m’a demandé un rendez-vous en urgence car ses soucis connaissaient hélas un rebond.
À la fin de la consultation, réconfortée et consolée (enfin, il me semble) elle sort de son sac un cadeau bien empaqueté : « c’est pour vous remercier de bien vous occuper de moi et de m’avoir prise en urgence, je sais que vous avez plein de boulot. »
En tant que médecins, nous recevons de temps en temps des cadeaux de nos patients. Cela nous procure à la fois du plaisir, évidemment (parce que c’est un cadeau et une reconnaissance de nos efforts) et à la fois de la gêne (nous n’avons fait que notre travail).
Quand je reçois un cadeau, je ressens tout ça, et je remercie en exprimant surtout mon plaisir (« c’est très gentil, etc. »).
Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je dis : « merci beaucoup, mais il ne fallait pas… »
Et comme ma patiente est un peu spéciale dans sa relation aux autres (même si ça ne l’a jamais vraiment gênée dans son travail de médecin), comme elle n’est pas passionnée par les décodages sociaux et messages à double sens, je vois son visage devenir perplexe.
Elle vérifie mes propos : « Ça vous gêne que je vous fasse un cadeau ? »
Moi : « Ben, oui, un peu. Je vous soigne avec plaisir, vous allez mieux, c’est ça mon cadeau. »
Elle : « Parce que si ça vous gêne, je ne veux pas vous ennuyer avec mon cadeau. »
Elle ne sait plus trop quoi faire de son paquet qu’elle hésite encore à sortir complètement de son sac, déconcertée.
Là, je me sens un peu bête : maintenant qu’elle m’a amené ce cadeau, qu’elle l’a choisi pour moi, bien sûr qu’en vrai ça me fait plaisir. Ce n’est pas grave qu’elle le reprenne, ça ne me manquera pas, mais je ne peux pas refuser un cadeau, la laisser repartir avec sa boîte ; ce serait un drôle de message, ce ne serait ni gentil ni respectueux.
Alors je lui dis : « Non, ça me fait très plaisir que vous ayez pensé à moi et que vous m’ayez amené ce cadeau, c’est très gentil de votre part. » Et je laisse tomber les explications sur le pourquoi du comment de la gêne, je me concentre sur l’essentiel.
Soulagée, elle sourit, me tend le paquet, et nous passons à autre chose pendant que je la raccompagne à la porte en bavardant.
Bonne leçon. Après coup, je me suis demandé si elle ne me l’avait pas délibérément donnée, avec plus de malice que je ne l’imagine (du genre « je vais piéger mon psy et le prendre au mot, histoire de rire un peu »). Je ne le crois pas, ce n’est pas du tout son genre. Mais allez savoir…
En tout cas, pour moi, c’est clair quand on m’offrira à nouveau un cadeau, je ne dirai plus : « il ne fallait pas » !
Juste : "merci beaucoup, c'est très très gentil et ça me fait très plaisir ! "
Illustration : 5 fillettes qui ont simplement dit "merci", sans se demander s'il "ne fallait pas"...